Entretien avec Joel Hirst, auteur des Seigneurs du chaos : l’odyssée du djihad
Entretien conduit et traduit de l’anglais par Antoine Maurier
1. — Joel Hirst bonjour, vous venez de publier aux éditions de l’Institut Coppet votre troisième roman, sur le thème du djihadisme, des luttes entre la raison et la religion, et de la liberté. Pouvez-vous nous poser le décor en quelques mots ?
J. H. — C’est l’histoire d’un jeune homme touareg qui, évoluant dans les conditions de vie qui sont celles de l’Afrique de l’ouest, tombe dans un certain nombre de périls. La vie est dure au Mali, en Afrique de l’Ouest — et la corruption et les abus du gouvernement fait qu’il est très facile d’échapper aux mains des autorités. Ces circonstances ont conduit le protagoniste, Aliuf, à un endroit où il devient un djihadiste. Et plus encore que cela : un Qadi, un juge islamique. Mais comme c’est un homme de caractère et de profondeur, il se rend compte finalement que ce qu’il a essayé de réaliser est en fait l’exact opposé de ce qu’il veut vraiment accomplir. Cette compréhension le place en opposition de ses amis et des autres djihadistes, tandis qu’il tente de défaire ce qu’il a mis en place par inadvertance. Puis il découvre un traité qui s’adresse à la puissance de la pensée rationnelle dans l’Islam — et il trouve enfin le salut. Mais son voyage de découverte de soi se paiera au prix ultime.
2. — Les Touaregs forment un peuple très singulier. Ils ont un langage (le tamasheq), des coutumes, des pratiques et des conceptions sur le monde qui leur sont propres. On ressent, en lisant votre roman où les références culturelles et les mots en tamasheq sont légion, que vous les avez étudié scrupuleusement. Il en est de même de la religion musulmane, sur laquelle vous semblez vous être beaucoup documenté.
J. H. — J’ai de nombreux amis touaregs, et j’ai passé beaucoup de temps à étudier la culture et les usages des Touaregs. Plus mes recherches s’approfondissaient, dans l’optique de ce roman, et plus j’étais intrigué. La culture et l’histoire touarègue est très ancienne, plus ancienne que bien d’autres en Afrique. Leur langue, leurs traditions, leurs idées, leur place au centre de l’âge d’or de l’Islam, leur ethnographie remarquable : tout cela fait que les hommes bleus du désert, comme on les appelle, forment un peuple admirable et vraiment unique dans le monde. Pour préparer ce roman, mon travail a consisté à me lancer dans des discussions approfondies avec plusieurs amis touaregs issus de différents clans, et à prendre connaissance de la littérature portant sur l’histoire de ce peuple remarquable. Et vraiment, plus j’en apprenais, plus je voulais en apprendre, car l’histoire de ce peuple me semblait chaque jour plus fantastique. Je peux dire aujourd’hui sans réserves que les Touaregs sont les gens les plus fascinant que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans ma vie.
Bien entendu, j’ai réalisé une étude approfondie de l’Islam. J’ai plongé au plus profond, vers les vérités d’une religion qui portait haut la raison et qui a construit une civilisation avant de tout abandonner aux voix des sirènes de la tradition, et de perdre son chemin. J’ai lu les textes anciens et j’ai étudié les anciens philosophes, ce qui m’a fait comprendre les réalités de cette religion qui a fini par s’égarer. J’espère que mon roman servira à témoigner de toutes les grandes vérités qui se trouvent dans les anciens récits de cette religion, et de l’importance que ces vérités ont eues dans la préservation des connaissances humaines durant un millénaire.
3. — C’est une sorte de figure imposée dans la pensée française, héritière des Lumières, que celle d’opposer la religion à la raison. Dans la perspective que vous proposez, il semble que les deux ne se heurtent que pour mieux se rejoindre. Pouvez-vous vous expliquer là-dessus ?
J. H. — La raison est issue de la religion, de la foi. Elle est issue de notre communication avec le divin, cette entité qui nous a doté de cette abilité de penser qui nous distingue du monde animal. Les grands philosophes des temps anciens ne séparaient pas ces deux sphères de la pensée humaine. Ils comprenaient que le fait même que nous étions créés à l’image de Dieu signifiaient que nous étions créé dans une forme supérieure aux animaux, avec une capacitité à raisonner et à comprendre, à juger et à décider, qu’ils ne possèdent pas. Il est certain que parfois nous nous éloignons de ces lois naturelles qui font de nous des hommes. Et quand nous nous en éloignons, nous retombons dans la violence. Car quand nous nions notre capacité créative, notre capacité à comprendre, à discerner et à apprendre, bref tout ce qui est issu de notre création à l’image de Dieu, nous ne pouvons répondre que comme des animaux : à travers la violence.
4. — Les djinns sont ces créatures imaginaires, bon ou mauvais génie, qui viennent tirailler la conscience des hommes. À de nombreuses reprises, ils interviennent dans votre récit. Est-ce en écho à la place qu’a encore la divination dans les sociétés africaines, ou servent-ils à d’autres fins ?
J. H. — Mon roman se développe sur le thème du réalisme surnaturel, un genre littéraire qui met en valeur les aspects surnaturels du monde. C’est aussi ce qui m’a à ce point intéressé dans l’Islam et dans cette idée de Djinn, ces entités créées par Dieu aux commencements des temps à partir d’un feu sans fumée. Ils sont comme les anges et les hommes, il n’y a aucune raison de croire qu’ils ne pourraient pas exister et en vérité leur existence peut expliquer tant de choses. Leur interaction de ces entités avec les hommes, et tout particulièrement dans avec ces peuples vivant dans des terres éloignées qui possèdent souvent tant d’histoires fantastiques, permet de fournir bien des explications. Mais plus fondamentalement, j’écris sur un monde où la raison et le surnaturel coexistent et interagissent ; où les hommes doivent lutter avec leur esprit pour parvenir à comprendre les phénomènes et à placer à leur juste place ce qu’ils savent, ce qu’ils pensent et ce qu’ils croient, car dans ce monde les trois se lient, souvent sans leur consentement.
5. — Votre roman illustre la puissance des circonstances et la difficulté de sortir d’une voie, quand on l’a une fois empruntée. Dans le cas de votre héros, qu’est-ce qui s’oppose le plus à ses résolutions ?
J. H. — C’est sa haine. J’ai vu cela très souvent, car tant de gens sont victimes des circonstances de leur naissance. Ceux d’entre nous qui sont nés en Occident oublient que nos naissances sont un évènement très chanceux. J’aurais très bien pu être un pauvre musulman au Mali, et mon histoire aurait été très différente. Aliuf doit se battre contre cela, avec la violence et la pauvreté qu’il y a dans sa vie, et il doit décider de comment il y répondra. C’est quelque chose de très commun et que j’ai souvent observé en vivant dans ces pays où les choix des gens sont très limités. C’est ce qui fait que nous ne les critiquons pas pour leurs décisions, sachant que nous n’aurions sans doute pas mieux agi si nous étions à leur place.
6. — Vous n’ignorez pas que le djihadisme est aujourd’hui, pour la France, un sujet brûlant. Les attaques qui ont meurtri notre pays ont laissé le sentiment aux Français que les djihadistes étaient des barbares décérébrés. Dans votre roman, vous essayez au contraire de chercher leurs motivations, leurs sentiments : au lieu de la folie, vous trouvez le cynisme, l’envie, la quête de sens. Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous reprocher d’ « humaniser », même sans en faire des gentils, ces hommes qui prennent la voie du djihad ?
J. H. — J’ai vécu un peu partout dans le monde et j’ai travaillé avec bien des gens. Tous ces gens que j’ai rencontré, cotoyé ou avec qui j’ai travaillé, étaient chacun le protagoniste de sa propre histoire. Personne ne se place devant le miroir le matin et dit froidement « je suis une personne mauvaise ». Tout le monde a une raison de faire ce qu’il fait. Les dhihadistes ne sont pas différents. Ce qu’ils font est bien évidemment répréhensible, mais c’est la réponse qu’ils trouvent aux circonstances, et c’est quelque chose de très difficile pour nous à comprendre. Mes romans — tous mes romans — représentent les gens comme des hommes. Ce sont des personnes rationnelles qui prennent des décisions en suivant leur intérêt, tout comme nous. Ce sont des gens qui sont capables d’aimer, de se battre, de pleurer, et de haïr. Nous savons que ces émotions sont au fond de nous. Il est facile de traiter les autres comme des animaux ou des sous-hommes ; il est plus difficile d’essayer de les comprendre. Mais en cherchant à les comprendre, on aboutit à de meilleures réponses et à de meilleures politiques pour éviter que le mal ne se développe.
7. — Vous montrez bien dans votre récit que, quand les Occidentaux construisent une école, les populations locales y voient un lieu pour endoctriner leurs enfants, quand ils construisent un hôpital, c’est un lieu pour que nos médecins examinent leurs femmes, etc. À croire que véritablement l’enfer est pavé de bonnes intentions. Selon vous, quel mal l’intervention occidentale a-t-elle causé depuis toutes ses années ? Ce mal est-il réparable ?
J. H. — Les interventions occidentales n’ont pas toujours été mauvaises. Bien sûr, le souvenir de la colonisation survit encore dans les esprits des populations anciennement colonisées. Mais trop souvent nous cessons de traiter les gens comme des hommes, comme des peuples, comme des égaux, et nous les considérons comme des « bénéficiaires » ou les « objets » de notre charité. C’est ce qui déshumanise ces peuples, c’est ce qui les met en colère, c’est ce qui crée un retour de baton. Nous devons nous souvenir que, comme l’explique un chef touareg dans le roman, « la pauvreté n’est pas notre plus grande préoccupation ». La fierté, l’histoire, la culture : ce sont des forces tout aussi puissantes. Tâchons de nous en souvenir.
8. — Vos deux premiers romans formaient ensemble une série et traitaient avec dérision de la situation au Venezuela. Les journaux ne cessent plus, depuis des mois, de nous décrire le dépérissement sans fin de ce pays. Quel est votre sentiment sur la situation de ce pays ? En quoi s’avère-t-elle conforme à vos prédictions ?
J. H. — Tout ce que j’ai prédit à propos du Venezuela est devenu réalité. C’est un État en chute libre, conduit par des criminels et par des gens qui nient que l’intérêt personnel soit un stimulant actif de l’action humaine. Un communisme, froid et sans âme, a pris le contrôle du pays. Ce n’est pas la première fois. Nous avons vu cela par le passé. Quant à moi, j’ai écris sur la disparition d’une civilisation sous les coups du pouvoir « égalisateur » des idées socialistes. J’espère que c’est la dernière fois que nous voyons une telle histoire se dérouler, mais je n’y crois pas beaucoup.


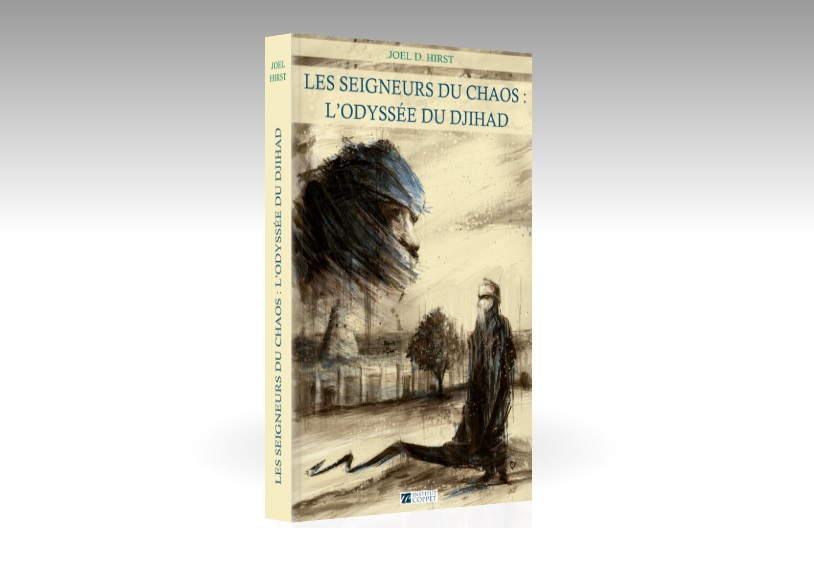
Laisser un commentaire