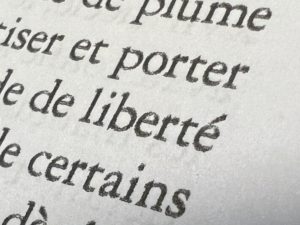 Convaincu que la défense de la liberté, et son succès pratique en France, ne peuvent être espérés à moins d’une conviction généralement partagée de ses mérites, Ambroise Clément creuse ici la notion même de la liberté, pour que son procès soit correctement instruit. Il écarte les sophismes et les sophistes, et trace l’idéal que doivent se donner la loi et le gouvernement, pour que la société soit libre, éclairée, et progressive, plutôt qu’asservie, décadente et démoralisée.
Convaincu que la défense de la liberté, et son succès pratique en France, ne peuvent être espérés à moins d’une conviction généralement partagée de ses mérites, Ambroise Clément creuse ici la notion même de la liberté, pour que son procès soit correctement instruit. Il écarte les sophismes et les sophistes, et trace l’idéal que doivent se donner la loi et le gouvernement, pour que la société soit libre, éclairée, et progressive, plutôt qu’asservie, décadente et démoralisée.
DE LA LIBERTÉ HUMAINE
AU POINT DE VUE MORAL, RELIGIEUX, ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE
(Journal des Économistes, novembre 1877.)
SOMMAIRE : Caractères essentiels de la liberté. — Conditions de son exercice efficace. — Détermination des droits et des devoirs. —Lumières apportées par l’économie politique. — Influence des dominations religieuses et gouvernementales.
I.
À partir du stage agricole et de la division du sol en propriétés privées garanties par les forces sociales, les principales causes produisant encore de grandes différences dans la civilisation et le degré de perfectionnement des populations parvenues à ce stage, ne sont plus imputables qu’à l’usage bien ou mal entendu qu’elles font, et au plus ou moins d’énergie qu’elles déploient pour obtenir le respect d’une faculté inhérente à notre nature mentale, la plus précieuse et la plus élevée — après l’intelligence et la perfectibilité, qu’elle seule peut féconder — de celles dont nous avons reçu le germe du divin auteur de notre nature, avec mission d’en développer la puissance par nos propres et constants efforts : cette faculté est la LIBERTÉ.
Il est avant tout bien nécessaire de s’entendre sur ce que l’on doit concevoir sous un tel mot, car les discussions philosophiques, morales et politiques, n’ont nullement réussi jusqu’à présent à déterminer cette conception d’une manière nette, précise et pouvant la rendre à peu près identique pour tous. Nous nous sommes donc appliqué d’abord à bien fixer cette détermination, à reconnaître et à constater les principaux caractères de la liberté, à savoir en quoi elle consiste et quels sont les procédés par lesquels elle agit efficacement ; ensuite quelles sont, dans la conduite générale, les principales directions qui peuvent sûrement développer sa puissance efficace et celles ne pouvant que l’affaiblir, retarder, arrêter ses progrès salutaires, ou la fourvoyer dans des voies qui, loin de conduire à notre perfectionnement, ne sauraient aboutir qu’à notre dégradation.
Cette étude sur la liberté nous a imposé de persévérants efforts, qui, nous l’espérons, ne seront pas infructueux, à la condition d’obtenir, pour l’exposé de leurs résultats, l’attention patiente qu’il exige, et que ces résultats seraient de nature à fortement motiver, si, comme nous le pensons, ils fournissent de réelles et nouvelles lumières propres à éclairer le problème de nos destinées et l’ensemble de la conduite à suivre par les sociétés.
L’homme est soumis à une multitude de conditions d’existence, qui, à première vue, ne semblent pas permettre de le reconnaître comme un être libre, car elles sont entièrement indépendantes de sa volonté ; celle-ci n’est pour rien dans sa naissance, dans la détermination du moment, du lieu, de la famille où elle survient, ni dans celle du sexe ; elle n’est pour rien non plus dans l’organisation qu’il reçoit, dans la nature des forces ou des propriétés qui animent, développent et soutiennent cette organisation, dans la durée variable et limitée de ses fonctions vitales, et dans un grand nombre des altérations qu’elles subissent pendant cette durée.
Ce n’est pas davantage àsa volonté que sont dues la nature des choses dont il est entouré, ni celle des besoins les plus impérieux auxquels il est soumis, ni celle des facultés intellectuelles et affectives qu’il a reçues en germe.
Mais l’homme peut perfectionner ses facultés, en grandir la puissance, développer ses besoins, multiplier indéfiniment les moyens de les satisfaire, et tout cela en des limites déjà très larges qui, dans les civilisations ascendantes, reculent à mesure que les générations se succèdent — les progrès accomplis par chacune d’elles s’ajoutant à l’héritage de celle qui la suit. C’est dans cet ordre de phénomènes que se manifeste indubitablement notre liberté.
Si l’on se demande, en effet, quels sont les caractères que nous considérons comme essentiels à la liberté, dans les limites où elle peut s’exercer, on reconnaît d’abord que nous entendons par là une faculté d’initiative attribuée à notre personnalité, à notre volonté, faculté dont l’action ne doit être imposée ni déterminée d’avance par aucune autre volonté, aucune autre puissance que la nôtre ; car, s’il en était autrement, ce ne serait plus ce que nous désignons par le mot liberté. L’expérience et la réflexion nous donnent à tous l’intime conviction que nous possédons bien réellement une telle faculté, et que les déterminations de notre volonté, quand elles ne subissent de la part de nos semblables aucune autre contrainte que celle du respect en autrui, de la liberté et des autres droits que nous avons à défendre nous-mêmes ne dépendent absolument que d’impulsions dont la cause est en nous, dans notre intelligence ou nos sentiments.
On reconnaîtra ensuite un autre caractère essentiel de la liberté dans la manifestation, chez l’être qui en est doué, du pouvoir de développer et perfectionner par lui-même ses facultés natives dans des limites indéfinies, — d’exercer, dans le milieu où il est placé, une action et une domination progressives sur les choses et les êtres autres que semblables, — de changer les conditions primitives de ce milieu et de sa propre existence en ce monde, au point de s’y faire un sort n’ayant plus rien de comparable à son état originaire.
Or, nous ne saurions douter que l’homme soit investi d’une telle puissance, car il a déjà changé la face d’une grande partie de la terre, —profondément modifié la distribution de la vie entre les différents êtres organisés, —asservi à ses besoins un grand nombre des propriétés ou des forces de la matière inorganique, — donné à ses propres facultés un développement prodigieux — et multiplié les moyens d’existence de son espèce dix mille fois plus tout au moins, pour une même étendue de territoire occupé, qu’ils ne le sont à l’état sauvage ou pastoral.
Nul ne saurait méconnaître qu’en exerçant un tel empire sur lui-même et sur le monde terrestre, l’homme participe, en quelque degré, du pouvoir ordonnateur de Dieu lui-même, ce qui ne pourrait évidemment appartenir à un agent dépourvu de liberté.
Il n’est donc plus possible de croire qu’il n’accomplit rien qui ne soit le résultat nécessaire de forces ou de lois inconscientes et aveugles auxquelles sa volonté serait, qu’il le reconnaisse ou non, étroitement assujettie ; cela n’est plus soutenable dès qu’on le voit, au contraire, constamment exercer lui-même sur ces lois ou ces forces une action dirigeante, tels, par exemple, que ceux où il emploie la force calorique, activée par celle de l’air comprimé et versé par torrents sur les foyers, à séparer des minerais les métaux, à fondre et façonner ceux-ci sous des milliers de formes diverses, et ceux où il dirige, au moyen de merveilleux instruments de son invention, l’action des rayons lumineux, de manière à lui montrer dans les profondeurs de l’espace des millions d’êtres que n’apercevaient pas ses yeux, même quelques traits de la surface de la lune et des planètes, à lui révéler la grandeur sans limites de l’univers où il est placé, et en même temps tout un monde d’êtres microscopiques — le monde des infiniment petits, — à tracer des images fidèles sur des surfaces préparées ; — enfin, à nous donner, par l’analyse spectrale, un commencement de connaissance de la nature ou de l’espèce des corps composant les astres d’où nous viennent les rayons lumineux, ou se trouvant dans les milieux que ces rayons traversent. N’y a-t-il pas en tout cela la preuve évidente que la force intelligente qui nous anime, loin d’être asservie aux forces involontaires, parvient, au contraire, à les dominer, à les régir, à obtenir ainsi une part, relativement faible et limitée, mais pourtant bien réelle, de l’action libre par excellence, celle de Dieu ?
Il est encore un autre caractère tout à fait essentiel de la liberté, et il consiste en ce qu’elle ne comporte, dans la plupart de ses développements ou de ses évolutions, rien de nécessaire, de forcé, ni par conséquent de constamment uniforme, comme le sont les activités déterminées par les forces involontaires, y compris la vie et l’instinct, telles, par exemple, que les évolutions des grands corps répandus dans l’espace, ou celle des abeilles, des fourmis, des castors, etc.
Or, rien n’est plus divers que la marche suivie par les sociétés humaines dans leurs combinaisons familiales, communales, politiques, — dans leurs croyances et leurs institutions religieuses, — dans les développements de leur langage, de leur industrie et de leur savoir, — dans leurs institutions civiles et dans leurs mœurs, — en un mot, dans l’ensemble de leurs civilisations respectives. Tout, dans l’extrême diversité de celle-ci, témoigne qu’elles ne résultent pas uniquement de lois nécessaires et inflexibles, mais, à beaucoup d’égards, des directions contingentes, facultatives, de nos volontés, de notre activité, et c’est là bien assurément l’une des preuves les plus saisissantes, les plus incontestables de notre liberté naturelle ; car la grande disparité entre les développements respectivement réalisés par les diverses fractions de l’humanité ne serait plus explicable, s’ils n’étaient dus qu’à un ensemble de lois naturelles ou divines, les mêmes pour tous et agissant seules.
Les caractères essentiels de la liberté se manifestent donc chez l’homme avec une évidence telle, qu’elle ne semble plus permettre aux esprits attentifs de conserver aucun doute à cet égard.
II.
Mais comment procède cette liberté, et en quoi consistent essentiellement les conditions de son exercice efficace ? C’est ce que nous allons examiner.
Cе que l’on nomme la raison n’est pas, nous l’avons vu, autre chose que l’ensemble de nos facultés intellectuelles mis en activité par notre volonté, dans le but d’accroître nos connaissances et de distinguer, en tout ce que notre entendement peut pénétrer, la vérité de l’erreur, ce qui nous sert de ce qui nous nuit, ce qui nous perfectionne de ce qui nous dégrade, et de développer ainsi ce que l’on a justement appelé nos lumières ; car les conquêtes de la raison sont pour notre esprit ce que la lumière physique est pour nos yeux ; elles nous font distinguer nettement ce que sans leur secours nous n’apercevrions pas, ou ce dont nous n’aurions que des idées confuses et erronées. On a vu encore que la raison ne parvient à acquérir des lumières intellectuelles qu’à l’aide de sensations antérieurement ou actuellement reçues, c’est-à-dire de l’expérience ou de l’observation.
Maintenant, si l’on se demande par quels accès procède notre liberté, on reconnaîtra bientôt que ces actes consistent, non point dans des déterminations spontanées, irréfléchies et sans lumières de notre volonté, mais bien dans l’exercice de la raison, dans la faculté de délibérer ces déterminations, afin qu’elles soient éclairées par les lumières intellectuelles que nous avons acquises, et qui peuvent nous en montrer la portée ou les conséquences ; en ce sens, la liberté serait la faculté de prévoir et de conformer nos déterminations à cette prévoyance ; mais plus généralement, elle est la faculté de délibérer avant d’agir, de subordonner nos déterminations aux indications de notre raison, et de ne pas les abandonner passivement aux impulsions de nos sentiments, de nos mobiles plus ou moins instinctifs. Il est vrai qu’il faut d’abord que ceux-ci se prêtent à une telle subordination ; mais le pouvoir de l’établir est en tout homme pourvu d’une raison exercée ; s’il s’applique de bonne heure à dominer ainsi ses penchants, la force de l’habitude lui rend bientôt leur subordination plus facile ; ce n’est du reste qu’en substituant de la sorte la raison à l’instinct qu’il fait vraiment acte de liberté, et non point en cédant spontanément et sans délibération à des entraînements aveugles.
Nous n’entendons pas assimiler entièrement les sentiments à l’instinct, car ils sont conscients, volontaires, et peuvent s’éclairer des lumières de la raison ; mais, lorsqu’ils nous déterminent sans le secours de ces lumières, nos déterminations sont dépourvues de toute prévoyance et se rapprochent beaucoup des actes purement instinctifs.
C’est uniquement par l’exercice de la raison que notre liberté se développe et grandit ; car elle ne consiste pas, comme on le répète souvent, à faire ce que nous voulons, puisque, bien évidemment, il faut d’abord que nous le puissions : la liberté consiste essentiellement à pouvoir ce que nous voulons après réflexion, et elle ne progresse chez nous que dans la mesure de cette PUISSANCE[1] ; attendu qu’elle ne peut se développer que par l’exercice de la raison, et dans la proportion des lumières ou du savoir que cet exercice nous a fait acquérir, et qu’ici le sens commun a très bien résumé la vérité scientifique dans cette expression proverbiale : — Savoir, c’est pouvoir. L’expérience et l’observation nous apprennent, en effet, qu’à mesure que notre raison s’exerce davantage et dans de meilleures directions, — qu’elle acquiert plus de connaissances réelles propres à éclairer les voies que nous avons à suivre et à éviter, — qu’elle gouverne plus entièrement nos mobiles sentimentaux et prend plus exclusivement la direction de notre conduite, — nous étendons notre empire sur la nature extérieure, nous l’assujettissons mieux à servir nos volontés et nos besoins, en même temps que nous luttons avec plus de succès contre les obstacles qu’opposent à nos progrès toutes les imperfections de notre propre nature. Tout cela confirme que notre liberté ne grandit qu’avec les lumières de notre raison et avec la puissance qu’elles donnent à nos volontés réfléchies.
C’est donc bien à la raison, grandissant elle-même et devenant plus efficace par l’exercice que nous lui imposons, qu’il faut attribuer tous les développements déjà acquis, et tous ceux qui pourront l’être encore à l’avenir par la liberté, laquelle, sans un tel secours, serait aussi impuissante et aussi peu manifeste chez l’homme qu’elle l’est chez les animaux.
Parmi les acceptions si diverses et si variables données jusqu’à présent au mot liberté, les plus répandues sont contraires, et nous n’en connaissons pas d’identique à celle que nous venons de spécifier ; nous avons donc à montrer que toutes les autres s’écartent plus ou moins de la vérité.
Pour nos théologiens de l’Église romaine, la liberté est la faculté de choisir entre le bien et le mal; mais le bien et le mal ne sont point un objet de libre examen, et consistent uniquement dans l’obéissance ou la désobéissance aux commandements, préceptes ou règlements donnés au nom de Dieu ou de son Église. Lorsque cette Église se déclare pour la liberté du bien, elle n’entend par là rien autre chose que le règne absolu de ses volontés, de ses directions sur toute la conduite humaine, et il n’y a plus ici de distinction à faire entre le spirituel et le temporel ; car qui pourrait prétendre limiter la compétence de l’autorité divine ? On voit qu’il ne s’agit là que de la revendication d’une obéissance absolue à l’Église, que les orthodoxes entendent imposer, au besoin par la force, ce qui entraînerait le sacrifice entier de la liberté.
Nos philosophes spiritualistes admettent bien que la liberté serait la faculté de délibérer ou réfléchir avant de nous déterminer ; mais dans leur doctrine, comme dans celle des théologiens, cette délibération préalable serait inutile ou impuissante à nous guider, attendu qu’ils n’admettent pas que nous ayons à éclairer nos directions morales par la recherche et la prévoyance de la conséquence de nos actions, et qu’ils proscrivent au contraire un tel moyen de discerner le bien ou le mal, les directions dont il s’agit étant, selon eux, réservées à une conscience inspirée et infaillible, ne nous laissant à leur égard d’autre soin que celui de l’interroger et de lui obéir ; attendu encore que, suivant leurs enseignements, notre conduite ne serait que l’accomplissement d’un plan providentiel et préconçu duquel nous tenterions en vain de nous écarter, ce qui, bien évidemment, anéantirait notre liberté.
Ici, nous suspendrons pour un moment l’examen des significations diverses ou opposées attachées au mot liberté, afin de tenter de dissiper bien des obscurités répandues sur cette question, par la prétention de concilier notre liberté avec la prescience divine absolue.
On a dit, à l’appui de cette prétention, que, devant Dieu, le passé, le présent et l’avenir ne sont qu’un, et que, voyant ainsi tout à la fois, ce n’est pas parce qu’il voit les actes de notre conduite que nous les accomplissons, mais bien parce que nous les accomplissons qu’il les voit.
On a dit ensuite : La prescience de Dieu est certaine, et s’étend à tout, car il n’y a pas de limites à son pouvoir. D’un autre côté, nous ne pouvons douter de notre liberté, dont nous usons à chaque instant, — et si la chaîne des raisonnements qui lient ces deux vérités échappe à notre entendement, nous ne saurions être autorisés pour cela à lier l’une ou l’autre.
On a dit, enfin, que la prescience divine n’était que la prévoyance élevée à son plus haut degré de puissance, et que, si nous prévoyons souvent nous-mêmes la conduite d’un individu dont les mobiles et le caractère nous sont connus, sans que sa liberté soit en rien altérée par une telle prévision, nous ne saurions valablement contester qu’il en soit de même de la prévoyance infinie, et qu’elle puisse s’étendre à la conduite de tous les hommes, sans qu’il en résulte qu’ils n’aient plus leur liberté.
C’est par de tels sophismes que l’on prétend faire admettre à notre intelligence deux propositions qui s’excluent l’une l’autre, avec une évidence pour ainsi dire palpable.
Que de prétentieux et vains échafaudages de mots vides de toute idée nettement déterminée, sur la durée et l’étendue, l’absolu et le relatif, l’infini et le fini, aient amené des esprits fourvoyés en un tel dédale à l’affirmation que la succession des temps n’existe pas pour Dieu, c’est là une conception aussi téméraire que contraire aux plus claires notions de la raison humaine ; mais, en tout cas, ce qui est bien certain, c’est que le passé, le présent et l’avenir ne sauraient se confondre pour nous ; or, si, dès avant ma naissance, Dieu a vu ce que je ferais durant ma vie, il est parfaitement sûr, pour mon entendement et pour celui de tout autre homme, que je ne pourrais faire autrement sans mettre sa prévision en défaut, — et si, sa prévision étant infaillible, je ne puis que suivre la ligne prévue, par conséquent ordonnée et immuablement fixée d’avance sans ma participation, il est également certain et absolument indubitable que je n’ai pas le pouvoir, que je ne suis pas libre de m’en écarter.
La chaîne des raisonnements qui nous échapperait n’est ici qu’une supposition radicalement inadmissible ; car les lois et les notions les plus sûres de notre entendement nous garantissent, précisément avec le même degré de certitude que celle offerte par les vérités géométriques, qu’il n’y a point de chaîne de raisonnement capable de lier deux propositions parfaitement contradictoires et s’excluant nécessairement l’une l’autre, ou de faire qu’une chose puisse, en même temps et dans le même sens, être et n’être pas.
Enfin, la prescience divine n’est nullement assimilable à notre prévoyance, non seulement parce que celle-ci est bornée et faillible, mais encore, et surtout, parce qu’elle ne peut s’appliquer qu’à des causes et des conséquences que nous n’avons point du tout ordonnées nous-mêmes, et n’avons pu connaître qu’en les observant chez les individus dont nous parvenons parfois à prévoir la conduite ; — tandis qu’il ne saurait y avoir, dans la prévision divine, absolument rien qui n’ait été voulu et arrêté par le suprême ordonnateur, qui est bien ainsi le véritable et unique auteur de tout ce qui n’échapperait pas à sa prescience infaillible ; en sorte que, s’il n’eût décidé que notre conduite serait, en partie, soustraite à de telles conditions, elle ne pourrait être que la stricte exécution de ses propres volontés, et que dès lors nous ne saurions plus être à aucun titre ni libres ni responsables.
Mais les arguties dont nous venons de montrer, assez clairement ce nous semble, la complète inanité, et dans lesquelles se résument tous les efforts accomplis pour incliner notre esprit à admettre à la fois sa propre liberté, et une prévision divine qui l’anéantit absolument, ont-elles pu tromper même ceux qui les ont formulées ? De semblables subtilités sont-elles autre chose qu’un abus volontaire, au service des erreurs consacrées, des facultés les plus élevées que nous ayons reçues de Dieu, — celles qui aspirent à la lumière intellectuelle, à la vérité ?
Ce que la raison, ou même le sens commun, nous indique clairement ici, c’est que la suprême intelligence, cause première de la nôtre, qui n’en est, pour ainsi dire, qu’une faible étincelle, ne saurait avoir des volontés contradictoires ; qu’elle n’a pu vouloir, en même temps, douer les hommes de liberté et la leur retirer aussitôt ; qu’en conséquence, en la leur donnant, en leur faisant ainsi une part dans le gouvernement de leur conduite — la part réservée à leur propre intelligence, — elle a indubitablement renoncé à ordonner et à prévoir l’usage que nous en ferions, puisque le don de la liberté ne saurait être réel qu’à cette condition, et qu’il suffirait bien évidemment que l’usage d’un tel don eût été prévu, et dès lors invariablement fixé, même avant que nous fussions appelés à la vie, ou à l’exercice de nos facultés, pour l’anéantir complètement.
Un cercle exact est une circonférence dont tous les points sont également éloignés du centre ; s’il n’en est pas ainsi, ce n’est plus le cercle géométrique.
La liberté de l’homme, dans les limites qui lui sont assignées, est une initiative attribuée à sa personnalité mentale, à sa volonté, — initiative dont l’action non ordonnée ou tracée d’avance est laissée à ses propres déterminations ; s’il en est autrement, ce n’est plus la liberté.
III.
Nous reprenons notre examen des acceptions diverses ou opposées données au mot liberté.
Pour les philosophes matérialistes, ou du moins pour ceux d’entre eux qui restent conséquents avec leurs principes, la négation de la liberté humaine est forcée ; car, si tout ce qui se passe en nous et hors de nous ne résulte jamais que des propriétés inhérentesà la matière, agissant d’après des lois inflexibles et aveugles dont nos volontés elles-mêmes ne sont que des effets nécessaires, il est évident que nos pensées, nos déterminations, nos actes — produits du jeu involontaire des propriétés ou des forces de la matière — ne comportent pas plus de liberté, c’est-à-dire d’initiative et d’action propres à notre personnalité mentale, que n’en comporte le mouvement des aiguilles d’une montre. Il est dès lors difficile d’expliquer que les partisans de cette doctrine, ou du moins plusieurs des principaux d’entre eux, se montrent défenseurs sincères de la liberté en politique, et admettent en morale le dogme de la conscience révélatrice du bien et du mal, déclarant y trouver la règle de leur conduite, — comme s’il était possible que nous fussions libres en quelque chose, — comme s’il leur était facultatif de se conduire autrement qu’ils ne font, et qu’il y eût à s’inquiéter de règles pour des mouvements nécessaires ! — comme s’ils oubliaient que la ligne de toute leur conduite est impérieusement déterminée par l’action des propriétés ou des lois inconscientes, émanant de leurs organes et des autres matières !
En politique, le mot liberté prend des acceptions indéfiniment variées, et chez le plus grand nombre, la notion de la liberté se confond positivement avec celle de la domination.
Et que l’on ne se hâte pas de penser que nous imaginons une aussi incroyable confusion, car elle existe incontestablement, non seulement chez les partisans de la souveraineté absolue du peuple, dont le principe soumet les minorités à la domination illimitée des majorités, mais encore chez tous les autres partis politiques, même chez ceux qui s’intitulent libéraux ; attendu qu’à l’exception d’une opinion trop peu répandue encore, et trop impuissante pour constituer un parti, toutes les autres s’accordent à vouloir une action dirigeante des gouvernements sur les sociétés, sur l’enseignement et l’éducation, sur les cultes religieux, sur les beaux arts, sur la gestion des intérêts collectifs communaux, provinciaux, départementaux, etc., sur l’assistance ou la charité, sur les travaux et les transactions de la production générale, etc. — Et ceux qui jugent nécessaire ou convenable de donner aux gouvernements, à l’autorité politique et législative, cette action directrice presque illimitée, ne paraissent nullement se douter que tout ce qu’ils livrent de la sorte aux attributions gouvernementales, est nécessairement enlevé à la libre activité privée, à laquelle ils substituent ainsi, dans la plus large mesure, les vues, les volontés, c’est-à-dire la domination des gouvernants quels qu’ils soient.
Cette étrange et funeste erreur, plus généralisée et enracinée en France que dans la plupart des autres États de l’Europe, et dont la persistance tient surtout aux enseignements décevants que le clergé romain a rétablis, et de plus en plus fait prévaloir chez nous depuis soixante ans, est, nous le répétons, fortement empreinte dans les tendances de tous nos partis politiques, sans exception.
Les uns sont pour la SOUVERAINETÉ de la nation, c’est-à-dire des majorités ; — les autres sont pour une trinité de souverainetés, composée de Dieu, représenté par son clergé, d’un monarque de droit divin, et d’une noblesse privilégiée et héréditaire ; — les autres, enfin, sont pour une souveraineté partagée entre une assemblée élective, une monarchie héréditaire et une autre assemblée nommée par le monarque. Par une inadvertance véritablement étrange et féconde en résultats des plus déplorables, aucun de ces partis ne paraît se douter qu’en politique, où il ne peut être raisonnablement et légitimement question que d’établir, le mieux possible, les garanties nécessaires au respect de la liberté et des autres droits de tous et de chacun, nulle souveraineté n’est admissible, car l’idée attachée à ce mot est celle d’une souveraineté, d’une puissance dirigeante et sans limites déterminées, laquelle ne saurait évidemment s’exercer sans violation de la liberté et des autres droits, que la mission légitime de l’autorité politique est, au contraire, de garantir à tous également.
Au point de vue religieux, les tendances du sacerdoce romain, relativement à la liberté, ont toujours été de la supprimer entièrement dans la conduite humaine pour y substituer ses propres directions; en ces dernières années, tout le monde a pu se convaincre, en France, par les déclarations publiques des évêques, que cette prétention est encore aujourd’hui aussi absolue qu’au temps du pape Grégoire VII. Cependant, nous avons parmi nous des libéraux très éclairés et dont la sincérité n’est pas douteuse, affirmant qu’il n’est point de liberté pour les peuples sans de puissantes croyances religieuses ; — d’autres libéraux soutiennent, au contraire, que la puissance religieuse, concentrée dans les corporations ecclésiastiques, est le plus grand et le plus redoutable des obstacles à la liberté générale, et ils tendraient à la suppression des religions. Nous comptons néanmoins de nombreux esprits, convaincus que les religions et les cultes devraient être, comme aux États-Unis, entièrement laissés à la libre activité privée, sous la réserve très expresse du respect absolu des droits communs dans les actes et même dans les tendances ostensibles, et sans aucune autre immixtion à leur égard de l’autorité politique et civile, mais il est encore fort douteux que chez nous cette opinion soit celle de la majorité. Pour les croyants catholiques romains, la liberté des peuples est soumise aux directions de leurs souverains, soumis eux-mêmes aux directions de l’Église ou du pape ; pour les catholiques russes et les musulmans, l’autorité religieuse, unie au pouvoir politique, doit diriger et dominer toutes les libertés; pour la plupart des croyants chrétiens des communions réformées, la liberté a ses règles limitatives et dirigeantes dans les prescriptions bibliques et les lois civiles se conformant à leur esprit.
Au point de vue législatif, le mot liberté comporte également une variété d’acceptions aussi peu justifiables. Les auteurs de notre Déclaration des droits de 1791 affirment que les hommes naissent et demeurent libres, ce qui n’est exact ni en fait ni en droit, car ils n’apportent en naissant que le germe de la liberté, qui ne peut se développer que par leurs propres efforts, ne le rendant plus apparent chez eux que chez les animaux qu’après une longue suite de générations, — et ils ne doivent demeurerlibres que s’ils respectent la liberté et les autres droits d’autrui. La Déclaration des droits porte encore que la liberté est le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas à autrui, définition par trop incomplète, laissant à connaître non seulement tout ce qui, dans la conduite de chacun, est nuisible à autrui, mais encore ce qui, dans les actes reconnus nuisibles à quelqu’un, peut et doit être empêché ou réprimé.
Bentham, en critiquant cette définition, fait consister la liberté dans le pouvoir de faire ce qu’on veut, le mal comme le bien, ce qui rend les lois nécessaires pour la restreindre aux actes qui ne sont pas nuisibles. Proposition qui opposerait les lois à la liberté et supposerait qu’il nous suffit de vouloir pour pouvoir. La vérité est, au contraire, que notre volonté et notre liberté ne sont rien sans pouvoir, et que les bonnes lois, loin de contredire ou de restreindre en somme la liberté, ont pour effet d’en étendre davantage la puissance acquise, en la garantissant mieux de toute atteinte chez tous également.
La plupart des jurisconsultes tombent dans une erreur ou une inadvertance analogue, en affirmant que, « dans l’état de nature, les hommes jouissent d’une liberté illimitée, tandis que, dans l’état de société, ils sont obligés de sacrifier une portion de leur liberté pour mieux conserver l’autre ». Ce qui est vrai, c’est que, dans l’état normal de société, les hommes — pris individuellement ou collectivement — ont incomparablement plus de liberté, c’est-à-dire de puissance d’agir efficacement selon leurs volontés, leurs besoins ou leurs désirs, qu’ils n’en ont à l’état sauvage appelé de nature ; on ne peut donc pas dire qu’en s’élevant à l’état civilisé, ils fassent aucun sacrifice de liberté. Pour en finir avec cette erreur généralement répandue, nous dirons encore que les arrangements sociaux, les lois conventionnelles ayant pour objet et pour effet assuré de garantir de toute atteinte la personne, la liberté, la propriété et tous les autres droits égaux de chacun et de tous — et cela en empêchant ou en réprimant ces atteintes —, loin de constituer des réductions, des sacrifices de liberté, sont au contraire l’indispensable condition de son exercice assuré chez tous également et, par conséquent, de ses développements progressifs, de l’accroissement continu de sa puissance.
Nos publicistes contemporains, et même ceux animés d’un libéralisme fort éclairé à beaucoup d’égards, ne paraissent pas se faire constamment de la liberté une idée bien nette. M. Jules Simon, dans son ouvrage sur la liberté, professe que les gouvernements ne doivent accorder des libertés aux peuples que dans le mesure où ceux-ci sont capables d’en bien user, ce qui ferait de la liberté une concession du pouvoir politique au lieu d’une faculté attachée à notre nature par son auteur, et réserverait aux hommes investis de ce pouvoir la décision sur l’opportunité de le restriction ou de l’extension de leurs attributions directrices, c’est-à-dire de leur liberté ou de leur puissance propres, ce qui ne permettrait nullement d’espérer des changements dans le sens de la restriction de ces attributions.
M. Édouard Laboulaye, l’un de nos plus éminents et de nos meilleurs esprits, dans son volume sur le Parti libéral et son avenir, affirme que, sous le régime en vigueur en France depuis la loi de 1850, l’enseignement secondaire est libre, bien qu’il y soit en réalité des plus complètement enchaînés sous l’alliance des pouvoirs politique et sacerdotal, rigoureusement exclusifs de tout enseignement libre, ou s’écartant des programmes d’études imposés par le conseil supérieur de l’instruction publique, composé de concert entre ces deux pouvoirs.
« Que se proposent aujourd’hui, dit ailleurs M. Édouard Laboulaye, la philosophie de l’histoire, l’économie politique, la statistique, sinon de chercher les lois naturelles et morales qui gouvernent les sociétés ? Entre l’homme et la nature, il y a sans doute cette différence, que l’un est libre, tandis que l’autre suit une course inflexible ; mais cette condition nouvelle complique le problème et ne le change pas. Quelle que soit la liberté de l’individu, quelque abus qu’il en fasse, on sent que celui qui nous a créés à dû faire entrer ces diversités dans son plan ; le jeu même de la liberté est prévu et ordonné. En ce sens il est vrai de dire, comme Fénelon, que l’homme s’agite et que Dieu le mène. Nos vertus, nos erreurs, nos malheurs même, tout en décidant de notre sort, n’en servent pas moins à l’accomplissement de la suprême volonté. »
L’existence des lois morales, c’est-à-dire de lois déterminant les conséquences nécessaires de notre conduite et pouvant ainsi, quand nous les connaissons, agir directement sur notre volonté, ne contredit pas plus notre liberté que l’existence des lois physiques. Nous avons sans doute à tenir compte, parmi les motifs de nos déterminations délibérées, des unes et des autres de ces lois, alors qu’elles nous sont connues ; mais une telle condition, bien loin d’infirmer la liberté, en suppose évidemment l’exercice, et il est d’expérience qu’au lieu d’y trouver obstacle, notre liberté grandit en puissance à mesure que nous connaissons et que nous observons mieux les lois, la nature des choses au milieu desquelles elle est appelée à s’exercer et qu’elle a mission d’approprier le plus possible au service de l’humanité.
Mais s’il était vrai quel’homme s’agite pendant que Dieu le mène, ou que le jeu même de sa liberté eût été prévu et ordonné par Dieu, il deviendrait radicalement impossible de croire que l’homme soit plus libre dans ses déterminations que ne le sont, dans leurs évolutions, le fruit tombant de l’arbre ou l’eau cherchant son niveau ; il faudrait nécessairement conclure que tous les actes, tous les mouvements intérieurs ou extérieurs de son intelligence et de sa conduite, sont complètement assimilables aux autres mouvements mécaniques de l’univers. La liberté, dans une doctrine admettant de telles conditions, n’existe pas plus que dans celle du matérialisme absolu : seulement, la première suppose que tout a sa cause initiale dans une force unique, intelligente, et voulant ce qu’elle fait, tandis que la seconde soutient l’hypothèse que tous les mouvements résultent de propriétés inhérentes à la matière éternelle, inconscientes de leur action et ne se rattachant à aucune volonté dirigeante. Mais la nécessité des évolutions de la vie psychologique, de l’action intellectuelle et morale des hommes, est aussi absolue, aussi inflexible dans le premier de ces deux systèmes que dans le dernier.
Il est encore à remarquer qu’en général on fractionne plus ou moins la liberté, chacun s’attachant de préférence à certaines libertés spéciales, et se préoccupant peu des autres. Tous nos partis politiques actifs s’intéressent surtout — soit pour les préconiser en général, soit pour les interdire aux adversaires — aux libertés dites politiques — celles des élections, de la tribune, des réunions, de la parole et de la presse. — Toutes les autres, qu’ils qualifient parfois de petites libertés, échappent plus ou moins à leur attention ; en sorte que l’on pourrait croire qu’ils ne considèrent comme réellement importantes que les libertés pouvant les conduire, les ramener au pouvoir gouvernemental, ou empêcher leurs rivaux de s’y maintenir.
Les économistes seuls sont pour la liberté générale des travaux et des transactions, garantie à tous également, le respect des droits communs toujours réservé, — laquelle, en y comprenant comme de raison tous les travaux s’appliquant directement à la culture de nos facultés industrielles, intellectuelles et morales, est bien près d’être la liberté tout entière. Ils s’évertuent à prêcher cette petite liberté au milieu de populations qui, en somme, ne paraissent guère se douter qu’elles aient à s’inquiéter de semblables doctrines, et sont disposées à croire qu’il s’agit là de nouveautés utopiques, puisqu’elles sont exclues des programmes de l’enseignement classique — ou en tout cas peu intéressantes pour la liberté, telle qu’on les a formées à la concevoir.
L’ensemble de ces observations suffira, sans doute, pour permettre de reconnaître combien les esprits sont loin, en France surtout, d’être près de s’entendre sur la liberté : on voit qu’il n’y a rien, dans les acceptions diverses données à ce mot, qui puisse améliorer ou doive modifier celle que nous avons proposée.
La liberté est donc bien une faculté d’initiative accordée à l’homme, dont l’usage, laissé à sa volonté, n’est pas déterminé d’avance, ni imposé par des lois fatales ; cette faculté ne peut se développer que par l’exercice de la raison, et elle grandit d’autant plus en puissance, que cet exercice est plus persévérant et mieux appliqué, c’est-à-dire qu’il étend davantage l’empire de l’homme sur la nature extérieure et sur ses propres mobiles ou entraînements sentimentaux ; elle n’intervient réellement que dans les déterminations et les actes réfléchis, délibérés.
Dans le développement collectif et salutaire de la liberté, par l’exercice de la raison, le secours des uns — ceux dont la raison est plus éclairée —, est nécessaire aux autres — ceux dont la raison est moins avancée ; mais ce secours doit être librement demandé et accordé, à des conditions respectivement consenties ; il ne doit jamais être imposé par l’autorité ou la force, car alors il met le développement intellectuel et moral de ceux qui le reçoivent à la discrétion de ceux qui le donnent, et permet à ceux-ci de faire des autres, non des hommes éclairés et libres, mais des populations trompées, dominées et asservies.
L’état social normal, c’est-à-dire celui où l’action exercée au nom et pour le compte de la société entière, est réduite à ses fonctions nécessaires et légitimes, ne fait rien perdre aux hommes de la puissance acquise de leur liberté, pas plus individuellement que collectivement ; car l’obligation du respect volontaire ou forcé de la liberté et des autre droits égaux de tous et de chacun — respect dont la garantie constitue l’objet essentiel du régime normal des sociétés — est évidemment la condition indispensable de l’exercice, en pleine sécurité, de cette liberté chez tous, et de la constance des efforts de chacun pour la développer, — en même temps que tous trouvent, dans les sociétés ainsi régies, les puissants moyens que donne l’association volontaire des efforts et des ressources, pour grandir de plus en plus la puissance d’une telle faculté.
Telle est, d’après nos convictions laborieusement acquises, la vraie notion de la liberté, au sens le plus général du mot.
Ce sens n’est-il plus le même, et la liberté change-t-elle de nature ou de caractères, si, cessant de la considérer au point de vue philosophique ou général, nous l’observons dans ses rapports avec l’un ou l’autre des grands ordres de faits qu’embrasse l’activité sociale et, par exemple, dans l’ordre économique, ou dans l’ordre moral, ou dans l’ordre politique ? Pas le moins du monde ; elle reste toujours et dans tous les cas la même, et c’est ce que nous allons établir.
IV.
Dans l’ordre économique, divers mobiles que résume le mot intérêt — l’intérêt privé ou de famille — nous poussent à tirer de nos efforts le parti que croyons le plus avantageux pour nous et les nôtres ; mais nous n’y parvenons pas autrement que par l’exercice de la raison, et toujours selon l’étendue et l’importance des lumières acquises par cet exercice ; c’est de là que surgissent les découvertes, les inventions, les perfectionnements de procédés ou de combinaisons, toutes les aptitudes ou capacités techniques, concourant à rendre notre industrie plus productive, à multiplier nos moyens d’existence, de satisfaction et d’action utile, à grandir ainsi le pouvoir de nos volontés et, par conséquent, notre liberté.
De tels résultats ne sont pas dus seulement aux développements progressifs que l’exercice de la raison donne à nos facultés industrielles et à leur pouvoir sur la nature extérieure : la domination que la raison plus éclairée parvient à établir sur nos sentiments instinctifs n’y contribue pas moins puissamment ; c’est par là, en effet, que se substituent graduellement en nous, et dans la mesure où nous exerçons davantage notre raison dans de meilleurs directions, la prévoyance active à l’inertie insouciante de l’avenir, — l’habitude des labeurs soutenus à l’indolence ou à la paresse, — la tempérance et l’économie aux appétits déréglés et dilapidateurs, — le respect de la personne, de la liberté, de la propriété, de la dignité d’autrui, dont nous reconnaissons d’autant mieux la nécessité que nous sentons plus énergiquement les droits que nous y avons nous-mêmes, — à tous les penchants qui nous pousseraient à y porter atteinte, — conditions qui, toutes, sont indispensables à l’essor et à la fécondité des facultés productives, et sans lesquelles ne pourraient se former, se renouveler et s’accroître les capitaux, l’un des éléments constitutifs de ces forces, à défaut duquel tous les autres éléments resteraient sans efficacité.
Dans cet ordre d’activités, les directions ou immixtions autoritaires contraires à la liberté des travaux et des transactions, et dès lors à la fécondité de la production et à la légitime répartition de ses fruits, consistent principalement dans l’institution de monopoles, privilèges, exemptions ou immunités en faveur des uns et au préjudice des autres ; — dans des restrictions de la concurrence nationale ou étrangère, — des obstacles ne permettant pas à tous également de se livrer à des professions utiles qu’ils auraient la volonté et la capacité d’exercer ; — dans la conversion de travaux ou de services appartenant à la libre activité privée, tels que ceux de l’enseignement et des cultes, en services gouvernementaux ; — en un mot, dans la substitution plus ou moins étendue des directions de l’autorité aux activités dont elle doit se borner à garantir la liberté, sous la seule réserve du respect des droits communs, et qu’elle ne saurait régir elle-même qu’en apportant inévitablement, dans l’ordre économique, les perturbations les plus dommageables et souvent les plus funestes, — troublant la naturelle harmonie que la liberté, également assurée à tous, peut seule y maintenir, — favorisant d’illégitimes intérêts privés aux dépens de l’intérêt commun, — multipliant les spoliations légales, — provoquant les antagonismes entre les diverses classes, — réduisant la fécondité productive et développant l’iniquité des répartitions, — dans la mesure où ses directions s’étendent davantage et altèrent plus profondément la liberté.
C’est encore et uniquement dans l’exercice de la raison, aussi généralisé que possible, et appliqué à l’étude des conséquences de telles perturbations économiques et de leurs causes modifiables, que les sociétés peuvent trouver les moyens le plus sûrement efficaces de s’en préserver ou de s’en délivrer.
V.
Dans l’ordre moral, la liberté résulte principalement de la subordination de nos mobiles sentimentaux ou instinctifs à notre raison, aux lumières et à la prévoyance que son exercice nous permet d’acquérir.
Si les lois morales ne consistaient qu’en des commandements imposés par des dominations sacerdotales comme émanant de Dieu même, et variant d’ailleurs d’une religion et d’une secte à l’autre, la liberté serait remplacée par l’obéissance passive, et la raison n’aurait plus de mission ; nous ne serions plus, sous aucun rapport, des êtres perfectibles par leurs propres efforts, et la morale ne pourrait pas plus devenir une science que le catéchisme de nos évêques.
Mais s’il en est autrement ; si les directions sacerdotales du brahmanisme, du bouddhisme, du judaïsme, du mahométisme, du christianisme, avec ses trente à quarante communions diverses et plus ou moins opposées entre elles, ne sont pas plus d’ordre divin que toutes les autres erreurs de l’esprit humain, ou tous les autres mensonges servant à fonder des dominations, asservissant à des corporations, à des castes, à des dynasties, toute la liberté humaine ; — si, comme nous en avons la conviction la plus profonde, notre raison s’exerçant sur les données de l’expérience et de l’observation, est le seul guide que nous ayons reçu du divin auteur de notre nature, pour améliorer progressivement notre conduite ; — si, enfin, et comme nul esprit lucide ne saurait le contester, le véritable but de notre existence, de notre épreuve en ce monde, est le perfectionnement de nos facultés natives, dans le sens du développement de leur puissance utile et bienfaisante, de l’amélioration et de l’élévation de la vie humaine sous tous les rapports, — la morale peut constituer une science aussi positive et aussi progressive que d’autres, — se développant dans la mesure où, par l’exercice de notre raison, nous connaîtrons mieux toutes les conséquences de nos tendances et de nos actions, et où cette connaissance, rapportée au but de notre existence tel que nous venons de le signaler, nous permettra de discerner plus sûrement ce qui est bien ou mal dans la conduite de chacun et de tous, par suite nos devoirs et nos droits, qui ne sauraient être des sentences ou des maximes inventées par les différents docteurs, mais uniquement des connaissances positives, acquises ou à acquérir, sur ce que nous avons tous à observer et à faire observer, pour que notre conduite privée et collective ne s’écarte que le moins possible des voies du perfectionnement humain.
Ainsi que l’a démontré Charles Comte, dans son Traité de législation, la liberté est la condition indispensable de l’exercice de ces droits et de l’accomplissement de ces devoirs ; car si notre conduite ne dépendait en rien de notre libre volonté, ou qu’elle fût réglée par des lois fatales ou par Dieu même, dans toutes ses évolutions, elle ne comporterait pas plus de devoirs et de droits pour nous que n’en comporte, pour la terre, son mouvement annuel autour du soleil ; — et si, étant libres par nature, nous sommes dépouillés de notre liberté par nos semblables, hors le cas où nous avons mérité d’en être privés en violant, chez autrui, les droits communs à tous, nous perdons évidemment la faculté d’user de nos droits et de remplir nos véritables devoirs, d’autant plus que notre volonté est plus dominée, plus enchaînée.
Dire que nous avons à exercer des droits et à remplir des devoirs, c’est ne rien dire, tant que ces devoirs et ces droits ne sont point déterminés ; — dire que leur détermination se trouve dans la conscience de chacun, est une fausseté démentie par tous les faits, et cessant d’avoir cours dans les esprits qui, surmontant l’habitude d’y croire et de la répéter sans examen, veulent y donner la moindre attention ; — dire qu’elle nous est révélée par la parole de Dieu et par ses interprètes, c’est évidemment abandonner à ceux-ci le soin de la fixer, et la rendre aussi incomplète, aussi confuse, aussi divergente ou contradictoire qu’elle l’est dans les différentes révélations et dans les diverses interprétations comparées à cette parole.
La vérité est que la détermination des droits et des devoirs devient plus exacte et plus complète, à mesure que nous exerçons mieux notre raison, — que nous parvenons à mieux connaître toutes les conséquences bonnes ou mauvaises de notre conduite privée et collective, — à mieux distinguer celles qui servent et celles qui nuisent à notre amélioration commune, — à constater plus sûrement ainsi à ce qui est de droit et de devoir pour tous, — enfin, à mieux lutter contre les obstacles qu’opposent à notre perfectionnement les mobiles instinctifs, les sentiments, les passions, l’ardeur de la domination chez les uns, l’inertie, l’ignorance, les erreurs ou le défaut de courage chez les autres. Et n’est-il pas vrai qu’aussi bien dans l’ordre moral que dans l’ordre économique, ce n’est qu’au prix d’efforts, de luttes, du travail constant et généralisé de la raison, que nous parvenons à grandir notre liberté avec la puissance collective de nos volontés, à perfectionner nos facultés, notre conduite morale et politique, à améliorer dans le sens le plus élevé la vie humaine ?
Quelle aberration déplorable, quelle fatale erreur n’est-ce donc pas de méconnaître, dans toute cette partie si importante de notre activité, la tâche laborieuse qui incombe à tous, d’aliéner à cet égard, et pour ainsi dire à perpétuité, à d’autres hommes non moins faillibles que nous, notre liberté, notre raison, nos sentiments, — toutes nos évolutions religieuses, morales ou sociales ; — de provoquer en quelque sorte, par une crédulité tout enfantine, la fondation des dominations sacerdotales, les plus funestes de toutes les dominations, dès qu’elles parviennent à se servir d’autres armes que la persuasion, — les plus opposées à toute aspiration de notre personnalité mentale vers les lumières intellectuelles, — à tout progrès salutaire des hommes et des sociétés !
N’est-il pas reconnu et constaté par tous nos observateurs des civilisations orientales que ce sont de telles dominations qui, chez les brahmanes de l’Hindoustan, maintiennent depuis quarante à cinquante siècles le régime des castes absolument inconciliables avec toute civilisation ascendante, parce qu’il fait perpétuellement vivre les unes aux dépens des autres, et ne permet pas aux plus accablés de songer seulement à s’élever au-dessus de leur position ; — qui, partout où règne le bouddhisme, c’est-à-dire chez le tiers environ du genre humain, généralisent et perpétuent la doctrine du renoncement, du dédain de la vie présente, de l’aspiration au repos dans une sorte d’anéantissement éternel appelé nirvana, doctrine évidemment des plus opposées à tout progrès, et ayant, depuis le septième siècle de notre ère, rendu stationnaire, puis rétrograde, la civilisation chinoise ? Ne faut-il pas encore attribuer à de telles dominations les superstitions grossières jusqu’à ramener le fétichisme, qui n’ont cessé de se développer dans le brahmanisme, le bouddhisme, et aussi dans l’islamisme, où elles constituent, avec la croyance au fatalisme, le despotisme politico-religieux et la polygamie, les principales causes de cette décadence irrémédiable des civilisations musulmanes, à laquelle nous assistions ?
Les dominations sacerdotales et les directions morales du christianisme ont-elles été moins pernicieuses que celles du brahmanisme, du bouddhisme et de l’islamisme ? Nous le pensons, mais seulement des premiers siècles du christianisme — où son sacerdoce ne dominait pas — et les directions améliorées qu’il a reçues, depuis deux à trois siècles seulement, chez les nations ayant adhéré, en majorité, aux réformes protestantes. À part ces réserves, les dominations sacerdotales qu’il a fondées, ont produit et produisent encore incomparablement plus de mal que de bien ; elles ne se sont pas montrées les moins hostiles à la liberté et à tout progrès, à tout perfectionnement réel de l’esprit humain ; depuis leur alliance aux dominations politiques, au quatrième siècle de notre ère, elles n’ont cessé, partout où leur pouvoir leur a paru solidement établi, de faire prévaloir les sentiments, l’imagination, l’habitude sur la raison, — de substituer les cérémonies, les pratiques, les superstitions abrutissantes aux enseignements moraux animés d’une ardente charité du christianisme primitif — et de s’assujettir assez les esprits pour les soustraire à toute lumière intellectuelle opposée à leurs prescriptions. Ces insidieuses directions ont été constamment manifestes dans le catholicisme romain ; la raison est devenue pour cette domination une ennemie détestée, et lorsque ces révoltes lui ont paru menacer l’orthodoxie, l’unité de la foi qu’elle avait imposée, elle n’a reculé devant aucune cruauté, aucune atrocité pour la maîtriser, l’accabler, et c’est par dizaines de millions qu’il faut compter les victimes humaines qu’elle a sacrifiées à cette affreuse et sanglante idole de l’unité religieuse.
On peut reconnaître aujourd’hui le résultat de ses directions, là où elles ont le plus longtemps régné sans partage, et par exemple dans les difficultés extrêmes et peut-être insurmontables qui s’opposent à la régénération de l’Espagne et des républiques espagnoles de l’Amérique du Sud, — dans les superstitions idiotes, substituant de plus en plus au christianisme évangélique, le fétichisme de la Vierge, des saints et des reliques, — se multipliant et se diversifiant sans cesse chez tous les fermes croyants catholiques romains et dans les grandes masses des populations russes.
En France même, où, depuis près de deux siècles, la croyance aveugle et la domination sacerdotale étaient allées s’affaiblissant, le clergé romain, ayant conservé son alliance avec les restes de l’ancienne aristocratie privilégiée et très habilement exploité les terreurs hallucinées qu’avaient inspirées de stupides manifestations socialistes à une bourgeoisie enrichie, mais malheureusement trop peu éclairée généralement, et qui s’était montrée fort au-dessous de la tâche qui lui échut en 1830, — s’unit à ces deux classes après 1848, afin de déterminer, à l’aide de l’engouement populaire pour le nom de Napoléon, l’avènement du second empire, l’un des régimes les plus démoralisants et les plus funestes qui aient pesé sur nous, et dont la chute honteuse, loin d’intimider ses fondateurs cléricaux, semble avoir achevé de donner aux évêques, comptant sur leurs anciens et nouveaux alliés, l’impudente et criminelle audace de dévoiler publiquement leurs desseins politiques, n’allant à rien moins qu’à rétablir en France les régimes antérieurs à 1789, — le monarque de droit divin, absolu, sous la direction de ses confesseurs, consultant, quand bon lui semble, les trois ordres : la noblesse, le clergé, privilégiés et exempts d’impôts, et le tiers état, écrasé de charges et admis à faire entendre ses doléances, — les règnes de Louis XIV, de Charles IX ou de François Ier !
On voit à quels dangers s’exposent les sociétés plus ou moins civilisées, se laissant dépouiller par indolence, ignorance, captation ou lâche pusillanimité, du droit et du devoir de chercher et déterminer par elles-mêmes les directions morales et politiques qu’elles ont à suivre, et cela, par le libre examen, par le libre exercice de la raison de tous, le libre enseignement des lumières qu’il permet d’acquérir, — et combien il leur importe de se délivrer pour le présent, en se préservant pour l’avenir, des directions imposées par les dominations sacerdotales ou politiques, partout où elles sont parvenues à se fonder.
VI.
Dans l’ordre politique, enfin, la vraie notion de la liberté, celle qui la fait consister dans l’exercice de notre raison, soumettant de plus en plus à celle-ci, dans la mesure des lumières qu’il lui fait acquérir, toute notre conduite, ne ressort pas avec moins de certitude que dans l’ordre économique ou dans l’ordre moral.
Pour le reconnaître, il faut d’abord se demander quel est, chez les peuples civilisés de notre temps, l’objet réellement nécessaire et légitime de l’organisation politique ou de l’institution des gouvernements. La science économique affirme et prouve que cet objet est essentiellement de procurer à tous la sécurité indispensable à l’activité et à la fécondité des facultés productives et accumulatrices, en garantissant à chaque famille, à chaque individu, le libre exercice de ces facultés et la libre disposition des propriétés qui en sont le fruit, et cela, dans toute l’étendue des limites où leur activité ne porte aucune atteinte aux mêmes libertés, aux mêmes droits chez les autres. Elle démontre, ensuite, qu’au moyen de ces garanties, les lois économiques inhérentes à la nature de l’homme et des choses suffisent à placer l’activité des populations dans les meilleures directions que puisse comporter leur degré d’avancement industriel, intellectuel et moral. Elle démontre encore que ce degré d’avancement s’élève dans la mesure où le fonctionnement normal des lois économiques naturelles, lequel n’est autre que celui de la liberté également garantie à tous, éprouve le moins de perturbations. Enfin, elle conclut de ces démonstrations que la mission utile et légitime des gouvernements étant essentiellement d’instituer et d’appliquer les garanties dont il s’agit, n’est nullement de DIRIGER les développements des facultés et de l’activité des populations, ce qu’ils ne peuvent faire sans violer leurs libertés et leurs propriétés, sans dénaturer ces développements et les écarter plus ou moins de la voie normale, celle du perfectionnement général des facultés, — celle des civilisations ascendantes. Il n’est pas aujourd’hui d’économiste, au niveau des connaissances acquises dans cet ordre d’investigations, qui ne soit entièrement convaincu de ces grandes et salutaires vérités.
Il faut, ensuite, rechercher quels sont les obstacles qui s’opposent à l’efficacité constante de ces garanties de la propriété et de la liberté, que notre imperfection morale, les inégalités et les vicissitudes inévitables des situations particulières, rendent et rendront probablement toujours indispensables aux sociétés.
Ces obstacles ne peuvent évidemment consister que dans l’insuffisance ou le mauvais emploi, ou dans l’abus des forces destinées à assurer de telles garanties.
Il n’y a, et il ne saurait y avoir insuffisance, chez une nation, que lorsqu’elle est exposée à des luttes avec d’autres nations, ou lorsqu’elle compte elle-même une proportion très considérable d’individus disposés à porter atteinte, par la violence ou la fraude, à la liberté ou à la propriété d’autrui, et que les forces mises à la disposition de son gouvernement ne sont pas réellement assez puissantes pour maîtriser ou réprimer toutes les tendances ou activités perturbatrices, ou bien encore si les forces protectrices, suffisantes en elles-mêmes, n’ont pas toute l’efficacité qu’elles pourraient avoir, faute d’une direction assez énergique ou assez intelligente pour en tirer tout le parti possible.
Les cas d’insuffisance des forces mises à la disposition des gouvernements pour maîtriser ou réprimer,à l’intérieur, les atteintes aux personnes, à la liberté et aux propriétés, sont devenus fort rares en Europe, où l’on pourrait à peine en signaler un seul chez lequel la répression de ces atteintes emploie plus d’une faible partie des forces dont dispose le gouvernement, ce qui prouve que le gros des populations comprend aujourd’hui que de telles atteintes iraient se multipliant sans cesse, si elles n’étaient pas réprimées, et qu’il serait dès lors impossible de travailler et de vivre en sécurité. Les luttes internationales sont malheureusement fréquentes encore ; mais les populations européennes reconnaissent de plus en plus qu’elles n’ont qu’à y perdre, et qu’il est insensé et absurde de s’imposer un tel fléau ; leurs gouvernements, même les plus dominateurs, commencent enfin à sentir quelle redoutable responsabilité ils encourent, en entretenant seuls, au milieu des civilisations actuelles, ce reste affreux de la sauvagerie.
Il y a abus, et c’est le cas de la plupart des États modernes de l’Europe, lorsque les forces destinées à garantir la liberté, la propriété et les autres droits communs, sont détournées, en plus ou moins grande partie, de cette destination, par les gouvernements qui en disposent, c’est-à-dire lorsqu’ils s’en servent pour étendre sans cesse leurs attributions et leur pouvoir, pour régir les travaux ou services et les transactions appartenant légitimement à la libre activité privée, tels que ceux relatifs aux cultes religieux, à l’enseignement général, aux productions agricoles, manufacturières, extractives, commerciales, — et aux échanges internationaux, — et qu’ils s’évertuent à multiplier le plus possible l’armée de leurs auxiliaires, de leurs soutiens, corporatifs et autres, destinés à garantir, non plus la liberté et la propriété de chacun, mais le maintien de ces pouvoirs usurpés. Dans de telles voies, les gouvernements ne se trouvent jamais nantis d’assez de forces ; ils en accumulent le plus possible, ne s’inquiétant nullement de multiplier de la sorte les classes parasites, affaiblissant d’autant les forces productives, — sacrifiant progressivement celles-ci à la puissance et à l’action gouvernementales, — absorbant de plus en plus la société dans l’État, — et s’appliquant ainsi, qu’ils en conviennent ou non, à déterminer la décadence des civilisations soumises à de tels régimes.
Mais où faut-il chercher des moyens efficaces d’empêcher de tels abus des forces gouvernementales, de triompher de ces obstacles à la liberté et à la prospérité des nations, de ces véritables et redoutables fléaux ?
Il est certain que ces moyens ne se trouvent pas ailleurs que dans un exercice énergique et soutenu de la raison individuelle, chez tous ceux qui peuvent plus ou moins s’y livrer, appliqué à la recherche des conséquences inhérentes à l’action gouvernementale prenant de telles voies, recherche qui les convaincra bientôt que les sociétés ne sauraient se laisser entraîner à des directions plus pernicieuses et plus funestes. Une telle conviction, devenant progressivement plus générale et plus énergique, finirait par constituer une force défensive contre laquelle les intérêts pervers ne pourraient plus espérer de lutter avec succès. Ce n’est pas là, sans doute, un moyen d’un effet rapide, et son efficacité sera plus lente à se manifester, là où la généralité des esprits est plus dépourvue des lumières qu’il s’agit d’acquérir ; mais, comme c’est le seul sûrement efficace, il n’y a pas lieu d’en chercher d’autres.
La propagation, généralisée le plus possible, des lumières déjà acquises sur ce sujet, et l’exercice énergique de la raison pour accroître ces lumières ou les rendre plus saisissantes, sont évidemmentles seuls moyens efficaces de dissiper l’ignorance et les erreurs, de maîtriser les passions dominatrices et cupides, qui ont favorisé ou provoqué jusqu’ici les développements et la persistance de tous les abus des forces gouvernementales.
Ce sont les seuls moyens de réussir à mettre au ban de l’opinion tout ce qui soutient de tels abus, — l’asservissement de la raison aux directions captieuses qui égarent les sentiments religieux en les rendant hostiles à la liberté, — et toutes ces autres aberrations sentimentales, servant aux dominations politiques à maintenir de formidables armées permanentes, sous prétexte de pourvoir aux éventualités de guerre, telles que les ineptes animosités internationales passant pour du patriotisme, — l’engouement pour la gloire ou la fanfaronnade militaire, — les prétentions à la prépondérance, à la suprématie sur les autres nations, — les stupides et pernicieuses admirations pour toutes les fausses grandeurs, — pour l’éclat et le faste dont s’entourent les gouvernements dominateurs, sans frein ni contrôle efficaces, dilapidateurs des forces et des ressources communes, — pour cette série de personnages puissants que les poètes, les historiens, les intérêts pervers et la niaiserie générale ont fait grands, parce qu’ils ont pu faire litière à leur monstrueux orgueil de la liberté, de la dignité, du sang et des ressources des nations.
Ce sont, enfin, les seuls moyens de parvenir à renfermer les gouvernements dans leur mission nécessaire et légitime, en les dépouillant de toutes les attributions qu’ils ont usurpées aux dépens de la liberté générale.
Charles Comte a montré que la liberté politique consiste dans la suppression de toutes les conditions concourant à fonder l’esclavage ou la servitude. De notre temps, ces conditions à supprimer, chez les nations qui veulent être libres, sont surtout celles donnant aux hommes investis de l’autorité ou du pouvoir politique, en dehors et au-delà de leur mission nécessaire, la direction du développement des facultés et de l’activité utile des populations, ainsi que l’ont toujours fait, à l’égard de leurs esclaves, les possesseurs de ce genre de propriété, partout où elle a été admise ; ce n’était pas, bien entendu, dans l’intérêt de leurs esclaves qu’ils les dirigeaient ainsi, mais uniquement pour rendre cette propriété plus productive ; seulement, à l’exemple des propriétaires de bestiaux, et à l’inverse des dominateurs politiques, laïques ou religieux, ils se chargeaient de la nourriture et de l’entretien de ces troupeaux.
Mais une vérité qu’il importerait de mieux comprendre qu’on ne le fait communément en France, c’est qu’il faut nécessairement que les erreurs et les pernicieuses directions que nous avons rappelées, soient dissipées, ruinées dans les esprits, et remplacées par des lumières opposées, et qu’un tel changement soit devenu assez général pour fonder une opinion réformiste dominante, — avant que ces progrès de la raison commune puissent se réaliser et se maintenir dans les faits. Jusque-là, le mécontentement public pourra susciter de nouvelles révolutions, renverser des gouvernements, en rétablir d’autres ; mais à quelque forme ou organisation gouvernementale que l’on veuille recourir, et quelque loyales et éclairées que puissent être les intentions des hommes qui auront le plus contribué au mouvement, l’abus des forces de l’autorité politique continuera à se développer dans une direction ou dans une autre, tant qu’on n’aura pas arraché les racines qu’elle a implantées dans l’ignorance, les erreurs, les sentiments, les préjugés et les enseignements trompeurs régnant encore dans nos institutions et dans la pensée du grand nombre ; la fréquence de nos révolutions et contre-révolutions, à part et depuis celle de 1789, et les résultats qui les ont suivies, auraient dû suffire pour nous édifier complètement et définitivement à cet égard.
Il est donc bien certain qu’ici encore la liberté n’existe, ne se développe ou ne s’affranchit que par l’exercice de la raison, dans la mesure des lumières que cet exercice nous fait acquérir, et où ces lumières, dirigeant plus entièrement nos mobiles et toute notre conduite, rendent de plus en plus difficilement praticable l’abus des forces gouvernementales, en le montrant clairement aux esprits partout où il se produit, et en soulevant contre lui tous les intérêts légitimes qui en souffrent.
L’expérience donne d’ailleurs à cette conception générale de notre liberté la confirmation la plus éclatante : de nos jours, les populations les plus libres et les plus prospères sont généralement celles qui ont le plus pratiqué, encouragé, provoqué l’exercice de la raison, soit en religion, soit en politique ; ce sont les populations protestantes de la grande union américaine, de la plus grande partie de la Suisse, de la Hollande, de l’Angleterre et de l’Allemagne. Les civilisations les moins libres et les plus arriérées sont celles où l’exercice de la raison a été le plus proscrit, le plus limité ou entravé par les dominations politiques et religieuses, — celles de la Turquie, de l’Espagne, de la Russie, de l’Amérique espagnole, etc.
On peut trouver, dans ces observations sur la liberté humaine, les principales indications permettant d’expliquer les différences si considérables que l’on reconnaît entre les divers degrés d’avancement des sociétés ayant depuis longtemps franchi les stages de la vie sauvage ou pastorale. Ces sociétés sont loin d’avoir fait un usage identique de leur liberté : chez les unes, l’exercice de la raison a été plus affranchi de contraintes ou de directions autoritaires, plus généralisé, plus persévérant et plus salutairement appliqué ; chez les autres, il a été plus ou moins asservi à des dominations militaires, monarchiques ou sacerdotales, qui l’ont dirigé au profit de leurs intérêts propres, en lui interdisant le plus possible toute voie pouvant le conduire à des lumières de nature à menacer ses intérêts. Cela explique suffisamment la diversité dans l’étendue et l’importance des progrès que les différentes nations ont respectivement réalisés. Ainsi que nous venons de le rappeler par quelques désignations, celles où l’exercice de la raison a été le moins entravé d’obstacles politiques et religieux, le plus actif, le plus répandu et le mieux appliqué, sont les plus progressives ; celle ou il a été le plus asservi, le plus délaissé, ou le plus fourvoyé dans les voies de mensonge et d’erreur, sont relativement stationnaires ou rétrogrades[2].
AMBROISE CLÉMENT.
___________
[1] La définition de la liberté par l’idée de puissance, n’est plus nouvelle depuis Locke, Condillac, de Tracy, etc. ; Charles Dunoyer a parfaitement établi que la puissance est l’essence même de la liberté (De la liberté du travail, tome 1, p. 23 à 43) ; la plupart de nos vocabulaires la donnent comme un pouvoir de faire et de ne pas faire ; pourtant, dans la plupart des dissertations morales et politiques que l’on écrit tous les jours, ce sens est généralement méconnu, par la confusion de la volonté et de la puissance. D’un autre côté, on n’avait pas encore, à notre connaissance, montré que la liberté ne se développe et ne grandit que par l’exercice persévérant de la raison.
[2] Extrait d’un ouvrage sous presse intitulé : Le bon sens dans les doctrines morales et politiques.


Laisser un commentaire