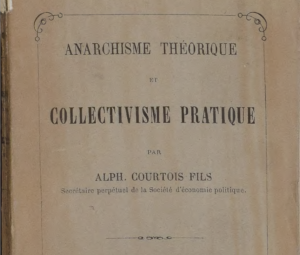 Pour lutter contre le développement des idées socialistes, qu’il présente comme l’exact opposé des vérités démontrées de l’économie politique, Alphonse Courtois étudie dans cette brochure leurs fondements et leurs modes de réalisation. L’étude des principaux auteurs de ce courant — Karl Marx, F. Engels, Schäffle — montre que derrière un anarchisme théorique (l’État disparaissant en théorie avec la fin de la société de classes), se trouve un collectivisme pratique, dont les moyens tyranniques laissent prévoir une immense déchéance à la nation qui aurait l’imprudence d’appliquer le socialisme à la mode de ces auteurs.
Pour lutter contre le développement des idées socialistes, qu’il présente comme l’exact opposé des vérités démontrées de l’économie politique, Alphonse Courtois étudie dans cette brochure leurs fondements et leurs modes de réalisation. L’étude des principaux auteurs de ce courant — Karl Marx, F. Engels, Schäffle — montre que derrière un anarchisme théorique (l’État disparaissant en théorie avec la fin de la société de classes), se trouve un collectivisme pratique, dont les moyens tyranniques laissent prévoir une immense déchéance à la nation qui aurait l’imprudence d’appliquer le socialisme à la mode de ces auteurs.
ANARCHISME THÉORIQUE ET COLLECTIVISME PRATIQUE
Par ALPH. COURTOIS FILS
Secrétaire perpétuel de la Société d’économie politique.
PARIS
GUILLAUMIN ET CIE, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE RICHELIEU, 14
1885
PRÉFACE
Si l’économie politique est encore peu connue, des masses surtout, les doctrines arbitraires du socialisme le sont encore moins, sans cela le raisonnement le plus sommaire eût fait justice de cette nature d’erreurs, tant les sophismes mis en avant par les chefs d’école de cet ordre d’opinions sont grossiers.
Nous avons cru devoir prendre corps à corps les deux écoles qui comprennent peut-être le plus d’adhérents dans les classes peu ou incomplètement lettrées tout au moins, les anarchistes et les collectivistes, et nous nous sommes attaché à puiser nos armes dans le bon sens plus que dans la critique dogmatique.
Réussirons-nous à convaincre ceux de nos lecteurs qui cherchent la vérité avec conscience ? Nous n’avons pas le droit de le dire à l’avance ; du moins pouvons-nous affirmer que si nous avons combattu ce qui, pour nous, est l’erreur avec l’énergie d’une vieille conviction, résultant d’études persévérantes, nous nous sommes efforcé de ne pas oublier la tolérance que l’on doit aux opinions adverses émises de bonne foi et avec désintéressement.
Nous avons cru devoir introduire, sous forme d’annexe, à la fin de cet opuscule, ce que nous disions le 5 février dernier à la Société d’économie politique, au sujet des attributions économiques de l’État. Il nous a semblé qu’en face des opinions des anarchistes et des collectivistes, relativement au fonctionnement de ce rouage, aussi nécessaire que l’estomac chez l’animal, il était bon, pour compléter, d’indiquer par des grandes lignes comment l’envisage l’économie politique.
L’AUTEUR.
INTRODUCTION
L’ÉCONOMIE POLITIQUE ET SON CONTRAIRE : LE SOCIALISME.
Y a-t-il un bon et un mauvais socialisme ? Cette question est utile à élucider. Combien, en effet, rencontrez-vous d’esprits bien disposés, mais ayant peu étudié la question, qui vous disent : « Je suis contre le socialisme, c’est-à-dire contre le mauvais socialisme, car il y a un bon socialisme qui devrait rallier tout le monde. Que de bonnes choses j’ai lues dans des ouvrages socialistes, d’où on pourrait les extraire avec profit pour les appliquer. » Et l’interlocuteur d’énumérer une série soit d’impossibilités généreuses, soit de vérités qu’il ne se doute pas extraites, de mémoire si ce n’est littéralement, des ouvrages des maîtres de la science économique.
Pour répondre à cette question, il nous faudrait d’abord dire ce qu’est le socialisme.
Je ne passerai pas en revue la foule de définitions que l’on a données de ce mot. Littré, dans son principal monument, son Dictionnaire, dit que l’on appelle ainsi « tout système qui, subordonnant les réformes politiques, offre un plan de réformes sociales ». À ce compte, les économistes seraient des socialistes. C’est faire la part belle à l’erreur.
Victor Hennequin, un socialiste convaincu pourtant, le définissait : « Une réunion de doctrines plus ou moins complètes et en dissidence sur plusieurs points graves. » C’était sévère.
Un autre socialiste, M. Benoît Malon, un érudit dans son genre, considère cette branche des erreurs du cerveau humain, dans la préface de son Histoire du socialisme, comme « la recherche d’un état social meilleur —nous redevenons tous socialistes en ce cas — ou la revendication justicière contre les classes dominantes successives »: nous retombons dans le vague et nous aurions besoin de savoir ce que sont les classes dominantes ; le reste de l’ouvrage de M. Benoît Malon ne nous l’apprend que trop : c’est le propriétaire, c’est le bourgeois, c’est le patron !
Puisque les définitions abondent et que leur nombre résulte de la diversité des opinions des auteurs sur le fond, risquons la nôtre. Une de plus ou de moins, on n’y prendra pas garde.
Le socialisme, c’est l’envers de l’économie politique, l’opposé des vérités de cette science, l’erreur, en un mot.
Est-ce bien là une définition, nous dira-t-on, puisqu’elle en suppose une autre : celle de l’économie politique ? Et puis ! n’est-ce pas constituer l’économie politique en dogme, en religion orthodoxe, en acte de foi, plus que de réflexion ?
Voyons ; élevons-nous un instant, en pensée, au-dessus de l’humanité, dans ces régions sereines où tout n’est que vérité, où règne la raison pure.
Qu’est-ce que l’économie politique, si ce n’est l’ensemble des lois, déjà connues ou encore à découvrir, mais existant en tout cas, qui régissent l’humanité au point de vue de l’utile ? On n’aura plus de peine, en ce cas, à admettre notre définition du socialisme, à savoir que c’est l’erreur par opposition à la vérité économique.
Eh bien ! ces lois, nous sommes à leur recherche ; nous en connaissons déjà une partie ; la découverte des autres se fera avec le temps. Chaque année voit s’augmenter notre bagage scientifique. Voyez les progrès accomplis de la secte des Économistes, les Physiocrates, à Smith, de ce dernier à J.-B. Say, puis à Dunoyer, à Garnier, à Bastiat, à nos jours enfin, et dites si l’économie politique ressemble à une religion immuable, qui s’impose par la foi et non par la raison, elle qui se modifie, s’améliore, progresse enfin.
Eh bien ! sila science économique, telle que les hommes la font, est mobile, par suite de son imperfection et non par sa nature propre, le socialisme, tel que les hommes le font, est mobile pour les mêmes raisons.
Quoique ayant le sentiment de cette approximation de nos connaissances économiques, nous n’entreprendrons pas, avec moins de liberté, la critique, au point de vue de nos connaissances actuelles, des systèmes socialistes contemporains.
Nous nous adressons à des esprits qui se livrent à des études sérieuses et non à des néophytes disant amenà toutes nos affirmations. Nous parlerons en conscience et après étude des maîtres, quoique en disciple indépendant, et nous estimerons avoir ainsi hâté, à tous nos lecteurs, l’accession de la vérité pour l’ordre de connaissances qui nous occupe. Et voilà pourquoi, sans poser la science que nous cultivons en dogme religieux, sans proclamer son infaillibilité, nous ne craignons pas de qualifier le socialisme, dont nous entreprenons l’histoire moderne, d’erreur économique.
Et cependant nous devons encore introduire une réserve que chacun appréciera. Devons-nous, en effet, traiter d’idée socialiste toute opinion économique différente de la nôtre ? Eh quoi ! nous appellerions socialiste celui qui ne penserait pas comme nous sur l’unité ou la diversité de l’impôt, sur la préférence à accorder aux contributions directes sur les droits indirects, ou vice versà, sur le régime des banques de circulation, etc. Oh non ! un classement si absolu friserait l’outrecuidance et serait de l’intolérance. Nous les appellerons, et bien modestement encore, des dissidents, sachant qu’ils ne le sont que par rapport à notre opinion actuelle et pensant qu’il n’est pas impossible qu’un jour nous nous rangions à la leur.
Où s’arrêter alors ? À quels caractères distinguer le dissident du socialiste ?
À celui-ci :
Le premier étudie avec méthode ; il se sert avec discernement des travaux de ceux qui l’ont précédé ; ne fait pas prétentieusement table rase, ne date pas la science de son arrivée ; il n’accuse pas d’imbécillité, avec Fourier, les vingt siècles qui l’ont précédée ; il n’affirme pas, avec Proudhon, qu’il ne se dit pas en mille ans un mot comme celui auquel il doit sa triste célébrité ; il n’invective pas comme Lasalle ; il ne pontifie pas comme Enfantin, Comte, Cabet, Pierre Leroux ou Karl Marx ; il expérimente, cherche, en s’aidant des travaux de ses prédécesseurs, les vérités économiques, et quand il croit en avoir trouvé une, il la divulgue avec modestie, attendant le verdict du monde savant pour monter au Capitole et le plus souvent même laissant àla postérité le soin de déposer une couronne sur sa tombe, si la réalisation de son affirmation se confirme avec le temps.
La méthode du dissident est scientifique ; celle du socialiste est empirique, si tant est qu’il juge utile d’en avoir une. Intelligence naïve ou audacieux charlatan, voilà le socialiste ; le dissident, au contraire, nous invite à revoir prudemment la route parcourue ensemble, pour savoir si nous ne nous serions pas égarés en prenant, dans quelque carrefour, un chemin autre que celui qui nous menait à la vérité. On saisira la différence, toute d’appréciation sans doute, mais fort réelle cependant, entre les deux ordres d’opposants ànos doctrines.
L’ANARCHISME THÉORIQUEET LE COLLECTIVISME PRATIQUE
I
L’ANARCHISME THÉORIQUE.
Il ya fagots et fagots ; il y a anarchistes et anarchistes.
Ily a l’anarchiste des rues, des réunions publiques, qui injurie, blesse, tue, puis fuit et disparaît pour reparaître et recommencer. Celui-là est gibier de police correctionnelle ou decour d’assises. Le gardien de la paix et le gendarme le mettent à la raison. Il a fait peur au bourgeois, mais un instant seulement. Il cherche à affoler la population laborieuse et possédante ; mais, la première impression passée, il est oublié, lui et ses propos incendiaires ou assassins. Le danger de ses actes est temporaire et circonscrit.
Mais l’anarchiste (convaincu ou non d’ailleurs, c’est là une affaire de conscience) qui ne s’adresse qu’au raisonnement ou au sentiment, nous effraye davantage ; non que nous croyions à la possibilité d’un succès final de sa part, mais nous redoutons des troubles sérieux, économiquement parlant, des crises, et des crises intenses et poignantes. Ce n’est pas l’anarchisme en lui-même qui nous effraye, ce sont les conséquences qu’il amène, le désordre, anarchique cette fois, qu’il suscite dans l’esprit des ignorants, légion nombreuse, surtout en fait de science économique même élémentaire.
C’est pour ces derniers et non pour les théoriciens de l’anarchisme que nous prenons la plume.
Seulement, comme la vérité est une et l’erreur multiple, le champ d’étendue de cette dernière est illimité ; force nous est, pour être pratique, de nous borner, choisissant l’œuvre où l’auteur aura le mieux su résumer d’une manière claire et complète les idées dont nous voulons faire l’examen critique, en même temps qu’il se sera concilié la confiance de ses coreligionnaires en science économique.
À coup sûr, Frédéric Engels, le compagnon de Karl Marx, est le plus à même de répondre à notre desideratum. Son œuvre dernière, Unwalzung der Wissenschafte (Bouleversement de la science), a le mérite de formuler dogmatiquement et de résumer clairement les idées du parti anarchiste, de ceux qui écrivent et parlent avec calme tout au moins ; les socialistes de cette nuance l’approuvent, le citent, conseillent la lecture de son ouvrage. Pour le mieux répandre, un traducteur de talent, M. Paul Lafargue[1], a choisi dans cet ouvrage les parties appartenant au domaine économique et les a publiées in extenso sous le titre de : Socialisme utopique et Socialisme scientifique. Grâce à l’auteur allemand et à son traducteur français, nous pouvons, sans grande fatigue, parcourir cet édifice imaginaire, en juger l’économie, en apprécier la solidité ; grâce à eux, nous pourrons, la science éclairant le bon sens, reconnaître la fragilité de ces théories, appelées à disparaître au moindre souffle pratique, la vanité de ces prétentions philosophiques que la logique la plus sommaire ou l’expérience la plus limitée renversera sans qu’il en reste è l’avenir la moindre trace, si ce n’est dans l’histoire des erreurs économiques.
Entrons en matière sans plus tarder et prenons le taureau par les cornes, débutant par la critique, qui est la base, la pierre angulaire de l’anarchisme, pour ne parler que de lui en ce moment.
« Le capitaliste, alors même qu’il paye la force-travail de l’ouvrier à la valeur réelle que, comme marchandise, elle a sur le marché, extrait néanmoins d’elle plus de valeur qu’il n’a donné pour l’acquérir ; cette plus-value constitue, en fin de compte, la somme des valeurs d’où provient la masse du capital sans cesse croissante, accumulée dans les mains des classes possédantes. La manière de procéder de la production capitaliste, ainsi que la production du capital sont ainsi expliquées[2]. »
Ainsi donc, suivant Frédéric Engels, l’ouvrier, même sous le régime de liberté économique absolue, en recevant le salaire fixé par le libre jeu de la loi de l’offre et de la demande, ne perçoit pas intégralement la part qui lui est due pour sa coopération à la production.
Par celui qui l’emploie, qui le fait travailler, qui requiert son concours, par le capitaliste, comme on dit de nos jours, par le patron, comme on disait il y a peu de temps et comme disent encore de nos jours les socialistes attardés, il lui est indûment retenu une forte part qui grossit, si elle ne constitue pas intégralement, la part de ce dernier.
C’est du moins, nous plaçant au point de vue de l’auteur précité, ce qui se passe de nos jours, sous l’empire de ce que, depuis Karl Marx, on est convenu, dans le monde socialiste, d’appeler la production capitaliste, le vol de l’employeur au préjudice de l’ouvrier donnant ainsi naissance au capital.
Il en résulte que le capitaliste devient de plus en plus riche, et l’ouvrier de plus en plus pauvre.
Le capitaliste, en effet, accapare tous les instruments de production. Il tient donc, en ses mains, le sort, si ce n’est la vie, de l’ouvrier dont il limite le salaire, l’abaissant au minimum, s’il ne le peut au-dessous, des moyens d’existence de ce dernier, et cela grâce à la concurrence qui lui permet de le réduire à sa plus simple expression, c’est-à-dire de le « fixer au bas niveau qui seul satisfait le capitaliste[3]».
Comment se fait-il que l’ouvrier ne puisse obtenir qu’une partie seulement de ce qui lui revient, la liberté absolue, c’est-à-dire l’absence de monopoles artificiels, étant supposée le régime existant?
Le voici :
« L’ordre social actuel est la création de la classe actuellement dominante, la bourgeoisie. Le mode de production propre à la bourgeoisie, désigné depuis Marx du nom de production capitaliste, était incompatible avec l’ordre féodal, avec les privilèges de localité et d’états, avec les entraves des corporations et du servage. La bourgeoisie brisa l’ordre féodal pour établir, sur ses ruines, l’ordre bourgeois, le règne de la concurrence libre, du libre choix de domicile, du contrat libre, de l’égalité devant la loi et autres aménités bourgeoises (sic). Dès lors, libre carrière était ouverte à la production capitaliste. Au temps de la grande révolution française, la forme prédominante de cette production capitaliste, sur le continent européen dumoins, était la manufacture basée sur la division du travail. Mais dès que la vapeur et la machine-outil eurent transformé cette manufacture en grande industrie, les forces productives élaborées, sous la direction de la bourgeoisie, se développèrent avec une rapidité et sur une échelle inouïes. La manufacture, parvenue à un certain degré de développement, dut forcément entrer en conflit avec les entraves féodales des corporations : de même la grande industrie doit, dans son complet développement, entrer en conflit avec le mode capitaliste de production[4]. »
De là résulte, et Engels le développe tout au long, que jadis, il y a longtemps de cela, chacun produisait pour soi-même. Il n’y avait pas d’échanges, parce que les besoins rudimentaires se contentaient de la production individuelle. On payait bien un droit, un tribut, au seigneur, qui, en retour, protégeait le travailleur ; mais, « en ceci il n’y avait pas d’échange[5]».
À qui réfléchit un peu, tout ceci apparaît comme fort inexact. À quelque époque que l’on remonte, même des milliers d’années antérieurement au régime féodal auquel Engels fait allusion, le producteur ne pouvait faire directement face à l’ensemble de ses besoins avec sa propre production. Que le marché fût limité, d’accord; mais que, dans la limite étroite du bourg, il n’y eût pas d’échanges, que la division du travail ne se soit pas déjà répandue, cela est plus qu’improbable ou mieux cela est impossible. L’admettant cependant, payer le seigneur pour qu’en retour il vous protège (pour la plupart des cas, c’était comme la corde qui soutient le pendu), cette protection, c’est déjà échanger.
Passons :
Le bourg se développe ; la ville conquiert ses franchises. On ne produit plus seulement pour soi, pour sa consommation personnelle ; on produit pour les autres, on échange. Ce que l’on échange, c’est ce que les socialistes appellent par excellence marchandises. « Cet excédent offert à l’échange devient marchandise[6]. »
« La production en vue de l’échange était dans son enfance ; donc l’échange était limité[7]. » Jusqu’alors c’était la consommation qui donnait le branle à la production, qui la commandait. Demandes actives, production stimulée. Raréfaction des demandes, ralentissement de la production. Avec l’écrivain socialiste dont nous nous occupons, c’est la production qui gouverne la consommation. Il suffit de produire pour activer la consommation ou mieux les échanges. — Mais les produits, dira-t-on, s’échangent contre des produits, donc l’accroissement de la production entraîne celui de la consommation. — Cela est vrai d’une manière générale, et après avoir consulté, comme guide, les besoins de la consommation ; or ce n’est pas ainsi que l’entendent MM. les socialistes. La production doit déterminer elle-même son intensité et sa direction, et la consommation doit obéir à cette impulsion. C’est la théorie du travail méritoire, rien que parce qu’il est effort et abstraction faite de l’utilité.
Continuons :
Cependant la production en vue de l’échange, la production des marchandises se développe. La petite industrie, protégée par les corporations, fait place, après la disparition de ces dernières, à la grande ; le métier cède la place à la fabrique[8], la fabrique à la manufacture. L’usine se fonde. « Les moyens de production d’individuels deviennent sociaux[9]. » Les gros mangent les petits. «Le champ de travail devient un champ de bataille[10]», chaque développement se faisant aux dépens de ce qui est remplacé. La lutte éclate. Le besoin d’ouvriers se fait d’autant moins sentir que les procédés industriels progressent et se perfectionnent. « Si l’introduction et la multiplication des machines signifiaient le remplacement de millions d’ouvriers manuels par quelques milliers d’ouvriers servants de machines, perfectionnement du machinisme signifie déplacement constant de ces servants de machines et, en dernier lieu, la création d’un nombre d’ouvriers en disponibilité excédant les besoins moyens du capital[11]. »
Voilà une affirmation que l’histoire de l’industrie a catégoriquement démentie à plusieurs époques. Nous n’en rappellerons que deux, dont les résultats sont trop éclatants pour ne pas nous dispenser de longs développements. L’imprimerie d’abord, qui utilise une quantité de bras innombrable, comparativement à l’ancien procédé des manuscrits, et les chemins de fer, qui ont accru en nombre le personnel occupé de transports, hommes et choses, dans une proportion qu’il serait oiseux de rechercher, et tout cela sans compter le bénéfice si considérable que, comme consommateurs, les ouvriers en ont retiré sous un autre rapport.
Passons toujours :
Le progrès se développe sous la production capitaliste. « La loi qui toujours équilibre, dit Karl Marx à son tour, le progrès et l’accumulation du capital et de la surpopulation relative, rive plus solidement le travail au capital que les coins de Vulcain ne rivaient Prométhée à son rocher. C’est cette loi qui établit une corrélation fatale entre l’accumulation du capital et l’accumulation de la misère, de telle sorte qu’accumulation de richesses à un pôle, c’est égale accumulation de pauvreté, de souffrance, d’ignorance, d’abrutissement, de dégradation morale, d’esclavage au pôle opposé, du côté de la classe qui produit son propre produit sous forme de capital[12]. »
L’erreur contenue dans le passage qui précède est trop souvent répétée par tel ou tel socialiste pour ne pas appeler de suite sa rectification. À l’état de liberté absolue (c’est celui où nous nous sommes placé dès le début de ce travail), l’accroissement de la richesse chez les uns emporte l’amélioration progressive de la situation des autres. Nous n’en sommes plus au temps où la richesse consistait par excellence à posséder des écus, emmagasinés dans un coffre, où on les prenait au fur et à mesure des besoins, comme certain héros du Gil Blas de Lesage. Posséder est une profession ; il faut exploiter soi-même ou placer la fortune que l’on a acquise par son travail ou celui des siens. Par lui même ou par les autres, le riche commandite le travail et, plus il est riche, plus il lui en faut commanditer. Ce ne sont plus seulement, ce qui est déjà vrai, ses consommations personnelles qui activent le mouvement du travail ; c’est encore la fructification de sa fortune. Être entouré de riches est, pour le pauvre laborieux, une certitude de sortir d’embarras, d’arriver à l’aisance, parfois à la fortune, à son tour. Loin que le pauvre devienne d’autant plus pauvre que le riche devient riche, loin que les lignes de destinées de ces deux extrêmes suivent une direction symétriquement contraire, on peut dire qu’il y a dans l’amélioration du sort des uns et des autres un parallélisme qui lie fraternellement le sort du pauvre à celui du riche, qui intéresse coopérativement le premier aux succès du second. Il n’y a que l’absence de liberté économique, la pratique des monopoles artificiels qui altèrent ce parallélisme, et cela, nous l’avouons, au détriment du premier. Mais nous avons admis l’état de liberté économique absolue, idéal dont tout ordre social doit constamment chercher à se rapprocher.
Reprenons :
« L’énorme force d’expansion de la grande industrie » sous le régime de la libre concurrence, c’est-à-dire de la production capitaliste « en comparaison de laquelle celle des gaz n’est qu’un jeu d’enfant, se présente maintenant sous la forme d’un besoin qualitatif et quantitatif d’expansion, qui défie toute compression. La compression ici, c’est la consommation, le débouché, le marché des produits de la grande industrie. Mais la capacité d’expansion du marché, extensive et intensive, est contrôlée par des lois différentes et d’un effet bien moins énergique. L’extension du marché ne peut aller de pair avec l’extension de la production. La collision est inévitable, et comme elle ne peut amener de solution à moins de briser la forme capitaliste de la production, cette collision devient périodique. C’est là un nouveau cercle vicieux dans lequel se meut la production capitaliste[13]. » — Encore une erreur fondamentale à rectifier avant d’aller plus loin, mais sans nous arrêter à la comparaison faite au début avec la force physique d’expansion des gaz, assez déplacée ici.
Proudhon lui-même admettait, avec J.-B. Say et ses disciples, que les produits s’échangent contre des produits. Que, dans une industrie spéciale, un accroissement inconsidéré de production, c’est-à-dire dépassant la demande de la consommation, amène des pertes, et, par suite, une crise, rien d’extraordinaire ; cela même est logique. Mais il en est autrement quand il s’agit de la production en général, de la production distribuée librement, donc intelligemment, en raison des demandes du marché. Alors tout essor de la production est favorable, puisqu’il engendre, par voie d’échange, des demandes en nombre, quantité et qualité, équivalent.
On produit, supposons-nous, pour 15 milliards ; donc il y a pour 15 milliards de demandes. La coordination de la production, en raison des demandes, peut avoir quelque peine à se faire ; mais, à l’état libre, l’intérêt personnel aidant, elle se fait, et cela d’autant plus rapidement que s’efface l’intervention gouvernementale, sécurité à part. Mais, dira-t-on, les 15 milliards de production peuvent n’avoir pas, n’ont certainement pas, pour objet unique, la consommation ; on en capitalise une partie. Sans doute ; mais cette capitalisation, qui est le vrai progrès social, n’a pas pour objet de laisser dormir les capitaux formés.
Ils rentrent dans la bataille industrielle ; ils commanditent de nouvelles productions, acquièrent des outils, machines, immeubles ; s’utilisent comme fonds de roulement, et constituent des acheteurs, des consommateurs dont la production a dû prévoir l’éclosion pour mieux faire cadrer la répartition industrielle avec la réalité de l’ensemble des besoins. L’extension du marché, à l’inverse de ce qu’affirment Fréd. Engels et Karl Marx, va donc de pair avec l’extension de la production. Qu’il y ait, çà et là, des frottements dans cette évolution, personne n’en doute. Ce sont là les frais généraux du mouvement d’expansion, frais généraux que supportent les moins prévoyants, les moins intelligents ; mais le fait général, c’est 1’équivalence absolue, à l’état de liberté complète, de la production, même progressive, à quelque degré qu’on la suppose parvenue, avec la consommation.
Les crises, que notre auteur regarde trop complaisamment comme accompagnement périodique de la production capitaliste, ne sont dues, à part les accidents de la nature, qu’à des fautes de prévoyance ou d’intelligence des producteurs. À eux de les éliminer à force de perspicacité et en utilisant leur expérience.
Reprenons les choses au point et dans les conditions supposés d’accord où les a laissées Fréd. Engels :
La production capitaliste conduit au chaos, à l’anarchisme, surtout laissée à elle-même ; c’est de toute évidence!
Évident également que l’ouvrier seul pâtit de cette situation imméritée.
De propriétaire, au Moyen-âge, des instruments de production, il est devenu salarié par occasion sous le régime intermédiaire des corporations ; la production capitaliste de « salarié d’un jour » l’a fait « salarié sa vie durant[14]».
Le capitaliste en est-il plus heureux ? « Il y a anarchie dans la production sociale[15]. L’économie des frais de production se caractérise par la dilapidation la plus effrénée de la force du travail et la lésinerie la plus éhontée des conditions de son perfectionnement » (Karl Marx)[16]. La périodicité des crises est un fait chronique et due à la libre concurrence. On la vu plus haut ; c’est la lutte organisée, la guerre du capital au salariat. « La grande industrie et l’établissement du marché international ou mondial ont universalisé ces luttes et leur ont imprimé une violence inouïe. La possession de conditions favorables de production naturelles ou artificielles décide de l’existence de capitalistes isolés aussi bien que d’industries et de nations entières. Les vaincus sont refoulés sans pitié. C’est la concurrence vitale darwinienne transplantée de la nature dans la société avec une violence puissanciée. La sauvagerie animale se présente comme dernier terme de développement humain. L’antagonisme entre production sociale et appropriation capitaliste a pris la forme d’antagonisme entre organisation de la production dans chaque fabrique particulière, et anarchie de la production dans la société tout entière[17]. »
Ainsi déperdition de forces, oppression des uns par les autres, lutte, ruse, fraude, « anarchie » enfin ; voilà les conséquences de la libre concurrence.
Anarchie ! le mot est dur. Admettons-le cependant avec Fr. Engels. Comment sortir de là ?
« Brisez la forme de production capitaliste, permettez aux moyens de production de fonctionner sans prendre la forme de capital, et l’absurdité qui existe dans les faits disparaît et vous rendez à la société la possibilité de vivre[18]. ».
C’est vague. Continuons ; nous serons peut-être plus heureux : « L’appropriation par l’État des forces productives n’est pas la solution du conflit, mais elle en contient les éléments[19]. » Poursuivons alors : « Cette solution ne peut être autre que la recognition pratique de la nature sociale des forces productives modernes, c’est-à-dire la mise à l’unisson des modes de production, d’appropriation et d’échange, avec le caractère social des moyens de production. Et ce but ne sera atteint que lorsque la société, ouvertement et franchement, prendra possession des forces productives devenues trop puissantes pour supporter tout autre contrôle que le sien[20]. »
Ouvertement et franchement ! cela laisse à penser. Admettons les moyens doux et raisonnons dans cette hypothèse.
On remarquera que l’auteur dit « la société » et non « l’État » ; ce n’est pas sans intention. « L’État est la représentation officielle de toute la société, son incarnation dans un corps visible, mais il ne l’est que tant qu’il est l’État de la classe qui représente la société tout entière. Du moment qu’il deviendra réellement le représentant de la société tout entière, il sera inutile. Dès qu’il n’existera plus de classe à maintenir dans l’oppression, dès que la domination de classe, la lutte pour l’existence basée sur l’anarchie de la production, les collisions et les excès qui en découlent seront balayés, il n’y aura plus rien à réprimer, l’État deviendra inutile. Le premier acte par lequel l’État se constituera réellement le représentant de toute la société — la prise de possession des moyens de production au nom de la société — sera, en même temps, son dernier acte comme Etat. Le gouvernement des personnes fera place à l’administration des choses et à la direction des procédés de production.La société libre ne peut tolérer l’existence d’un État entre elle et ses membres[21]. »
Avec l’anarchisme, on le voit, la patrie disparaît pour être remplacée par l’humanité. N’est-ce pas demander trop de perfections à l’homme ? Ne rentre-t-on pas ici dans l’utopie, dont l’auteur avait la prétention de sortir ?
Cette remarque faite, reprenons ; nous en sommes arrivé, on s’en souvient, aux voies et moyens que l’auteur explique ainsi : « Reconnaissance pratique du caractère social des forces productives, cela veut dire remplacement de l’appropriation capitaliste, engendrant le régime dans lequel le produit asservit d’abord le producteur, puis l’appropriateur, par une appropriation basée sur la nature même des forces productives modernes. Appropriation directe des produits d’un côté par la société comme moyens d’entretenir et de développer la production, et de l’autre par les individus comme moyens d’existence et de jouissance[22]. »
« Dès que la société aura pris possession des moyens de production, elle ne produira plus de marchandises, c’est-à-dire qu’elle mettra fin à la forme de l’appropriation des produits en vertu de laquelle le produit domine le producteur. L’anarchie dans la production sociale fera place à une organisation consciente et systématique. La lutte pour l’existence individuelle disparaît. L’humanité sortira enfin du règne de la fatalité pour entrer dans celui de la liberté[23]. »
Ce serait bien beau, si c’était vrai. Il y a cependant une ombre à ce tableau. L’auteur dit, en effet, quelque part, esquissant à sa manière la production capitaliste : « Là où le travail social ne fournit qu’une somme de produits excédant à peine ce qui est strictement nécessaire pour maintenir l’existence de tous, là où le travail, par conséquent, absorbe tout ou presque tout le temps de la grande majorité des individus dont se compose la société, cette société se divise nécessairement en classes. À côté de cette grande majorité vouée exclusivement au travail, il se forme une minorité exempte du travail directement productif et chargée des affaires communes de la société : direction générale du travail, gouvernement, justice, sciences, arts, etc[24]. »
Qu’est-ce à dire ? Que les administrateurs et hommes d’État, même les magistrats, n’aient pas pour objectif un travail directement productif, c’est-à-dire utile, cela se comprend en Anarchie ; mais les savants, les artistes ne seraient-ils pas des producteurs directs ? Non ; en Anarchie, le travail manuel, très estimable, sans aucun doute, sous tous les régimes, est ici supérieur à celui des Arago, des Raphaël, des Lamartine, des Rossini, etc. La prédominance des forces physiques sur les forces intellectuelles, voilà l’avenir en Anarchie.
Proudhon mettait les deux genres de forces sur le même pied ; ses disciples font pencher la balance en faveur de la force brutale. Nous ne dirons pas ici qu’ily a progrès.
Et, puisque nous parlons de Proudhon, ce père de l’An-Archisme, rappelons-nous ce qu’il disait dans l’Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle.
« Ce que nous mettons à la place du gouvernement, c’est l’organisation industrielle.
Ce que nous mettons à la place des lois, ce sont les contrats. Point de lois votées ni à la majorité ni à l’unanimité ; chaque citoyen, chaque commune ou corporation fait la sienne[25].
Ce que nous mettons à la place des pouvoirs politiques, ce sont les forces économiques.
Ce que nous mettons à la place des classes de citoyens, bourgeoisie et prolétariat, ce sont les catégories et spécialités de fonctions : agriculture, industrie, commerce, etc.
Ce que nous mettons à la place de la force publique, c’est la force collective.
Ce que nous mettons à la place des armées permanentes, ce sont les compagnies industrielles.
Ce que nous mettons à la place de la police, c’est l’identité des intérêts.
Ce que nous mettons à la place de la centralisation politique, c’est la centralisation économique.
L’apercevez-vous maintenant cet ordre sans fonctionnaires, cette unité profonde et tout intellectuelle ?
… Eh bien, à notre tour, qu’avons-nous besoin de gouvernement là où nous avons fait l’accord ?
… Ne demandez donc plus ni ce que nous mettrons à la place du gouvernement ni ce que deviendra la société quand il n’y aura plus de gouvernement, car, je vous le dis et je vous le jure, à l’avenir, il sera plus aisé de concevoir la société sans le gouvernement que la société avec le gouvernement[26]. »
Onze ans plus tôt, le même publiciste avait dit : « Je suis anarchiste. — An-Archie, absence de maître, de souverain, tel est le gouvernement dont nous approchons tous les jours ! Quoique très ami de l’ordre, je suis anarchiste[27]. »
Voilà donc la théorie de l’anarchisme aussi savamment expliquée que possible par ses divers partisans les plus autorisés. On se demande comment des esprits aussi distingués, d’ailleurs, que les auteurs que nous avons pris à partie ont pu s’engager dans la fausse route qu’ils ont courageusement parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la culbute intellectuelle. C’est que le point de départ était erroné. Erronée également la méthode adoptée.
Eh quoi ! vous prenez comme unité l’homme, cet être complexe, si différent de lui-même, individu par individu. L’ouvrier ! le capitaliste ! sont-ils simples ou composés, même en se restreignant au côté économique ?
Analysons-les ; qu’y trouvons-nous ? Des éléments divers, si ce n’est contradictoires, et qui veulent, chacun d’eux, une étude spéciale, obéissant à des lois distinctes.
L’homme est producteur, sans aucun doute. Sans cela, comme il a des besoins et que la Providence ne lui a pas dévolu les avantages dont jouissent les animaux (triste compensation, d’ailleurs, de leur horizon borné), il ne tarderait pas à succomber et l’humanité périrait dès son apparition.
Il est producteur ! Aiguillonné par le besoin, il veut et s’ingénie à contraindre la nature à se plier à ses désirs, à contribuer à son utilité.
Il commande d’abord à ses facultés — physiques, sentimentales ou intellectuelles — et en fait son premier outil.
Il prend ensuite possession de la nature extérieure à lui — forces mécaniques, chimiques ou physiques. — À sa volonté (impuissante à elle seule) se joint, sous ses impérieuses et inéluctables exigences, la nature intime (le moi) et la nature extérieure.
S’il en restait là, il vivrait au jour le jour, sans amélioration dans son sort, en butte aux éventualités défavorables, qui, n’ayant pas de contre-parties, décimeraient sa race jusqu’à extinction définitive. Il utilise alors, dans un sentiment de conservation bien naturel, des résultats antérieurs de la jouissance desquels il se prive pour faire mieux et plus le lendemain ; c’est la loi du progrès.
Et il a ainsi les trois facteurs de la production : la volonté ou le travail ; — la nature intime et extérieure, ou, plus rapidement, la nature ; — et le capital produit réservé à une production ultérieure et condition indispensable du progrès.
Chaque homme a donc en lui ou à côté de lui trois éléments fort différents : Travail — Nature — Capital, dont la coopération est indispensable pour tout produit matériel ou immatériel, pour la nourriture physique du corps comme pour les jouissances les plus relevées de l’intelligence et du cœur.
Voilà où l’analyse économique de l’homme nous conduit, et, faute de la méthode analytique que, dans les sciences naturelles ou philosophiques, on s’est habitué peu à peu à mettre en pratique, de crainte de voir, comme au Moyen-âge, le temps se perdre en discussions oiseuses, faute de méthode analytique, disons-nous, les socialistes de toutes nuances se sont gravement fourvoyés.
Ils ont nié, à l’état de liberté absolue, l’efficacité de l’offre et de la demande, pour établir le taux légitime du salaire. Ils ont méconnu cet aphorisme humoristique de Cobden : « Quand deux ouvriers courent après un patron, les salaires baissent ; quand deux patrons courent après un ouvrier, les salaires montent. » L’expérience leur en a-t-il, tout au moins, fait trouver un autre ? À quoi bon, il est vrai ? Ils nient à l’intelligence son droit à une part dans la production. L’ouvrier manuel est seul méritant, seul productif. À ce compte, tout lui revient ; pas n’est besoin de faire un partage et de chercher une loi pour fixer les droits de chacun. Il a plus que la part du lion, puisque, encore une fois, il a tout.
On comprend que, dans ces conditions, ils regardent le capital, dans l’état de choses actuel, dans la production capitaliste, comme une spoliation ; la disposition de son produit, comme un vol. Il est vrai qu’ils ne prennent pas le mot capital avec sa signification habituelle dans le langage économique. Ils le détournent de son sens usuel. Ils eussent dû alors créer une nouvelle expression ; ce ne sont pas les néologismes qui leur coûtent. Un de plus ou de moins, qu’importe. Ah ! mais ! c’est qu’alors il leur eût été plus difficile de surprendre la bonne foi du public. Vendre une marchandise à soi sous l’étiquette d’un autre est plus commode ; on profite d’un marché établi, d’une clientèle formée, d’une marque connue et répandue.Où est, en ce cas, le vol, intellectuellement parlant ?
Les socialistes ne considèrent donc d’abord le capital que sous sa forme tangible, matérielle. Vous avez acquis de l’adresse, consolidé votre santé au lieu de passer votre temps à jouir de la vie ; ce n’est pas du capital. Le capital, chez eux, doit être essentiellement transmissible ; sans cela, pourrait-on en déposséder le détenteur actuel ?, premier acte qui suivrait l’avènement du socialisme.
Et puis, le capital a, aux yeux des socialistes, une source différente de celle que nous lui avons reconnue en économie politique. Pour nous, le capital, c’est le résultat de l’épargne ; c’est une privation en vue d’une amélioration ultérieure de notre sort. Il est méritoire dans sa source, légitime dans sa possession, équitable dans sa productivité. Pour le socialiste qui attribue tout ou à peu près tout dans la répartition de la valeur du produit au travailleur manuel, à celui qu’il appelle par excellence l’ouvrier, c’est la dépouille du pauvre prolétaire.
Cette méthode crée un imbroglio que, encore une fois, nous nous permettrons de trouver d’une bonne foi douteuse. C’est ainsi qu’en agissaient jadis les disciples du fameux Escobar.
Un publiciste de talent, économiste à ses heures, M. Émile de Laveleye[28], a dit de l’œuvre si vantée de Karl Marx, Das Capital : « Ce n’est certes pas à cet ouvrage que Marx doit son influence, car il n’est pas fait pour être lu par le peuple. Il est aussi abstrait qu’un traité de mathématiques et il est d’une lecture bien plus fatigante. C’est un vrai casse-tête, parce qu’il se sert de termes pris dans un sens particulier, et qu’il construit, de déduction en déduction, tout un système sur des définitions et sur des hypothèses. Il faut une tension constante de l’esprit pour suivre des raisonnements où les mots sont toujours détournés de leur signification habituelle. » Un économiste avec les idées duquel nous ne formulerons pas, à beaucoup près, les mêmes réserves que pour l’auteur des lignes ci-dessus, a complété l’appréciation de l’œuvre de Karl Marx par ces paroles, auxquelles nous nous associons volontiers : « Le principal écrivain socialiste contemporain, Karl Marx, si mordant, si subtil, si implacable dans la critique de l’ordre économique existant, ne formule pas, ex professo, un système social qu’on puisse et qu’on doive lui substituer. C’est seulement de temps à autre, presque accidentellement ou sous la forme d’épisode, que des idées positives apparaissent chez lui, brèves, médiocrement précises et nettes au milieu de la critique destructive[29]. » On en peut dire autant de Lasalle, qui ne proposa qu’un expédient : la constitution d’ateliers commandités par l’État, et qui fut même désavoué par Marx à ce sujet.
Un dernier point reste à traiter pour en finir avec l’Anarchisme théorique. On prétend (on l’a vu plus haut par les citations empruntées à Frédéric Engels et Karl Marx, son maître), on prétend, disons-nous, que l’ouvrier n’est pas libre sous le régime de liberté absolue que nous avons supposé et qu’il le serait une fois réalisée l’anarchie, c’est-à-dire une fois le renversement de l’État, chargé, seul chargé, de la sécurité, individus et propriété. On suppose que cette liberté promise n’existera que du jour où chacun sera son gendarme, et, je ne dirai pas son juge, puisqu’on ne peut se faire justice soi-même, mais son vengeur (ce qui, par parenthèse, est peu moral). « L’humanité, pour rappeler les termes de Fr. Engels, sortira enfin du règne de la fatalité pour entrer dans celui de la liberté. »
Certes, si l’on entend par liberté, non l’égalité de droits, la seule digne de notre poursuite, mais l’égalité sous le rapport des avantages naturels ou sociaux, la seule que semblent apprécier et rechercher les théoriciens de l’anarchisme, on ne peut dire qu’il y ait ombre de liberté ici-bas, et l’on peut ajouter qu’il n’y en aura sous aucun régime, sauf sous celui de la misère. Mais l’égalité et la liberté sont deux principes différents et l’on peut être libres, quoique inégaux ; il suffit que les droits de chacun soient respectés ; riches ou pauvres sont libres à cette condition. Or, du moment que les lois économiques sont basées sur le respect absolu des droits de chacun, abstraction faite des inégalités de nature, soit physiques, soit intellectuelles, ne peut-on dire que l’on vit sous le règne de la liberté ?
Et ce régime continuerait-il d’exister du jour où la force ne serait plus bridée que par la conscience individuelle ? Cette conscience, supposant qu’on lui laissât toute liberté d’appréciation, qu’on ne la soumît ni aux passions ni aux habitudes prises, serait-elle suffisamment éclairée pour que chacun pût avec rectitude conformer ses actes au droit naturel, à la morale, à la justice ? Ne voit-on pas les lumières différer d’une cour de justice à une autre ? Que sera-ce si chacun constituait, dans sa propre cause, un tribunal sans appel ?
Si Proudhon était, comme il l’affirmait, très ami de l’ordre (et sa vie privée prouve, en dépit de ses doctrines, qu’il l’était), il ne pouvait être anarchiste, quoi qu’il en ait dit, car l’anarchisme, c’est le désordre à sa plus forte expression ; le despotisme, c’est-à-dire l’absence de liberté à sa plus haute puissance.
II
LE COLLECTIVISME PRATIQUE
……………
— Vous n’êtes qu’un collectiviste !
— Collectiviste ! Moi ! dont toute la fortune, résultant de l’épargne journalière, est placée en rentes, en obligations et actions de société, et constitue en conséquence une propriété parfaitement individuelle, Dieu merci !
— Oui, vous n’êtes qu’un collectiviste, mais un collectiviste sans le savoir ; vous faites, en tant qu’électeur et par les soins de vos mandataires, MM. les sénateurs et députés, du collectivisme en détail et inconsciemment, tout comme M. Jourdain faisait de la prose, sans s’en douter, et bientôt, vous ou vos héritiers, vous vous réveillerez dans un milieu complètement transformé et où vous n’aurez plus d’autre ressource, si vous ne voulez vous soumettre à sa nouvelle forme, qu’à vous expatrier, sans biens, sans avoir, nu comme un petit Saint-Jean.
………..
Cette conclusion peu avenante me semblait, en tous cas, quelque peu empreinte d’exagération ; ce n’est pas d’aujourd’hui que l’État est sur la pente économique à laquelle mon interlocuteur faisait allusion, et cependant il y a encore des propriétaires. Et puis le collectivisme… Ah, mais au fait ! qu’est-ce que le collectivisme ?
…………………
…………………
Les collectivistes prétendent descendre du baron Colins, qui, lui, prétendait descendre de Charles le Téméraire. Il n’en faut, néanmoins, pas conclure que le collectivisme remonte au-delà de 1835, époque où Colins publia le Pacte social.
Colins, né à Bruxelles en 1783, fut militaire sous le premier empire et militaire distingué, non pas seulement par son courage, mais par son intelligence pratique. Cela ne l’empêcha pas, par une de ces inconséquences si familières à l’humanité, de se bercerde rêves philosophiques et économiques. Ainsi, il croit certes à l’éternité de l’âme, mais il la fait voyager, à chaque décès, d’un monde à un autre, comme le fit également plus tard Fourier.
En économie politique, Colins prône la propriété collective de la matière première et des instruments de travail.
En politique, il ne veut qu’un chef pour toute la terre, un chef élu au suffrage universel. Ce chef, qui a le titre de maire, nommera les chefs du pouvoirexécutif de chaque nation, qui, eux, désigneront les chefs des provinces, et ceux-ci des villes. Cela rappelle Siéyès.
Constantin Pecqueur est aussi un père de l’Église collectiviste. Né dans le Nord également (n’a-t-on pas dit que c’est de là que nous vient la lumière ?), à Arleux, en 1801, il fit différents ouvrages qui ne laissaient pas absolument prévoir la République de Dieu, qui parut en 1844, et où l’auteur se prononça pour l’absorption par l’État des matières premières et des instruments de production.
Ces deux publicistes moururent dans la même année (1857).
Enfin, le troisième pèredu collectivisme est François Vidal, qui eut plus conscience que les précédents des conséquences de ses idées. Ancien fouriériste, il a l’avantage d’être clair et précis. Il est aussi pour la propriété collective, s’occupant spécialement de l’industrie agricole, qu’il semble considérer comme la vraie, si ce n’est l’unique source du travail humain. Les bénéfices nets, d’après ce néo-physiocrate, sont partageables par quart entre l’État, un fonds de secours et d’assistance, une réserve constituée en vue d’aider les autres ateliers sociaux en détresse, enfin les travailleurs à raison du nombre de leurs journées de travail.
L’État rachèterait tous les autres ateliers particuliers de production, ne demandant, pour sa part, que l’intérêt du capital déboursé. « La rétribution, conclut Vidal en traitant de la répartition des produits selon les socialistes, ne doit pas être nécessairement la même pour tous, puisque les besoins peuvent être inégaux ; elle doit être et elle sera un jour sans doute proportionnelle aux besoins et non proportionnelle aux œuvres et à la capacité, encore moins proportionnelle au capital[30]. »
Comme à l’ordinaire, l’auteur ne doute pas que, par la substitution de la fraternité à l’intérêt personnel, la production donnera des bénéfices nets assurés ; et cela malgré les prévisions pessimistes des esprits — étroits sans doute — qui croient que, toutes les journées de travail ayant un égal traitement, leur qualité tendra, non à progresser, mais à s’abaisser au niveau de ceux qui travaillent le moins et le plus mal.
Quant aux preuves, Vidal ne s’attarde pas à en produire.
Vidal, né en 1812 à Coutras, fut secrétaire de la fameuse Commission des travailleurs qui fonctionna, comme chacun sait, en 1848, au Luxembourg, sous la présidence de Louis Blanc. Nous ignorons l’année de sa mort.
Entre ce publiciste et les collectivistes actuels ou contemporains, Karl Marx et Lasalle particulièrement, il y a solution de continuité. Il est même bien souvent difficile de reconnaître lafiliation. La méthode change ; elle se subtilise et devient singulièrement métaphysique, quand elle n’est pas trop passionnée pour respecter les frontières de la raison.
Karl Marx et Ferdinand Lasalle sont socialistes d’une manière plus générale que spéciale. On ne peut les considérer comme anarchistes, ni même comme collectivistes. Ils ont contribué à préparer aux autres le terrain de l’erreur par leurs raisonnements subtils (Karl Marx) ou leurs allocutions sophistiques (Ferdinand Lasalle). Les auteurs du Capital et de la Lettre ouverte sont des précurseurs ; en anarchisme, Frédéric Engels, en collectivisme, M.Schäffle, ont formulé des dogmes.
Nous avons suivi le premier dans le dédale où il se perd, pourvu, que nous étions, à titre de fil d’Ariane, des enseignements des maîtres de la science économique ; nous allons nous attacher semblablement aux pas oscillants du second, jusqu’à ce que sa chute éclatante dessille les yeux de tout lecteur non prévenu.
Albert-Erhard-Frederik Schäffle (ou Schæffle), nous apprend son consciencieux et fidèle traducteur M. Benoît Malon, est né dans le Wurtemberg en 1831. Il professa l’économie politique (la sienne sans doute) aux universités de Tubingen et de Vienne, et fut chargé des départements de l’agriculture et du commerce en Autriche, sous le ministère assez éphémère (il ne dura queneuf mois) de Hohenwart.
Il a fait d’assez nombreux ouvrages sur les doctrines qu’il a professées, et ses travaux l’ont mis, dans l’opinion publique du monde socialiste, en tête des hommes militants. D’ailleurs, cela flattait les penseurs de cet ordre de voir leurs opinions professées par un homme de gouvernement, un ancien ministre. « Tel est l’homme, s’écrie M. Benoît Malon avec enthousiasme, tel est le savant, que sa tradition, son milieu, son intérêt devaient retenir dans la bourgeoisie, et que sa science et sa bonne foi ont amené au socialisme collectiviste[31]. »
Hélas ! Combien amère doit être actuellement la déception des chefs du collectivisme. M. Schæffle est un parjure, un renégat !
C’est ce que nous a appris tout récemment M. Arthur Raffalovich, qui, passant en revue les œuvres économiques de M. Schäffle, signale un nouveau travail de cet auteur consistant, sous le titre de Die aussichtslosig keit der Social demokratie (Inanité du Socialisme démocratique), en trois lettres adressées à un homme d’État autrichien[32]. Dans cette œuvre nouvelle, l’auteur démolit, comme son titre l’indique suffisamment, ce qu’il édifia autrefois, sans pour cela d’ailleurs être plus économiste qu’auparavant ; il a changé de socialisme, voilà tout.
Ainsi donc M. Schäffle, après s’être prononcé, évasivement prétend-il, pour le collectivisme, renie actuellement ces doctrines, assurant que ceux qui l’ont lu (il pourrait ajouter traduit) se sont mépris, ont été dupes d’une illusion qu’un peu d’attention de leur part aurait dû dissiper. Certes il est, dans la Quintessence du socialisme tout au moins, des phrases qui sont décourageantes pour les socialistes de cette école, et il a fallu bien de la bonne volonté ou plutôt un aveuglement causé par une admiration trop passionnée pour, non seulement l’accepter comme un frère, mais même le comprendre dans l’état-major et s’incliner devant son autorité. C’est pourtant ce qu’ont fait ses traducteurs français et italiens, et ses nombreux adhérents dans tous les pays. Les premiers translatent sans sourciller (et c’est leur éloge en tant que traducteurs ; cela prouve leur bonne foi sincère, leur loyauté) ses défaillances, comme si elles ne devaient pas les mettre sur la voie de ses tergiversations futures ; quant aux autres, à ses adhérents, ils ne prennent de ses œuvres que ce qui flatte leurs convictions.
La première tendance éprouvée serait celle de repousser sans appréciations critiques, sans phrase, les œuvres de ce frère apostat. Cependant, même dans le cas où ses ouvrages n’auraient été, à aucune époque, l’expression de sa pensée, il resterait acquis ce fait que les socialistes militants les acceptent comme représentant exactement le but et les moyens des collectivistes, de même qu’une copie a beau ne pas répondre à la manière particulière de l’artiste qui l’a faite, si elle est fidèle, elle est, à défaut de l’original,acceptée dans une certaine mesure
Mais il ne nous est pas prouvé que l’auteur n’a pas reproduit jadis l’expression de sa pensée et que, ayant, depuis, modifié son opinion, il préfère s’accuser de supercherie que de l’être de versatilité. Si même nous disons toute notre pensée, nous croyons que c’est là la réalité et que nous avons devant nous un ancien collectiviste redevenu socialiste indépendant.
Prenons donc sa Quintessence du socialisme comme œuvre d’école, représentant le mode d’exposition et de discussion du collectivisme, et examinons-la critiquement.
Ainsi que chez tous les socialistes de nos jours, Karl Marx en tête, la clef du système de M. Schäffle est la plus-value.
« D’après l’économie politique bourgeoise, le travailleur reçoit, en moyenne, non pas la valeur complète du produit de son travail journalier, mais beaucoup moins et seulement l’équivalent de ce qui lui est strictement nécessaire pour son entretien quotidien. Il travaille par jour dix à douze heures, dont six peut-être déjà représentent la valeur de son salaire. Ce qu’il produit en plus de son entretien (ce qu’on nommeplus-value) passe dans la poche du capitaliste. La plus-value tombant en gouttes journalières est absorbée par l’éponge du capital ; elle devient profit du capitaliste et grossit le plus souvent le capital[33]. »
Et plus loin : « Ainsi sous le couvert du salaire, qui n’est pas équivalent au produit du travail, a lieu, tous les jours et à toutes les heures, une exploitation sans trêve des travailleurs salariés, et ainsi le capital joue le rôle d’un vampire, d’un spoliateur, d’un voleur[34]. »
L’auteur marque bien qu’individuellement le capitaliste ne peut, de ce fait, être réputé un voleur, mais en bloc la propriété capitaliste actuelle repose sur le vol ou, comme disait Lasalle avec euphémisme, représente le bien d’autrui (Fremdthum), ce qui, entre nous, en diffère peu.
La distinction est quelque peu casuistique et, pour être commis sur la communauté et non sur l’individu, le délit n’en est pas moins un délit.
Nous l’avons dit : la clef de voûte du socialisme moderne, c’est la plus-valuedont nous venons d’énoncer la prétendue base et que nous avons vu de même former l’introduction aux idées de Frédéric Engels.
La démonstration de sa réalité serait donc de toute utilité, et cependant elle laisse à désirer, même au point de vue socialiste, dans les ouvrages qui ont la prétention d’en résumer les doctrines. On affirme en variant la forme, et puis c’est tout. Parfois on fait, comme Engels, un petit roman historique pour expliquer la chose ; mais on se garde de le démontrer, ce que l’on juge d’ailleurs superflu. Et cependant, encore une fois, c’est la pierre angulaire des systèmes collectiviste et anarchiste. À notre grand regret, passons.
La conséquence est que la propriété capitaliste actuelle doit être remplacée par l’appropriation collective du capital, avec une organisation sociale du travail.
Comment se fera la transition ?
« Le bourgeois peut avoir un droit sur ce qu’il a acquis sous le régime actuel de production, et nous lui rachèterons son capital privé, comme il a racheté le droit féodal. Mais il n’a aucun droit de réclamer pour tout l’avenir l’empêchement d’un meilleur mode de production. Une nouvelle forme de production peut, à chaque moment, être proclamée par le peuple comme un nouvel état de justice.— Dès lors, le capitaliste ne pourra plus seul exercer sa grande industrie : il saura s’estimer heureux si on rachète, à lui et à ses enfants, le capital privé en annuités de jouissance qui dureront jusqu’à ce que tout le monde se soit fait aux nouvelles conditions. Notre capitaliste s’inclinera devant le droit nouveau proclamé par la majorité du peuple, comme la noblesse a dû s’incliner devant le droit proclamé par la bourgeoisie et se contenter du rachat des servitudes féodales[35]. »
Je ne m’arrêterai pas à la comparaison de l’abolition des droits féodaux avec celle des droits du capital, les premiers basés sur la force et les seconds sur l’équité ; cela nous égarerait dans la politique, ce que nous voulons éviter. Mais, nous restreignant à notre programme, on reconnaîtra qu’il n’est pas nécessaire d’être bien familier avec l’économie politique pour remarquer le peu de logique de cet alinéa. Ou le droit de propriété est, et alors il est respectable à toute époque, à tout âge, ou il ne repose sur aucun fondement, et alors, loin de payer quoi que ce soit aux propriétaires, on devrait leur demander une compensation pour la détention illégitime de ce qu’ils appellent leur propriété et la jouissance des avantages qui en découlent.
Continuons : Avec quoi payera-t-on la taxe de ce rachat ?
Avec des moyens de consommation. En d’autres termes, on autorisera le capitaliste bourgeois à manger son capital, mais on lui défendra de le faire valoir, l’État se chargeant de ce dernier soin.
C’est ainsi que les gens riches actuels auront « une richesse suffocante de moyens de consommation[36]», suffocante en effet pendant une certaine période, mais au-delà la ruine. Ils deviendront des travailleurs comme les autres ; mais, en tant que possédant des capitaux épargnés sur leur travail antérieur ou celui de leurs ancêtres, ils seront ruinés.
Cette compensation temporaire, car elle ne pourra durer longtemps, sera en effet pour la masse une charge sans retour. Je possède 100 000 francs, qui me rapportent 5 000 francs de rentes perpétuelles avec lesquelles je vis, sans parler de mon travail, qui me fournit d’autres ressources que je continuerai de posséder, je veux bien, non le croire, mais l’admettre. Ils sont représentés soit par une propriété immobilière, soit par un fonds de commerce ou un atelier, outillage compris, soit par des titres. L’État collectiviste me les prend et me donne en place pour 100 000 francs de moyens de consommation, comme on donne actuellement, par charité, des bons de pain ou de viande, Si je continue mon ancien genre de vie, j’absorbe ces 100 000 francs de moyens de consommation en 5 000 francs par an, mais pendant vingt ans seulement ; au-delà de cette limite, plus rien. Quant à l’État, il doit pendant vingt ans me fournir 5 000 francs par an de produits consommables, mais contre ses bons. Aura-t-il encore la longanimité de le faire ? Il faut en douter, puisque M. Schäffle lui-même dit, dès à présent, que cela durera « jusqu’à ce que tout le monde se soit fait aux nouvelles conditions ». Ce sera donc une spoliation partielle d’abord, que l’on complétera plus tard.
Justice à part, on dit bien que le capital aura changé de mains, voilà tout, et qu’on le fera valoir par l’entremise de l’État, aussi bien que l’ancien propriétaire, qui lui faisait produire un intérêt ou loyer. On ajoute même que, comme il y aura plus d’unité dans la production, la productivité de ce capital sera plus grande. Cette prétendue unité se fera d’abord, qu’on le remarque bien, par l’élimination d’industries auxquelles l’État est rebelle par nature, l’ingéniosité de l’intérêt privé s’éteignant ; pendant que la production libre, loin d’être privée d’unité, en est naturellement pourvue par ces lois, dont Bastiat a si éloquemment démontré l’harmonie. On n’aura plus que des industries répondant aux besoins physiques ; loin de s’élever, la civilisation déchoira.
Et puis ne connaît-on pas les dispositions despotiques de tout État, quand on lui remet le pouvoir en mains ? Ne sait-on pas que, si on ne le modère pas, il entend régenter l’espèce humaine jusque dans ses actes les plus légitimes ?En veut-on une preuve ? M. Schäffle (traduction — j’allais dire endossement — Malon) nous la fournit avec une candeur adorable : « Il est vrai aussi que l’État pourrait radicalement éliminer les besoins qui lui paraîtraient nuisibles, en ne produisant plus pour eux ; c’est pourquoi les végétariens, Baltzer entre autres, tendent vers le socialisme. Mais ce n’est pas une chose mauvaise que d’éloigner du corps social les produits falsifiés et nuisibles[37]». Et plus loin : « Seulement il se pourrait que l’État économique unitaire rejetât certains besoins physiquement et moralement nuisibles ou incompatibles avec ses principes ; il mettrait justement fin à la satisfaction de ces besoins en ne produisant plus et en n’offrant plus les moyens de les satisfaire[38]. »
L’État s’érigerait donc en juge et appréciateur des conditions morales et physiques des besoins, et, avec l’infaillibilité qui le caractérise, il dirigerait lui-même la consommation en même temps que la production. Que la moitié plus un des gouvernants ayant place au conseil décident que l’homme ne doit vivre que de légumes, ou doit s’abstenir de vin, de rhum, ou de bière, et le monde entier devra se ranger à cette loi ; que dis-je devra ? ne pourra faire autrement, à moins de se résoudre à végéter ou à mourir, si M. Baltzer ou les Teazotalers se sont trompés. Ainsi le veut la loi socialiste : grand merci de cette prévoyante et paternelle tutelledont nous n’examinons même les effets que sous le rapport physique, car on sait combien peu s’accommoderaient de ce régime les arts, les belles-lettres, les sciences, que tout joug officiel tue ou tout au moins atrophie.
Après avoir fait justice des prétendus bienfaits de l’unité de la production par l’État, reste la question de l’accroissement, ou, tout au moins, de l’égalité de productivité du capital, quand, au lieu d’être aux mains des particuliers, il est entre celles de l’État.
Nous n’avons pas besoin d’aller bien loin pour trouver des aveux précieux de la supériorité, en ce genre, de l’individualisme (mot qui n’exclut pas l’association volontaire) sur le collectivisme ; M. Schäffle lui-même n’a-t-il pas, comme on le verra plus loin, parlé de « cette grande vérité psychologique et de cette fécondité économique du principe individualiste d’après lequel l’intérêt privé pousse à l’accomplissement des fonctions de la production sociale[39]», et, ailleurs, ne recommande-t-il pas au socialisme « de conserver tous les bons côtés de la liberté moderne du travail et de l’économie familiale[40]» ?
N’est-ce pas reconnaître que l’individu fait mieux, sécurité à part, que l’État, à égalitéde quantité ?
Quelque bizarre qu’il soit de voir de pareilles affirmations dans un tel livre, nous pensons qu’elles sont des preuves suffisantes pour éviter au lecteur des redites de ce qu’il a pu lire dans les œuvres des maîtres.
M. Schäffle a bien soin (et son insistance est la preuve qu’il cherche à rassurer) de distinguer la propriété des moyens de production, de celle des objets consommables. La dernière est respectée ; la première, au contraire, échoit à l’État, sauf remboursement, comme on a vu, en moyens de consommation.
Cette distinction prétendue prouve combien l’auteur se doute peu de ce qu’est un capital même matériel, voulant pas trop user de nos avantages en lui parlant des capitaux immatériels que l’État serait bien embarrassé de s’assimiler, ne voulant pas rétablir l’esclavage.
Le capital résulte, suivant les économistes, de l’épargne, suivant les socialistes de toute nuance, de la plus-value. Mais il faut, en outre, dans un camp comme dans l’autre, qu’il soit affecté à une reproduction ultérieure, sans cela il n’est qu’un produit consommable. Ce taureau est capital si je l’attelle à ma charrue, objet de consommation si je le dirige vers l’abattoir. Ce livre, utile cependant, est objet de consommation si, le lisant légèrement, il ne fait que me distraire ; s’il m’instruit, il est capital. Le produit n’est donc capital ou objet de consommation que selon la volonté du possesseur, et comme il importe peu que le capital soit sous une forme ou sous une autre pour être capital, par la raison que, par voie d’échange, on lui fait revêtir, au moment voulu, la forme utile pour produire, on peut dire que c’est toujours et exclusivement par la volonté du détenteur et non par ses caractères extérieurs qu’un produit est capital.
Or, ceci démontré, comment faire le départ entre les capitaux et les objets de consommation, puisqu’ils ne résultent pas des faits, mais d’une volonté personnelle ? Vous instituez l’État socialiste et déclarez que tout instrument de production doit faire retour à l’État. Fort bien ! Vite j’échange mes outils, ma fabrique contre des tableaux, des statues, un palais, des provisions, des meubles, des bijoux, des dentelles, etc., toutes choses pouvant être réputées à mon usage personnel, et vous ne pouvez plus toucher, aux termes de vos affirmations, à ce que je possède.
Continuons :
L’État possède donc tous les instruments de production. Comment s’organisera cette production :
« La production collective organisée d’une manière indépendante en corps de métiers pourrait très bien admettre aussi une statistique journalière, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, annuelle des besoins individuels et familiaux, du genre de celle qui se fait aujourd’hui; et d’après cette statistique résultant de la libre manifestation des besoins, la production nationale pourrait se régler en ce qui regarde la qualité et la quantité des produits[41]. »
S’imagine-t-on l’immensité d’une pareille statistique devant logiquement s’étendre à l’univers entier ? Limitons-la cependant à un État et on sera encore effrayé de penser que l’approvisionnement des besoins de tout un pays dépendra de l’intelligence et de la prévoyance des bureaux de l’État. C’est être bien peu pratique ou d’une bonne foi bien douteuse que de prétendre y compter sérieusement.
Il est vrai que cette statistique serait simplifiée, comme on a vu plus haut, par l’autocratie de l’État qui saurait mettre ordre aux goûts anormaux ou disparates et travaillerait, comme on a vu, à ruiner les riches en les forçant de vivre sur leur capital au lieu de n’en consommer que le revenu, l’État ayant confisqué la nue-propriété d’abord, en attendant qu’il en fasse de même de l’usufruit, lorsque tout le monde aurait pris goût au nouvel état de choses. « On peut même dire que les oscillations des besoins seraient bien moins grandes que dans l’état actuel, car dans l’état socialiste, le prolétariat et la ploutocratie ayant disparu, l’ensemble du peuple constituerait un état moyen ayant des besoins uniformes[42]. »
L’uniformité de la vie de soldat, voilà l’idéal de l’État socialiste !
Aussi, « tout ce qui discipline les masses unitairement, tout ce qui centralise, tout ce qui renferme en soi une concentration publique de forces isolées sur une vaste échelle, a une grande affinité avec le socialisme[43]. »
« Le service de toutes les centralisations dans l’État et dans la société pour la propagande socialiste[44]» est le moyen par excellence prôné par M. Schäffle.
« Toute centralisation de l’État libéral vient plutôt en aide au socialisme et lui est pour ainsi dire congénère[45]. »
En effet, « les établissements corporatifs ont, dans le fond, beaucoup d’affinités avec le collectivisme, et quand viendra le moment d’appliquer le socialisme, cette forme s’y prêtera beaucoup mieux que la forme de production capitaliste privée. Il en est de même de la participation des travailleurs aux bénéfices ; ce n’est pas une organisation socialiste, mais elle conduit à la propriété collective. Toutes ces formes transitoires, le socialisme peut les conduire (sic!) comme l’eau à son moulin, mais elles ne sont pas son dernier mot. »
« Nous insistons sur ces points pour mieux expliquer pourquoi la conquête du pouvoir politique par le peuple travailleur, l’agitation, la propagande des idées de bien-être, la critique de la spéculation effrénée, comme aussi les compromis éventuels avec l’État pour l’encouragement des sociétés productives sont, avant tout, peuvent et doivent être, dans les circonstances présentes et sans préjudice du but final du socialisme, le mode d’agissement le plus efficace[46]. »
— Est-ce parler clairement ?
Mais quoi ? L’État ou la société ?
Nous avons vu Engelsne pas hésiter; la société succède à l’État ; le jour où l’État arrive à son apogée est celui où il doit se retirer pour faire place à la société. La patrie s’étend, la nation s’accroît indéfiniment, nous ne sommes plus que des citoyens de l’humanité.
Karl Marx va moins loin : « Le produit total des travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme moyen de production et reste sociale ; mais l’autre partie est consommée et par conséquent doit se répartir entre tous. Le mode de répartition variera suivant l’organisme producteur de la société et le degré de développement historique des travailleurs. Supposons, pour mettre cet état de choses en parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison de son temps de travail. Le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. D’un côté, sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins ; de l’autre il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la part du produit commun réservé à la consommation[47]. »
M. Schäffle, encore plus explicite, dit toujours l’État socialiste et non la société, et il regarde, à l’encontre d’Engels, le gouvernement comme tellement nécessaire (et cela sans réclamation de son traducteur M. Malon) qu’il s’occupe de la rémunération des individualités qui le composent. « Ceux qui rendraient à la société des services d’utilité générale, c’est-à-dire ceux qui ne produiraient pas directement, tels que les juges, les employés d’administration, les membres du corps enseignant, les artistes, les penseurs, etc., pour subvenir à leurs besoins, recevraient une part du produit national en proportion de temps de travail qu’ils auront donné à la société[48]. »
C’est là ce qui distingue Karl Marx et Schäffle d’Engels; les deux premiers sont collectivistes, le dernier est anarchiste.
Arrivons au temps de travail dont Karl Marx parlait tout à l’heure et que nous avons momentanément mis de côté pour nous occuper de la question de l’État et du gouvernement.
On se rappelle que Vidal voulait que les produits socialement créés fussent répartis en raison des besoins. Karl Marx a perfectionné la formule en créant le temps de travail qui est l’expression du droit à la consommation et qui doit même servir de coefficient dans les échanges des produits consommables, les seules valeurs qui puissent circuler ; les autres, les instruments de production, ne le pouvant, puisqu’ils appartiennent à l’État.
Quand nous disons que les produits consommables peuvent circuler, il faut les distinguer des moyens de consommation. Les objets à l’usage personnel, les meubles, le linge, etc., peuvent être l’objet d’une propriété privée et circuler avec le temps de travail comme moyen d’échange ; on les tolère. Maisles moyens de consommation ne peuvent constituer un droit indéfini ; la faculté de les échanger contre des objets de consommation est limitée, au moins en tant que ces moyens de consommation ont servi à indemniser des propriétaires de capitaux ; elle durera, nous l’avons vu « jusqu’à ce que tout le monde se soit fait aux nouvelles conditions ». Mais comment distinguer les moyens de consommation socialement acquis de ceux délivrés à titre d’indemnité aux propriétaires dépossédés ?M. Schäffle omet de nous le dire. Tout cela est vague et mériterait plus de lumières.
En tout cas, M. Schäffle nous marque, sans ambages, qu’il ne faut pas compter en émigrant conserver ses droits à user des moyens de consommation, « à moins qu’il ne préfère émigrer, auquel cas il est bien douteux que l’État socialiste lui envoie ses annuités[49] ». Voilà, en vérité, une propriété assez précaire, surtout ayant vu que l’État socialiste s’attribue des droits de moralisation et même de direction légèrement autocratiques.
Revenons au temps de travail.
Qu’est-ce que cette unité qui joue dans la distribution des produits un rôle prépondérant ?
« Les produits sont désignés comme travail cristallisé. Mais ce n’est pas le premier travail venu qui peut déterminer, c’est seulement le travail socialement nécessaire, c’est-à-dire le travail qui, d’après l’état donné de la technique sociale, en rapport avec une unité des besoins publics, doit être employé en moyenne à la confection du produit dans toute son étendue sociale. — Quand, par exemple, un pays a besoin de 20 000 hectolitres de froment et que, pour leur production, il doit employer 100 000 journées de travail (socialement organisé), chaque hectolitre vaudrait 5 journées particulières de travail socialement constitué. Cette valeur aurait cours, quand même des individus isolés auraient été assez négligents pour mettre 10 ou 20 journées de travail individuel à la production d’un hectolitre de froment[50]. »
La durée moyenne du travail nécessaire pour une production : Karl Marx s’arrête à cet élément qui, avec juste raison, ne satisfait pas suffisamment M. Schäffle ; cet ancien homme de gouvernement arrive à cette conclusion : « La valeur sociale (valeur d’échange) doit être déterminée non seulement d’après la valeur des frais, mais en même temps aussi d’après la valeur d’usage variable[51]. »
M. Schäffle donne tant d’importance à la nécessité de tenir compte pour la valeur non seulement du prix de revient, mais encore de l’intensité des besoins, qu’il est conduit à cette déclaration qui eût dû ouvrir les yeux à ses confrères en socialisme :
« En d’autres termes, si le socialisme n’est pas en état de conserver tous les bons côtés de la liberté moderne du travail et de l’économie familiale pour les joindre à ses avantages incontestables qui sont, entre autres, l’ordre et le contrôle réciproque du travail, la libre et rénovante acceptation des devoirs, l’abolition certaine des excès de travail et de l’abandon des femmes et des enfants, l’empêchementde l’exploitation par des intérêts privés, l’abolition de la paresse et de la vie parasite improductive, la fin de la corruption, du luxe démesuré, des délits provenant de la propriété, si le socialisme est incapable de réaliser cela, il n’a aucune chance et aucun droit d’être réalisé[52]. »
Ce passage pessimiste n’est pas le seul que nous ayons, conformément à nos promesses du début, à relever dans la Quintessence du socialisme.
En voici un autre non moins fort :
Après avoir posé cette question : « Le socialisme sera-t-il jamais en état de réaliser sur son terrain, au même ou à un plus haut degré, cette grande vérité psychologique et cette fécondité économique du principe individualiste, d’après lequel l’intérêt privé pousse à l’accomplissement des fonctions de la production sociale[53]? » et avoir ajouté : « Nous considérons cette question comme décisive, quoique nullement décidée encore ; c’est d’elle que dépendra, à la longue, la victoire ou la défaite du socialisme, la réforme ou la ruine de la civilisation occasionnée par lui au point de vue économique[54]», il conclut ainsi : « Aussilongtemps que le socialisme n’offrira rien de plus positif à ce sujet, il n’aura pas d’avenir. Avec son idée d’arriver à un plus juste partage des produits en donnant un procédé de production qui, avec beaucoup d’inconvénients, contient aussi assez de garanties économiques, le socialisme, disons-nous, ne pourra pas réussir à l’amiable, et, s’il veut employer la force, il échouera encore longtemps[55]. »
Ce socialisme doucereux paraîtra peu dangereux à des lecteurs superficiels. Nous estimons que l’anarchisme, avec ses bruyantes menaces qui nous le font comparer à un torrent, est moins à craindre que le collectivisme de M. Schäffle, eau dormante qui engloutit sans bruit ses victimes, ne leur laissant pas le temps ou la faculté de jeter un seul cri.
C’est la fable du cochet, du chat et du souriceau :
Garde-toi, tant que tu vivras
De juger les gens sur la mine.
Il faut d’ailleursremercier M. Schäffle et son traducteur, M. Benoît Malon, de la franchise de leurs aveux ; on l’a vu, les collectivistes comptent beaucoup sur l’ignorance ou la bêtise des « bourgeois » pour faire tisser de leurs propres mains le lien qui doit aider à les étrangler : « Se servir de toutes les centralisations dans l’État et dans la société pour la propagande socialiste[56]. »
Le réglementarisme est l’avant-garde du collectivisme. Ce dernier, à la face hypocrite, appuyé sur sa hideuse progéniture, la spoliation et la misère, se cache derrière lui, et l’anarchisme, c’est-à-dire le néant[57], attend son avénement pour triompher à son tour et amener dans un tourbillon de folie épileptique, au milieu du sang et à la lueur des incendies, non la fin de l’humanité, mais du moins la déchéancede la nation assez privée du sens commun le plus vulgaire pour se laisser aller au courant de ces turpitudes.
Caveant consules ! Avis au peuple, c’est-à-dire à la nation, à nous tous.
ANNEXE
LES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DE L’ÉTAT[58].
On ne détruit sans retour que ce que l’on remplace.
Édifions :
Rien de plus difficile, dit-il, que de déterminer théoriquement les attributions économiques de l’État ; rien de difficile comme de délimiter, dans la pratique, les fonctions respectives de l’État et de l’individu, isolé ou librement associé d’ailleurs.
Il n’est pas besoin d’être un bien grand clerc pour reconnaître que le producteur ne peut, d’une manière utile, et surtout progressive, accomplir son opération caractéristique et songer, en même temps, à se protéger efficacement contre les attentats dont sa personne, les siens compris, et ses biens peuvent être l’objet. Pour le présent, on peut encore admettre, en s’y prêtant complaisamment, qu’il puisse prendre soin de sa défense, sauf à voir sa production s’en ressentir, qualité et quantité ; mais, quant à sa défense contre les attentats à venir, à celle que l’on peut appeler préventive, se faisant par voie judiciaire, décourageant, par crainte d’un châtiment, tout acte criminel extérieur, il ne peut, en aucune manière, s’en charger lui-même ; il peut se venger, mais il ne peut se faire justice, car nul ne peut être juge et partie dans sa propre cause.
Le soin de la sécurité du producteur — individu et choses — doit donc forcément être remis à un tiers désintéressé ; ce tiers, quel qu’il soit, c’est l’État ou ses diminutifs, la province, la commune.
L’État, pour protéger l’individu d’une manière efficace, hérite de ses droits ; ce dernier, pour se défendre, avait droit d’opposer la force à la force ; l’État a le droit, pour agir suivant son objet constitutif, d’employer la force.
En remplissant son but, l’État est utile ; faire une chose utile est produire ; l’État est donc un producteur, sui generis sans doute, mais enfin producteur. Ce qu’il produit, c’est la sécurité ; son industrie est l’industrie de la sécurité.
Pour cette production, le monopole lui est nécessaire ; avec la concurrence des États sur un même territoire, le prix de revient serait trop coûteux et par suite le consommateur, à égalité de produit, le paierait trop cher.
Ce produit, la sécurité, se différencie particulièrement des autres produits, en ce qu’il ne cause aucune satiété chez les consommateurs ; on n’a jamais trop de sécurité. En outre, ce denier, qui, pour toute autre production, consulte ses moyens avant de s’en procurer la jouissance, ne s’arrête pas, dans le cas qui nous occupe, à cette considération. Pauvre ou riche, vous requérez l’État de vous protéger, de vous protéger dans le sens le plus absolu du mot, et l’État le fait, en retour, sans considération de position sociale. Une même loi, un même code, les mêmes tribunaux ; la nature du crime ou délit, et non la qualité de la victime, entraînant seule des différences de juridiction.
Ce ne sont pas là les seules différences qui existent entre la production de la sécurité et celle des autres utilités ; le mode d’échange nous fait assister à une autre originalité. Le prix est, non pas fixé par la loi de l’offre et de la demande, mais établi suivant les ressources de chacun des consommateurs ; ces derniers ne peuvent d’ailleurs, sous le prétexte illusoire qu’ils n’auraient pas besoin de sécurité, se dérober au payement de ce prix ; il leur est imposé ; c’est un impôt.
D’ailleurs, l’État ne vous demande que le remboursement de ses débours ; il vous vend ses produits au prix de revient. Il n’a pas à faire de bénéfices sur vous. Il est votre mandataire contractuel et non une contrepartie intéressée.
L’industrie de la sécurité est donc régie, économiquement, par des lois complètement différentes de celles qui gouvernent les autres industries. Au lieu de la persuasion morale, c’est la force brutale ; le monopole remplace la liberté ; le produit s’en consomme indéfiniment et sans occasionner de satiété ; tout le monde a le droit de le consommer sans acception de position sociale, lorsque, dans les autres industries, chacun en consomme les produits en raison de ses besoins et de ses moyens. Enfin, ce n’est pas la loi de l’offre et de la demande qui fixe le prix et ce dernier est, en principe, identique au prix de revient.
La conclusion qui découle logiquement de ce rapprochement, c’est que l’État est impropre à exercer toute autre industrie que celle de la sécurité (force armée-justice-administration), puisqu’il y apporterait des règles de conduite en opposition formelle avec les lois économiques qui concernent l’industrie privée.
Voilà la théorie pure, le but idéal vers lequel toute association politique qui veut prospérer doit tendre sans cesse.
Mais, comme pour tout idéal, on peut, on doit y tendre, sans jamais l’atteindre.
Cherchons rapidement quels sont les obstacles qui peuvent retarder la marche continue et progressive de l’humanité vers cet idéal.
Et d’abord, remarquons que la multiplicité croissante des services demandés à l’État n’est pas nécessairement en contradiction avec la limitation obligatoire des fonctions gouvernementales.
Le Canaque ou le Cafre est, sans doute, moins exigeant que nous vis-à-vis de l’État ; mais cela tient à sa civilisation rudimentaire qui fait qu’ayant moins de besoins, il se contente d’une protection plus limitée. La protection des mineurs, par exemple, qui chez nous est une partie importante des attributions de l’État, le sauvage ne sent pas la nécessité de l’établir chez lui. Le père ou, s’il s’agit d’un orphelin, le premier venu est maître absolu de l’enfant qui est ainsi sous la dépendance de la force non contrôlée dont, trop souvent, il devient la victime. Il en est de même des contrats, du respect de la nationalité à l’étranger, etc. Qui sait même si l’État, sur certains points, n’est pas, comme au royaume de Dahomey où le souverain est propriétaire unique, plus sujet à sortir de ses attributions que dans notre civilisation européenne.
Les attributions de l’État peuvent donc se multiplier, sans que son ingérence dans le domaine normal de l’individu se développe et réciproquement.
Cela tient au progrès plus ou moins incessant de la civilisation.
Cette réserve faite, pourquoi les attributions de l’État étant si nettement tranchées, voit-on tant de dérogations se produire même chez les peuples les plus avancés en civilisation, même chez ceux où le self-help est le plus en honneur ? D’où cela vient-il ?
C’est qu’il s’agit ici, non d’une quantité mathématique, absolue, inerte, mais de l’homme, unité des plus variables, non seulement de nation à nation, mais d’individu à individu et, chez un même individu, d’une époque à une autre. De là ces oscillations de l’opinion publique, ces difficultés ou facilités que la masse apporte à la pratique de telle ou telle combinaison plus ou moins artificielle. Le communisme, pour prendre un terme extrême, est justement condamné par la science, et que de fois cependant n’a-t-on pas vu des associations communistes prospérer, temporairement tout au moins, grâce à la disposition d’esprit religieuse ou enthousiaste des administrés, dispositions d’esprit qui leur a fait, sans qu’ils en ressentent de privation, limiter leurs besoins particulièrement en matière littéraire ou artistique. En faut-il, pour cela, douter de l’infériorité du communisme ?
Il faut encore songer que l’homme a des exigences multiples. Il n’est pas seulement sous l’empire des lois économiques, il lui faut encore compter avec les lois d’autres sciences morales (la politique, le droit, etc.), pour ne parler que du côté immatériel. Or, souvent l’intérêt de la civilisation veut que la politique, par exemple, ait le pas sur l’économie politique, ou en économie politique telle loi sur telle autre. Est-ce que, par exemple, pour des sauvages, la notion de propriété n’est pas plus pressante à acquérir que le respect absolu des attributions de l’État ?
Remarquons d’ailleurs que l’utilité de limiter l’État à son domaine naturel est en rapport direct avec le degré de civilisation d’un pays. Plus cette dernière est avancé, plus il faut se rapprocher résolument de la théorie ; plus elle est arriérée, moins sont graves les atteintes au principe. Soyons modestes et ne nous étonnons pas trop si l’on s’aperçoit peu de l’extension exagérée des fonctions attribuées à l’État dans l’Europe actuelle.
Ne nous dissimulons pas, en outre, que les progrès en matière de délimitation des attributions économiques de l’État ne peuvent être que fort lents. Eussions-nous pouvoir absolu de les ramener à leur frontière normale, l’opinion publique nous seconderait-elle unanimement dans cette œuvre, que nous n’en convierions pas moins le temps à nous prêter sa collaboration. Les transformations lentes chez l’homme sont seules durables ; notre histoire, soit économique, soit politique, est là pour l’attester. Profitons de ces souvenirs.
Mais alors, dira-t-on, pourquoi poser d’une manière abstraite des limites si absolues ? Pourquoi parler d’un idéal qu’on ne doit jamais atteindre et dont même on ne peut se rapprocher que si lentement ? N’est-ce pas aller contre son but, décourager l’humanité ? La vue d’un trop long trajet ne détourne-t-elle pas parfois les hommes de se mettre en route ?
Si nous parlions à l’humanité entière, qu’elle nous écoutât pour savoir quelle direction donner à sa marche, nous jugerions peut-être prudent de ne lui proposer qu’en détail et successivement les réformes diverses qui doivent tendre au but proposé. Mais nous nous adressons, dit M. Courtois, à un cercle choisi, même en y comprenant ceux qui, au dehors, par l’entremise de journaux et revues, suivent nos discussions. Nous leur devons, à eux, la véritéimmédiate et complète.
Il y a danger d’ailleurs à détourner sa vue d’un idéal, tout lointain qu’il soit. Un auteur distingué, quoique paradoxal, M. Herbert Spencer, énumère, dans un récent ouvrage ne s’occupant que de l’Angleterre et pour les dernières années, les principales violations du principe que nous venons de développer ; elles sont considérables, en nombre et en importance. Et cela ne résulte pas tant de divergences sur les attributions de l’État ; non, on s’avoue volontiers que l’on charge l’État d’une fonction qui ne le regarde pas ; mais on n’y attache pas d’importance. On s’effraye un peu de cette infraction à un principe, un principe ! chose de peu de conséquences au temps où nous vivons. On ne le voit que trop quand il s’agit des systèmes en contradiction avec la science ; on n’a plus peur du socialisme, on le coudoie, on l’accepte avec une facilité qui n’est plus de la tolérance, mais de l’indifférence.
Et les socialistes qui s’en aperçoivent s’en prévalent. Lisez la Quintessence du socialisme de M. Schäffle et vous y verrez que le collectivisme compte, pour son avènement prochain, sur le relâchement de l’opinion publique et par suite des gouvernants en matière de liberté économique.
Sans aller si loin, les progrès du protectionnisme, qui commence à recouvrir de ses flots des terres que la propagande libre-échangiste lui avait fait abandonner, sont patents et dus non à un changement radical d’opinion, mais au relâchement trop évident des principes dans les masses.
Ne craignons pas de voir en face la vérité absolue, dussions-nous concéder à la faiblesse humaine tout le temps voulu pour se rapprocher de notre idéal, condescendant ainsi aux déviations dues à une civilisation relativement arriérée, si ce n’est dans l’enfance.
___________________
[1] En faisant l’éloge de la traduction française nous devons néanmoins faire des réserves au sujet de néologismes inventés ou peu usités et qui ont une prétention assez peu à sa place dans une œuvre de raisonnement. Pourquoi puissanciée, mondial, qualitatif et même quantitatif ou récognition, les derniers français, mais peu usités et ayant des analogues plus connus ?
[2] Socialisme utopique et socialisme scientifique, p. 22.
[8] « L’atelier individuel, dit Fréd. Engels, fait place à la fabrique, etc. » (page 26) — Mais dans l’atelier individuel n’y avait-il pas déjà un patron et un ou plusieurs ouvriers ? La transformation est donc plus ancienne que ne le pense l’auteur. Elle est, en effet, aussi vieille que le monde.
[12] Karl Marx, le Capital, traduction de M. J. Roy, revue par l’auteur, p. 285, 1ère colonne.
[13] Socialisme utopique et socialisme scientifique, p. 28.
[16] Nous fournissons cette citation de seconde main, la trouvant dans la brochure si condensée et si clairement écrite de Fréd. Engels, p. 27. Nous ne doutons pas qu’elle soit dans l’œuvre de Karl Marx, étant conforme en tous points aux idées de ce fondateur de l’Internationale ; mais malgré la lecture attentive de son œuvre (le Capital) nous ne l’y avons pas rencontrée, Évidemment elle nous a échappé et cela ne nous étonne pas, la compilation de Karl Marx étant fort indigeste, très longue quoique inachevée et d’une lecture excessivement fatigante.
[17] Socialisme utopique et socialisme scientifique, p. 26.
[25] Une contradiction, involontaire cette fois, a échappé à Proudhon ; comment une commune, une corporation peut-elle faire sa loi, si ce n’est par voie de vote ?
[26] Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle, 2e édit., p. 283 (7e étude, § 1).
[27] Qu’est-ce que la propriété ? 4e mém., chap. V, 2e partie, § 2 (publié en juin 1840).
[28] Le socialisme contemporain, p. 67.
[29] Le Collectivisme, examen critique du nouveau socialisme, par Paul Leroy-Beaulieu. Paris, 1884, p. 3.
[30] De la répartition des richesses ou de la justice distributive en économie sociale. Paris, 1846, p. 462.
[31] La Quintessence du socialisme de M. A.-E.Schäffle, traduction de M. Benoît Malon, 2e édit., 1881. Avant-propos, p. 4.
[32] Journal des économistes, de mars 1885, p. 385.
[33] La Quintessence du socialisme, p. 33.
[35] La Quintessence du socialisme, p. 37.
[36] La Quintessence du socialisme, p. 38.
[37] La Quintessence du socialisme, p. 46.
[39] La Quintessence du socialisme, p. 54.
[41] La Quintessence du socialisme, p. 46.
[42] La Quintessence du socialisme, p. 46.
[43] La Quintessence du socialisme, p. 27.
[46] La Quintessence du socialisme, p. 30-31.
[47] Le Capital, trad. franç. de M. T. Roy, revue et approuvée par l’auteur, p. 31.
[48] La Quintessence du socialisme, p. 20.
[49] La Quintessence du socialisme, p. 39.
[50] La Quintessence du socialisme, p. 74-75.
[51] La Quintessence du socialisme, p. 79.
[52] La Quintessence du socialisme, p. 84-85.
[53] La Quintessence du socialisme, p. 54.
[54] La Quintessence du socialisme, p. 55.
[56] La Quintessence du socialisme, p. 30.
[57] Le Nihilisme, comme l’appellent les races slaves et germaniques.
[58] Société d’économie politique, séance du 5 février 1885.


Laisser un commentaire