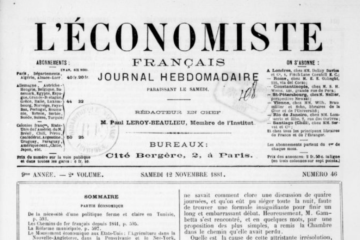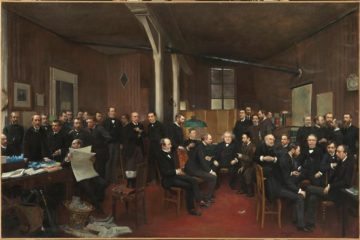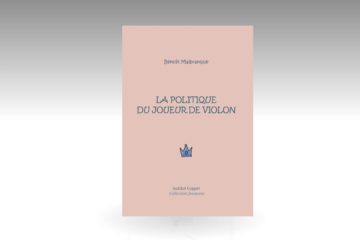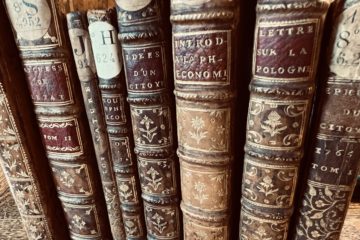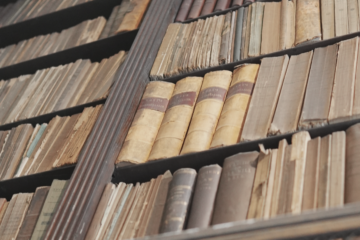Réflexions sur le journalisme libéral, à propos de «Contrepoints»
Le journalisme libéral est un métier exigeant. Il est très difficile de le faire seul, et déjà assez risqué de s’y aventurer avec une belle équipe de rédacteurs aguerris. La ligne éditoriale est une question de mesure : la rigueur absolue est impraticable, et le journaliste intelligent sait « mettre de l’eau dans son vin » sans se renier ; mais l’ouverture aussi doit avoir ses bornes, car sans cela l’identité propre du journal serait perdue de vue. Elle dépend aussi de l’état du marché, du nombre et de la qualité des contributeurs potentiels, et des idées du consommateur. On peut être innovateur, et aussi on peut ne pas l’être. Mais il faut toujours avoir des capacités managériales, au-delà même du journalisme pur, car la production de cette denrée immatérielle qui s’appelle une idée, ou en pratique un article, un journal, requière la collaboration de multiples personnes, qu’il faut savoir conduire.