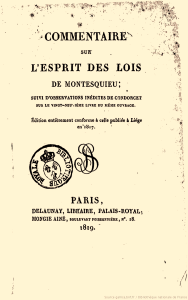 Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), chef de file des « Idéologues » (le nom original était « Idéologistes »), a défendu, dans toute son œuvre, le projet d’une société édifiée sur les bases d’une « science sociale », répondant au besoin de liberté et d’ordre des hommes.
Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), chef de file des « Idéologues » (le nom original était « Idéologistes »), a défendu, dans toute son œuvre, le projet d’une société édifiée sur les bases d’une « science sociale », répondant au besoin de liberté et d’ordre des hommes.
Interdit en France, ce Commentaire sur L’Esprit des Lois, fut d’abord traduit en anglais et publié à Philadelphie par Jefferson en 1811. La première publication en français date de 1817, à Liège et la seconde de 1819 à Paris.
Son auteur entend rendre à Montesquieu « un hommage qu’il regardait comme un devoir». Mais il tient aussi à marquer ses réticences devant les formes constitutionnelles et l’ignorance économiques du « libéralisme » de Montesquieu. Ce Commentaire est une pierre sur le chemin que doit tracer « le progrès des sciences sociales ».
Montesquieu, dit Tracy dans son Commentaire, n’a pas compris la véritable nature de la société et du commerce. Il n’a donc pas compris non plus le type de régime politique qui devait leur correspondre. Tel est le propos de Destutt de Tracy dans ce chapitre XVIII qui servira d’ébauche à son futur Traité d’économie politique.
A lire aussi : La vie et les travaux de Destutt de Tracy par M. Mignet (Revue des Deux Mondes, 4ème série, tome 30, 1842).
Citations de Montesquieu :
« La liberté c’est le droit de faire tout ce que les lois permettent. » (Esprit des Lois, XI, 3)
« Les grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finance, de richesses, de luxe même. » (Esprit des Lois, III, 3)
« Le commerce corrompt les mœurs pures ; il adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours. » (Esprit des Lois, XX, 1)
« L’effet naturel du commerce est de porter la paix. (…) Mais, si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les particuliers. Nous voyons que, dans les pays où l’on n’est affecté que de l’esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines, celles que l’humanité demande, s’y font, ou s’y donnent pour de l’argent. » (Esprit des Lois, XX, 2)
« Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que toutes les lois le favorisent; que ces mêmes lois, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu’il ait besoin de travailler pour conserver ou pour acquérir… » (Esprit des Lois, L V, ch 6)
Commentaire de Destutt de Tracy
CHAPITRE XVIII.
Sur les livres XX et XXI. — Des lois dans le rapport quelles ont avec le commerce considéré dans sa nature et ses distinctions. —Des lois dans le rapport quelles ont avec le commerce considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.
De même que j’ai joint ensemble les quatre livres qui traitent de la nature du climat, je réunis actuellement ces deux-ci qui ont rapport au commerce. Mais j’avoue que je ne sais comment aborder les questions qui y sont, non pas traitées-, mais tranchées. Je ne puis ni voir la connexion qu’elles ont entr’elles, ni trouver dans les unes les élémens de la solution des autres, comme cela devrait être, si elles étaient bien éclaircies et bien liées. Cela me rappelle ces paroles d’un homme qui avait un excellent esprit : Mon père, dit-il, mon frère aîné et moi, nous avions trois manières de travailler tout-à-fait différentes. Mon père cassait tous les fils et les renouait facilement; mon frère les cassait aussi et ne les renouait pas toujours. Pour moi je tâche de ne les pas rompre, car je ne serai jamais sûr de les bien renouer. Je veux croire que Montesquieu est comme le père, et qu’il ne laisse jamais échapper le fil de ses idées, quoiqu’on n’en voie pas toujours l’enchaînement. Mais pour moi qui ne veux pas être comme le frère aîné, je n’ai d’autre moyen que de m’efforcer de faire comme le second. Je vais donc tâcher de pénétrer assez avant dans le fond du sujet, pour y trouver un point fixe d’où je puisse partir, et auquel je puisse tout rattacher.
On se fait, en général, du commerce une idée très fausse, parce qu’elle n’est pas assez étendue. Il est à peu près dans le même cas que ce que l’on appelle les figures de rhétorique. Nous ne remarquons ordinairement celles-ci que chez les rhéteurs et dans les discours d’apparat, en sorte qu’elles nous paraissent une invention très-recherchée et fort extraordinaire; et nous ne nous apercevons pas qu’elles nous sont si naturelles, que nous en faisons tous une quantité prodigieuse dans nos moindres discours, sans y penser. De même nous ne reconnaissons communément le commerce que chez les négocians qui en font une espèce de science occulte et un métier particulier; nous n’y voyons que le mouvement d’argent qu’il produit et qui n’en est pas le but; et nous ne faisons pas attention que nous commerçons tous incessamment et continuellement, et que la totalité du commerce pourrait s’effectuer sans argent et sans négocians. Car les négocians de profession sont les agens de certains commerces; l’argent en est le véhicule et l’instrument : mais ce n’est pas là proprement le commerce. Le commerce consiste essentiellement dans l’échange. Tout échange est un acte de commerce, et notre vie toute entière est une suite perpétuelle d’échanges et de services réciproques. Nous serions tous très-malheureux qu’il n’en fût pas ainsi; car nous serions réduits chacun à nos propres forces, sans pouvoir nous aider jamais de celles des autres. En considérant le commerce sous ce point de vue, qui est le vrai, on y voit ce qu’on n’y avait jamais remarqué. On trouve qu’il n’est pas seulement le fondement et la base de la société, mais qu’il en est pour ainsi dire l’essence, qu’il est la société elle-même. Car la société n’est autre chose qu’un échange continuel de secours mutuels, et cet échange produit le concours des forces de tous pour la plus grande satisfaction des besoins de chacun.
Il est donc ridicule de mettre en doute que le commerce soit un bien, et plus ridicule encore de croire qu’il puisse jamais être un mal absolu, ou seulement n’être utile qu’à une des parties contractantes. Il est toujours utile à un homme de pouvoir se procurer ce dont il a besoin, au moyen de ce dont il n’a que faire. Cette faculté ne peut jamais être un mal en elle-même; et quand deux hommes se donnent réciproquement et librement une chose qu’ils estiment moins, pour recevoir une chose qu’ils estiment plus, puisqu’ils la désirent, il est impossible qu’ils n’y trouvent pas tous deux leur avantage. Or, c’est là tout le commerce. Il est bien vrai que l’un des deux peut faire ce que nous appelons un mauvais marché, et l’autre en faire un bon : c’est-à-dire, que l’un, pour ce qu’il sacrifie, ne reçoit pas autant de la chose qu’il désire, qu’il aurait pu s’en procurer, et que l’autre en reçoit plus qu’il n’aurait dû l’espérer. Il se peut encore que l’un des deux, ou même tous deux, avait tort de désirer la chose qu’ils se procurent. Mais ces cas sont rares; ils ne font pas l’essence du commerce ; ils en sont des accidens, causés par certaines circonstances que nous examinerons par la suite, et dont nous verrons les effets. Il n’en est pas moins vrai que dans tout acte de commerce, dans tout échange libre, les deux contractans se sont satisfaits, sans quoi ils n’auraient pas contracté; et par conséquent, cet échange est en soi un bien pour tous deux.
Smith, si je ne me trompe, a remarqué le premier que l’homme seul fait des échanges proprement dit[1]. On voit bien certains animaux exécuter des travaux qui concourent à un but commun, et qui paraissent concertés jusqu’à un certain point, ou se battre pour la possession de ce qu’ils désirent, ou supplier pour l’obtenir; mais rien n’annonce qu’ils fassent réellement des échanges. La raison en est, je pense, qu’ils n’ont ni une idée assez nette de la propriété, pour croire qu’ils puissent avoir un droit sur ce qu’ils ne tiennent pas actuellement, ni un langage assez développé pour pouvoir faire des conventions expresses : et ces deux inconvéniens viennent, je crois, de ce qu’ils ne peuvent assez abstraire leurs idées, ni pour les généraliser, ni pour les exprimer séparément, en détail, et sous la forme d’une proposition. D’où*il arrive que les idées dont ils sont susceptibles, sont toutes particulières, confuses avec leurs attributs, et se manifestent en masse par des espèces d’interjections qui ne peuvent rien expliquer explicitement. L’homme, au contraire, qui a tous les moyens qui leur manquent, est naturellement porté à s’en servir pour faire des conventions avec ses semblables. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il fait des échanges et que les animaux n’en font pas. Aussi n’ont-ils pas de véritable société : car le commerce est toute la société, comme le travail est tout la richesse.
C’est encore Smith qui a aperçu cette seconde vérité, que nos forces étant notre seule propriété originaire, l’emploi de nos forces est notre seule richesse primitive. Elle l’a conduit à en voir une troisième bien importante; c’est que cette richesse s’accroît d’une manière incalculable par l’effet de la division du travail : c’est-à-dire, qu’à mesure que chacun de nous s’applique plus exclusivement à un seul genre de travail, ce travail devient incomparablement plus rapide, plus parfait, plus productif; en un mot, il augmente infiniment plus la masse de nos jouissances.
Comme on fait beaucoup de chemin quand on est dans une bonne route, Smith a encore été plus loin : il a observé que cette distribution du travail, si importante et si désirable, ne devenait possible que par les échanges et à proportion de leur nombre et de leur facilité. Car tant que chacun ne peut profiter en rien du travail d’un autre, il faut qu’il pourvoie lui-même à tous ses besoins, et par conséquent qu’il fasse tous les métiers. Quand ensuite les échanges commencent, un seul métier ne suffirait pas pour faire vivre un homme, il faut encore qu’il en fasse plusieurs. C’est le cas de bien des ouvriers dans les campagnes. Mais quand enfin le commerce s’anime et se perfectionne, non-seulement un seul métier, mais souvent la moindre partie d’un métier suffit pour occuper un homme tout entier, parce qu’il trouve toujours à placer le produit de son travail, quoique très-considérable et d’une seule espèce. Il me semble que l’on n’a jamais tenu assez de compte à Smith de cette dernière vue. Cependant elle est très-belle, et c’est là qu’il a trouvé la principale utilité du commerce, celle qu’il ne faut jamais perdre de vue, celle que l’on doit toujours et dans tous les cas regarder comme la plus essentielle de ses propriétés et le premier de ses avantages. Arrêtons-nous y un moment : et puisque c’est le commerce qui nous occupe actuellement, remarquons bien qu’à l’instant où les échanges commencent, commence aussi la société, et avec elle la possibilité que chacun a de se livrer exclusivement au genre d’occupation dans lequel il peut le mieux réussir, tant par ses dispositions naturelles, que par les circonstances dans lesquelles il se trouve. Lors de ce commencement, le commerce se fait directement et sans intermédiaire. Tout homme qui a quelque chose à vendre, est obligé de chercher un acheteur, et tout homme qui a quelque chose à acheter, est obligé de chercher un vendeur : en un mot, quiconque veut faire un échange, doit prendre lui-même la peine de chercher avec qui le faire. Bientôt par l’effet même de cette division du travail que le commerce provoque si puissamment, il se forme une classe d’hommes dont l’unique profession est d’éviter cette peine aux échangistes, et par là de faciliter beaucoup les échanges. Ces hommes sont connus sous le nom général de commerçans. Ensuite ils se subdivisent encore, et on distingue parmi eux des négocians, des marchands, des détaillans, des courtiers, des commissionnaires et autres agens de commerce, qui tous se rendent utiles en remplissant chacun une fonction différente. Considérons-les tous en masse : cela suffit pour notre objet.
Les commerçans sont là toujours prêts à acheter, quand quelqu’un veut vendre, et à vendre, quand quelqu’un veut acheter. Ils -font venir dans un endroit les denrées d’un autre, et réciproquement. Ainsi par leurs soins, chacun trouve tout de suite, à portée de soi, tout ce qu’il désire et tout ce qu’il ne pourrait souvent se procurer qu’avec beaucoup de peine et de temps. Leur travail est donc utile. Puisqu’il est utile, il doit leur procurer un salaire. Aussi se le procurent-ils facilement. On aime mieux vendre à meilleur marché chez soi que d’aller loin porter ses denrées. On aime mieux acheter plus cher à sa porte, que de se déplacer pour chercher ce qu’on désire. Les négocians achètent donc à bon marché et revendent cher. Voilà leur récompense. Ils peuvent la restreindre d’autant plus que les communications sont plus sûres et plus faciles, leurs frais et leurs risques étant moins grands. Quand les négocians sont rares, ils font des profits énormes; quand ils sont nombreux, ils se contentent de moins afin d’avoir la préférence. En cela ils sont comme les autres travailleurs. Quelque soit leur salaire, il est certain qu’il est pris sur les échangistes; mais il est pour ces échangistes d’une moindre valeur que les peines qu’il leur épargne. Ainsi ils gagnent, an moins en général, à faire ce sacrifice. La preuve en est qu’ils préfèrent presque toujours se servir de cet intermédiaire. L’existence de ces entremetteurs est donc utile.
L’explication de l’utilité des commerçai» m’amène à montrer l’utilité de l’argent; car il sert le commerce comme instrument, précisément de la même manière qu’ils le servent comme agens. On peut faire le commerce sans cet instrument et sans ces agens, mais ils le rendent plus facile. L’argent est une marchandise comme une autre, propre à différens usages, ayant comme toutes les autres sa valeur naturelle, qui est la valeur du travail nécessaire pour l’extraire de la terre et le façonner, et sa valeur vénale qui est celle des choses que l’on offre pour se le procurer, ainsi que nous l’avons expliqué dans nos observations sur le livre treizième. Mais cette marchandise a cela de particulier qu’elle est inaltérable, en sorte qu’on peut la garder sans craindre ni déchet ni avaries; qu’elle est toute de même qualité, quand elle est pure, en sorte qu’on peut toujours la comparer à elle-même sans incertitude de valeur; qu’elle est susceptible de divisions très-multipliées, très-justes, très constantes, de manière qu’elle se prête très commodément aux divisions de toutes les autres, depuis les plus précieuses jusqu’aux plus communes, depuis les plus petites masses jusqu’aux plus grandes. Voilà bien des avantages pour devenir le terme commun de comparaison de toutes les valeurs. C’est aussi ce qui arrive; et une fois que cela est ainsi, l’argent ne peut plus changer de valeur fréquemment et démesurément comme une autre marchandise, pour être trop recherchée dans un temps et pas assez dans un autre. Il ne peut varier de prix que faiblement et à la longue, suivant qu’il est un peu plus ou un peu moins rare. C’est là encore un autre avantage très-important pour être gardé. Ainsi quiconque possède une chose dont il n’a pas besoin, n’est plus obligé d’attendre pour s’en défaire, qu’il trouve à la troquer précisément contre celle qui lui est nécessaire. Pourvu qu’il en trouve de l’argent, il le prend, parce qu’il est sûr avec cet argent de se procurer tout ce qu’il voudra, quand il le jugera à propos, surtout lorsqu’il existe des commerçais toujours prêts à vendre de tout. Du reste, l’argent n’est pas plus la totalité de nos richesses, que les commerçans ne sont la totalité des échangistes. L’un est un outil, les autres sont des ouvriers qui servent au commerce, mais qui ne constituent pas le commerce. Il faut de cet outil et de ces ouvriers autant et pas plus qu’il n’est nécessaire, pour que le commerce se fasse. Quand il y a plus d’argent dans un pays, qu’il n’en faut pour la circulation, il faut l’envoyer au dehors ou en faire des meubles de différentes espèces; quand il y a trop de négocians pour la quantité des affaires qu’on peut y faire, il faut qu’ils s’expatrient, ou qu’ils prennent un autre état.
Les propriétés du commerce étant ainsi bien senties, et les fonctions des commercans bien entendues, il est aisé de voir que, si les commerçans ne sont pas indispensables, puisque le commerce peut avoir lieu jusqu’à un certain point sans eux, ils sont très-utiles, puisqu’ils le facilitent prodigieusement. Mais il ne paraît pas aussi aisé d’abord de décider, si leur travail est réellement productif, et s’ils méritent d’être rangés dans la classe productrice. Aussi des écrivains, qui n’ont voulu voir de production réelle que dans le travail qui nous procure les matières premières, et qui, en conséquence, ont refusé le nom de producteurs à ceux qui emploient ces matières (les artisans), ont, par suite, refusé le même titre à ceux qui les transportent (les négocians). Cependant c’est là une erreur où l’on tombe uniquement, parce que l’on ne sait pas soi-même ce que l’on veut dire par le mot de production.
M. Say, nous l’avons déjà dit, a fait disparaître toute cette logomachie par une seule observation bien juste: c’est que nous ne créons jamais un seul atome de matière, que nous n’opérons jamais que des transformations, et que ce que nous appelons produire, n’est jamais que donner un degré d’utilité de plus, par rapport à nous, à ce qui existait déjà. On pourrait dire de même, et avec autant de justesse, de nos productions intellectuelles, qu’elles ne sont jamais que des transformations des impressions que nous recevons de tout ce qui existe; impressions que nous élaborons, dont nous formons toutes nos idées, dont nous tirons toutes les vérités que nous apercevons, toutes les combinaisons que nous imaginons.
En effet, pour ne point sortir de l’ordre physique, les hommes qui tirent du sein de la terre et des eaux, par les travaux de la culture, de la pêche, de la chasse, des mines et des carrières, toutes les matières premières dont nous nous servons, ne font par leurs peines que commencer à disposer ces végétaux ces animaux, ces minéraux, à nous être utiles. Le métal vaut mieux pour nous que le minerai, une riche moisson mieux que la semence et le fumier dont elle provient. Un animal pris ou tué est plus près de nous servir, qu’un animal qui s’enfuit, et un animal apprivoisé plus qu’un animal farouche. Ces premiers travailleurs ont donc été utiles, ils ont été producteurs d’utilité, et c’est la seule manière d’être producteur.
Viennent ensuite d’autres travailleurs, ce sont les artisans, qui façonnent encore ces matières. Si le métal vaut mieux que le minerai, une pioche, une bêche ou un autre ustensile valent mieux qu’un bloc de foule.
Si le chanvre vaut mieux que le chènevis qui l’a produit, la toile vaut mieux que le chanvre, le drap mieux que la toison, la farine mieux que le bled, et le pain mieux que la farine, etc., etc. Ces nouveaux travailleurs sont donc encore des producteurs tout comme les autres, et de la même manière. Cela est si vrai, que souvent on ne peut les distinguer les uns des autres. Je demande que l’on me dise, si celui qui, avec de l’eau salée fait du sel, est un agriculteur ou un artisan, pourquoi celui qui tue un daim appartiendrait plus à l’industrie agricole, que celui qui l’écorche pour me faire des gants, et quel est le producteur du laboureur, du semeur, du moissonneur, ou même de celui qui a fait les fossés nécessaires pour rendre le champ productif.
Mais il ne suffit pas que les matières aient reçu leurs dernières façons pour que je puisse m’en servir; il faut encore qu’elles soient près de moi. Peu m’importe qu’il y ait du sucre aux Indes, de la porcelaine à la Chine, du café en Arabie; il faut qu’on me l’apporte. C’est ce que font les négocians; ils sont donc aussi producteurs d’utilité. Cette utilité est si grande, que sans celle-là les autres s’évanouissent. Elle est si palpable, que dans les endroits où une chose surabonde, elle n’a aucune valeur, et qu’elle en prend une très-grande quand elle est transportée dans ceux où elle manque :il faut donc ou renoncer à savoir ce qu’on veut dire, ou confesser que les négocians sont des producteurs comme tous les autres, et convenir que tout travail est productif, lorsqu’il produit des richesses supérieures à celles que consomment ceux qui s’y livrent. C’est là la seule manière raisonnable d’entendre le mot production. Voyez le chapitre treizième.
Il est vrai que par l’effet de l’industrie, que l’on nomme assez mal agricole, les matières changent le plus souvent de nature; que l’industrie manufacturière n’en change ordinairement que la forme, (encore cela n’est pas vrai des arts chimiques, et ils le sont presque tous plus ou moins); et que l’industrie commerçante ne fait que les changer de lieu. Mais qu’est-ce que cela fait, si ce dernier changement est utile comme les autres? si c’est une dernière façon nécessaire pour faire valoir toutes les autres? et si cette dernière façon est si fructueuse, qu’elle produit un accroissement de valeur très-supérieur aux frais qu’elle coûte?
On dira que cet accroissement de valeur souvent n’a pas lieu, et que souvent la marchandise est perdue, ou détériorée, ou arrive à contre-temps, et que le travail du commercant se trouve infructueux. Mais il en est de même du travail de l’agriculteur et du manufacturier, quand ils sont mal entendus ou contrariés par des accidens. On dira encore que souvent le commerçant ne fait que nous apporter des objets de consommations inutiles, que nous aurions été heureux d’ignorer, que nous y prenons goût, que nous nous ruinons pour nous les procurer, et qu’ainsi il nous appauvrit au lieu de nous enrichir. Mais il en est de même souvent de l’agriculture et des arts. Si je fais d’une vaste campagne un champ de roses, si j’emploie beaucoup de monde à les cultiver et à les recueillir, beaucoup de monde encore à les distiller, et qu’il ne résulte de tout cela que la satisfaction très-passagère de quelques belles dames qui se parfument en dépensant des sommes considérables, au moyen desquelles on aurait pu exécuter des ouvrages très durables et très utiles, certainement il y a perte de richesse; mais la perte n’est pas dans la production, elle est dans la consommation. Si on avait exporté cette essence de roses, on aurait pu avoir en retour beaucoup de choses de première nécessité. Dans tous les cas, il y a similitude complète entre le travail du commercant et celui de l’agriculteur ou du manufacturier. L’un n’est ni plus ni moins essentiellement productif que l’autre. Tous en ne réussissant pas, sont en pure perte ; tous en réussissant, produisent accroissement de jouissances. Si on consomme, c’est accroissement de richesse, si on ne consomme pas, c’est ruine entière. Au reste, peu importe le nom que l’on donne à l’industrie des commerçans, pourvu que ce nom ne conduise pas à de fausses conséquences, et que l’on voie bien ce que c’est que le commerce, dont les commerçans ne sont que les agens. Il me semble que nous nous en sommes rendu compte assez nettement, pour pouvoir poser quelques principes certains, et nous décider sur les différentes questions qui peuvent naître, d’après des vues générales et constantes. Revenons donc à notre auteur, et essayons d’examiner quelques-unes de ses opinions.
Montesquieu qui s’est épargné la peine que nous venons de prendre, semble ne voir dans le commerce que les relations des nations entr’elles, et leur manière d’influer les unes sur les autres. Il ne dit pas un mot du commerce qui se fait dans l’intérieur d’un pays; et il paraît supposer qu’il serait nul et d’aucun effet, et qu’il ne mériterait aucune considération, s’il ne devait pas donner le moyen de faire des profits sur les étrangers. Il pense en cela comme bien des écrivains et bien des hommes d’état trop admirés. Cependant, même dans cette supposition, le commerce intérieur demanderait encore toute notre attention; et dans tous les cas, il est toujours de beaucoup le plus important, surtout pour une grande nation. En effet, de même que tant qu’il n’y a pas du tout d’échanges entre les hommes d’un même canton, ils sont tous étrangers les uns aux autres et tous misérables, au lieu qu’en s’entr’aidant, ils augmentent prodigieusement leur puissance et leurs jouissances; de même dans un grand pays, si chacune de ses parties demeure isolée et sans communication, elles sont toutes dans le dénuement et dans une inaction forcée; au lieu qu’en formant des liaisons entr’elles, chacune profite de l’industrie de toutes, et y trouve l’emploi et le développement de ses propres ressources. Prenons pour exemple la France, parce que c’est une contrée très-vaste et très-connue. Supposons la nation française seule dans le monde, ou environnée de déserts impossibles à traverser. Elle a des portions de son territoire très-fertiles en grains, d’autres plus humides qui ne sont bonnes qu’aux pâturages, d’autres formées de coteaux arides qui ne sont bons qu’à la culture des vignes, d’autres enfin plus montagneuses qui ne peuvent guère produire que des bois. Si chacun de ces pays est réduit à lui-même, qu’arrive-t-il? il est clair que dans le pays à bled, il peut encore subsister un peuple assez nombreux, parce que du moins il a le moyen de satisfaire largement au premier de tous les besoins, la nourriture. Cependant ce besoin n’est pas le seul; il faut le vêtement, le couvert, etc. Ce peuple sera donc obligé de sacrifier en bois, en pâturages, en mauvaises vignes, beaucoup de ces bonnes terres, dont une bien moindre quantité aurait suffi pour lui procurer, par voie d’échange, ce qui lui manque, et dont le reste aurait encore nourri beaucoup d’autres hommes. Ainsi, ce peuple ne sera déjà pas si nombreux que s’il avait eu du commerce, et cependant il manquera de bien des choses. Cela est encore bien plus vrai de celui qui habite les coteaux propres aux vignes. Celui-là, si même il en a l’industrie, ne fera du vin que pour son usage, parce qu’il ne pourra pas le vendre. Il s’épuisera dans des travaux ingrats, pour faire produire à ses côtes arides quelques mauvais grains, ne sachant où en acheter. Il manquera de tout le reste. Sa population, quoique encore agricole, sera misérable et rare. Dans le pays de marais et de prairies, trop humide pour le bled, trop froid pour le riz, ce sera bien pis. Il faudra nécessairement renoncer à cultiver, se réduire à être pasteur, et même ne nourrir d’animaux qu’autant qu’on en peut manger. Pour le pays de bois, il n’y a de moyen d’y vivre que la chasse, à mesure et autant qu’on y trouve des animaux sauvages, sans songer seulement à conserver leurs peaux. Car qu’en ferait-on? Voilà pourtant l’état de la France, si vous supprimez toute correspondance entre ses parties. Une moitié est sauvage, et l’autre mal pourvue.
Supposez au contraire cette correspondance active et facile, quoique toujours sans relation extérieure. Alors la production propre à chaque canton ne sera plus arrêtée par le défaut de débouchés, et par la nécessité de se livrer, en dépit des localités, à des travaux très-ingrats, mais nécessaires faute d’échanges, pour pourvoir par soi-même, tant bien que mal, à tous ses besoins ou du moins aux plus pressans. Le pays de bonne terre produira du bled autant que possible, et en enverra au pays de vignobles, qui produira des vins tout autant qu’il trouvera à en vendre. Tous deux approvisionneront le pays de pâturages, où les animaux se multiplieront à proportion du débit, et les hommes à proportion des subsistances que leur procurera ce débit; et ces trois pays réunis, alimenteront jusque dans les montagnes les plus âpres, des habitans industrieux qui leur fourniront des bois et des métaux. On multipliera les lins et les chanvres dans le nord, pour envoyer des toiles dans le midi, qui multipliera ses soieries et ses huiles pour les payer. Les moindres coins de terre seront mis à profit. Une commune toute en cailloux fournira des pierres à fusil à toutes les autres qui n’en ont pas et qui en ont besoin; et ses habitans vivront des produits de ces échanges. Une autre toute en rochers enverra des meules de moulins dans plusieurs provinces. Un petit pays de sable va produire de la garance pour toutes les teintures. Quelques champs d’une certaine argile donneront de la terre pour toutes les poteries. Les habitans des côtes pouvant envoyer dans l’intérieur leurs poissons salés, s’occuperont sans cesse de la pêche. Il en sera de même du sel marin, des alkalis, des plantes marines, des gommes, des arbres résineux. On verra naître partout de nouvelles industries, non-seulement par l’échange des marchandises, mais encore par la communication des lumières. Car si nul pays ne produit tout, nul n’invente tout. Quand des communications sont établies, ce qui est connu dans un endroit l’est partout; et on a bien plutôt fait d’apprendre ou même de perfectionner que d’inventer. D’ailleurs, c’est le commerce lui-même qui inspire l’envie d’inventer; c’est même sa grande étendue qui seule rend possibles bien des industries. Cependant ces nouveaux arts occupent une foule d’hommes qui ne vivent de leur travail, que parce que celui de leurs voisins étant devenu plus fructueux, peut suffire à les paver. Voilà donc cette même France tout à l’heure si indigente, remplie d’une population nombreuse et bien approvisionnée, et par conséquent devenue heureuse et riche, sans qu’elle ait fait le moindre profit sur aucun étranger. Tout cela est dû au meilleur emploi des avantages de chaque localité, et des facultés de chaque individu; et remarquez que pour cela il est indifférent que ce pays soit riche ou pauvre en or et en argent. Car, si ces métaux précieux y sont rares, il en faudra une très-petite quantité pour payer une grande quantité de marchandises; s’il y en a beaucoup, il en faudra davantage. Voilà toute la différence. Dans les deux cas, la circulation se fera de même. Tels sont les miracles du commerce intérieur.
Je conviens que j’ai pris pour exemple un pays très-vaste et très-favorisé de la nature. Mais les mêmes causes produiraient les mêmes effets dans tous, proportion gardée de leur étendue et de leurs avantages, excepté toutefois dans ceux qui seraient absolument incapables de fournir les denrées de première nécessité en quantité suffisante. Pour ceux-là, il est certain que le commerce étranger est indispensable pour qu’ils soient habités, puisque lui seul peut les approvisionner de ces denrées nécessaires à la vie. Ils sont dans le cas des parties montagneuses ou marécageuses de la France dont nous venons de parler, qui ne doivent leur population qu’à leurs communications avec les parties fertiles. Pour tous les autres pays, le commerce étranger est de surérogation ou n’est qu’accessoire.
Je ne prétends pas pourtant nier l’utilité du commerce extérieur. Ce que nous venons de dire nous montre même quel est son plus grand avantage. En effet, puisque le commerce intérieur produit tant de biens par cela seul qu’il anime l’industrie, et puisqu’il n’anime si puissamment l’industrie que parce qu’il accroît la possibilité du débit, ou comme l’on dit, parce qu’il augmente l’étendue du marché pour les productions de chaque partie du pays, il est manifeste que le commerce extérieur en agrandissant encore prodigieusement le marché, augmente de même l’industrie et les produits. La France elle-même, quoique plus en état peut-être qu’aucun pays de se passer de tous les autres, serait cependant privée de beaucoup de jouissances, si elle ne tirait pas des denrées des quatre parties du monde : et plusieurs de ses fabriques actuelles, même des plus nécessaires, ont un besoin indispensable de matières premières qui viennent des extrémités de la terre. On peut même ajouter que certaines provinces, quoique faisant partie du même corps politique, ont souvent moins de facilité à communiquer entr’elles qu’avec certains pays étrangers. Ainsi il est plus aisé de faire arriver les vins de Bordeaux en Angleterre, les draps de Languedoc en Turquie, ceux de Sedan en Allemagne, que dans beaucoup de parties de la France; et réciproquement, beaucoup de choses peuvent souvent être tirées plus commode meut de l’étranger que du pays même qui les produit; et alors c’est une grande maladresse de s’en priver. Le commerce étranger sert donc aussi l’industrie; et ce que nous venons de voir des effets du commerce intérieur, nous prouve combien est précieuse cette propriété de développer l’industrie. Que penser donc de ceux qui ne tiennent aucun compte de cet avantage, qui ne font aucune attention au commerce intérieur, et qui ne voient dans le commerce extérieur qu’un moyen d’attraper quelques écus aux nations étrangères? on peut dire sans hésiter, qu’ils n’ont pas les premières notions de la manière dont se forment et se distribuent les richesses des nations. Il faut convenir que c’est le cas où se trouve notre auteur, malgré toutes ses lumières.
Aussi après quelques phrases vagues sur les effets moraux du commerce, (et nous en parlerons plus loin), il établit tout de suite qu’il y a deux espèces de commerce: le commerce de luxe, et celui d’économie; et fidèle à son système de faire tout dériver de trois ou quatre formes de gouvernement qu’il a jugé à propos de distinguer, il ne manque pas d’ajouter que l’un de ces deux commerces est plus convenable à la monarchie et l’autre à la république; et il trouve beaucoup de raisons pour que cela soit ainsi. Le vrai est qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de commerce de luxe. Qui dit luxe, dit consommation et même consommation excessive. Le commerce, l’industrie commerciale, fait partie de la production. Ces deux choses n’ont rien de commun. Si l’on entend par commerce de luxe, que les uns dépensent ce que les autres gagnent, gagner est une chose, et manger en est une autre toute différente[2]. Si commerce de luxe veut dire le commerce des choses servant au luxe, rien n’empêche que les républicains hollandais n’apportent de la porcelaine de la Chine, des schalls de Cachemire, des diamans de Golconde, quoique ce soient des courtisans français ou allemands qui aient la sottise de les acheter. Dans tous les cas, M. Say a bien raison de dire: Tout cela ne signifie absolument rien. Il en faut dire autant des raisonnemens, par lesquels Montesquieu croit prouver qu’un commerce toujours désavantageux peut être utile, ou que la faculté accordée aux négocions de faire ce qu’ils veulent, serait la servitude du commerce; ou que l’acquisition que l’on peut faire de la noblesse à prix d’argent, encourage beaucoup les négocions; ou que les mines d’Allemagne et de Hongrie font valoir la culture des terres, tandis que le travail de celles du Mexique et du Pérou la détruit, et autres maximes de la même force. De tout cela on est obligé de conclure encore avec M. Say, que quand un auteur parlant de ces choses, se forme une vue si peu nette de leur vraie nature, si par hasard il vient à rencontrer une vérité utile, et s’il lui arrive de donner un bon conseil, c’est fort heureux. Achevons donc d’expliquer nettement, s’il se peut, les effets du commerce extérieur. Jusqu’à présent cela n’a jamais été fait suffisamment; et si nous y réussissons, ce ne sera point par hasard, mais bien par les déductions les plus rigoureuses, que cette connaissance nous conduira à beaucoup de vérités utiles trop méconnues.
Nous avons vu que, de même que le commerce d’homme à homme constitue seul la société, et est la cause première de toute industrie et de toute aisance, de même le commerce de canton à canton et de province à province dans l’intérieur du même corps politique, donne un nouvel essor à cette industrie et produit un nouvel accroissement de bien-être, de population et de moyens et que le commerce extérieur augmente encore tous ces biens, que le commerce intérieur a fait naître, et contribue à mettre en valeur tous les dons de la nature, en rendant le travail des hommes plus fructueux et plus productif[3]. Cette propriété est le plus grand de tous les avantages du commerce extérieur; et quoique vraiment incalculable, cet avantage peut pourtant être représenté par des nombres qui en donneront une idée approximative. Imaginons vingt hommes travaillant séparément et sans s’aider : ils feront de l’ouvrage comme vingt; et si nous les supposons tous égaux en capacité, ils auront des jouissances chacun comme un. S’ils se réunissent et s’entr’aident-, par cela seul ils feront de l’ouvrage comme quarante et peut-être comme quatre-vingts; et par conséquent ils jouiront chacun comme deux ou comme quatre. S’ils profitent de cet avantage, du loisir qu’il leur procure, de l’esprit qu’il leur donne, pour découvrir de nouvelles ressources, pour inventer de nouveaux moyens, pour se procurer de nouvelles matières premières, ils pourront produire comme cent soixante, comme trois cent vingt, et jouir comme huit ou comme seize: enfin leur industrie se perfectionnant indéfiniment, car il est impossible d’en assigner le terme, ils arriveront peut-être, s’ils sont très intelligens ou très favorisés de la nature, jusqu’à produire comme mille et même comme deux mille, et par suite à jouir chacun comme cinquante ou comme cent, si l’égalité subsiste entr’eux, ou à vivre cent ou deux cents sur le même terrain où ils n’étaient que vingt, et à avoir encore des jouissances comme dix au lieu d’un, le tout sans avoir gagné la moindre chose sur aucun étranger. Ces évaluations ne sont pas forcées, elles sont même au-dessous de la vérité. Il y a plus que cette différence entre l’isolement sauvage et la société créée et perfectionnée par l’invention des échanges, surtout si cette société était assez bien ordonnée pour que l’égalité s’y maintînt, ou que du moins l’inégalité s’y introduisît le moins possible, et que par suite beaucoup de moyens ne devinssent pas inutiles ou nuisibles. (Voyez l’article du luxe, chap. septième). Le plus grand avantage du commerce extérieur, on ne saurait trop le répéter, est donc certainement de contribuer à cet heureux phénomène; et c’est celui auquel on n’a presque jamais pensé, et que l’on a toujours été prêt à sacrifier à l’appât d’un gain sordide et à l’apparence du moindre profit à faire sur l’étranger. Je dis à l’apparence ; je ne prétends pas insinuer par là que ce profit soit toujours illusoire; c’est ce que nous verrons : je soutiens seulement que c’est à tort qu’il a été l’objet unique de la plupart des politiques, et qu’il n’est rien, en comparaison de l’avantage qu’a le commerce de créer la société et de développer l’industrie, avantage qui appartient éminemment au commerce intérieur, auquel contribue subsidiairement le commerce extérieur, ce qui constitue à mes yeux son plus grand mérite. Au reste, puisqu’on a attaché une importance très exagérée au profit direct qu’une nation peut faire sur les nations étrangères par le moyen de son commerce avec elles, il convient d’examiner plus en détail ce profit, pour voir nettement en quoi il consiste, et jusqu’à quel point on peut le connaître.
Le commerce extérieur peut être profitable, ou plutôt les négocians qui le font, peuvent augmenter directement la masse des richesses nationales par les gains qu’ils font sur les étrangers avec lesquels ils trafiquent; et cet effet ils peuvent le produire de plusieurs manières différentes.
Premièrement, ils peuvent n’être que les voituriers et les commissionnaires des étrangers. Dans cette supposition, ils sont plutôt artisans que commerçans. En cette qualité, ils reçoivent des salaires. Ils vivent de ces à salaires, quand même leur pays ne produirait rien. C’est une somme de richesses qu’ils y importent. S’ils la consument toute entière à leur subsistance annuelle, elle se borne à entretenir dans le pays une portion de population qui n’y existerait pas sans elle. S’ils ne l’emploient pas en totalité, et s’ils font quelques économies, ces économies sont autant d’ajouté à la masse permanente des richesses nationales.
Secondement, ils peuvent aller acheter dans un pays étranger des denrées qui y sont à bon marché, et les revendre dans un autre où elles sont chères. La différence suffit pour payer la subsistance de ceux qu’ils emploient et la leur, en un mot, tous leurs frais, et leur donner un bénéfice. Ce bénéfice, soit en argent, soit en denrées, et même toute la partie de leurs frais gagnée par les nationaux, est une masse de moyens qu’ils ont ajoutés à ceux de leur patrie, puisque tout cela est payé par des étrangers.
Si cette masse de moyens n’est pas totalement consommée annuellement, ce qui en reste économisé est autant d’ajouté au fonds de la richesse nationale. Ce second cas est celui du commerce de transport.
Troisièmement, les commerçans prennent chez eux des denrées, qui n’ont qu’un vil prix dans le grand marché de l’Europe et de toutes les nations civilisées; ils les portent au loin, et ils rapportent dans leur pays d’autres denrées, qui ont une grande valeur chez toutes ces nations. La différence dans ce cas couvre les frais et bien au-delà. Ces frais, fussent-ils payés à des étrangers, il y a bénéfice. C’est cette opération que l’on fait, quand on va chez des sauvages troquer des grains de verre et autres bagatelles contre de la poudre d’or, de l’ivoire, des fourrures et autres choses précieuses. Certainement alors on a augmenté la masse des richesses de la société dont on fait partie. Il n’est pas nécessaire, pour en être sûr, de savoir si ces richesses importées sont consommées dans le sein de cette société ou réexportées, gaspillées ou mises à profit. C’est là une autre question. C’est celle de la consommation; elle est étrangère à celle de la production. Ces richesses peuvent être perdues de nouveau, mais elles sont acquises; c’est tout ce qu’il nous faut pour le moment.
Quatrièmement, les négocians peuvent aller chez des étrangers acheter des matières premières, les faire fabriquer chez eux, et les reporter avec profit à ces mêmes étrangers ou à d’autres. C’est ce que font des marchands français qui tirent d’Espagne des cuirs bruts qu’ils y renvoient tannés, et des laines qu’ils y renvoient en draps. Leur bénéfice, et même le salaire de tous leurs agens, est un profit pour leur patrie; car l’objet unique de ce commerce étant de fournir les étrangers, toute l’industrie qu’il met en œuvre est exclusivement payée par eux. Les artisans qu’il emploie sont à la solde de ces étrangers, comme les voituriers et les matelots qui leur conduisent la marchandise. Aussi ce commerce est-il, de beaucoup, celui de tous qui fait entrer le plus de richesses dans le pays : mais il est à remarquer que cet effet, il le produit bien moins par les bénéfices du négociant, qui peuvent être très-peu de chose, que par la grande masse d’industrie qu’il développe et qu’il met en mouvement. Car le développement de l’industrie est toujours, dans toutes les suppositions et sous tous les rapports, ce qu’il y a de plus utile à une société d’hommes.
Enfin le cinquième genre de commerce extérieur, est celui qui consiste à exporter toutes les denrées et marchandises dont on n’a pas besoin, que sans ce commerce on n’aurait aucun intérêt à produire, et qu’assurément on ne produirait pas, et à importer toutes celles dont on manque absolument ou qu’on ne pourrait se procurer chez soi que beaucoup plus chèrement. C’est ce commerce qui a lieu le plus ordinairement entre les nations. Les autres dont nous venons de parler ne sont, pour ainsi dire, que des cas particuliers et d’exception. C’est celui-ci qui compose la presque totalité du commerce extérieur de la plupart des peuples. C’est lui qui secourt puissamment le commerce intérieur en agrandissant le marché, et qui l’aide à atteindre ce but si important, d’augmenter les facultés des citoyens en développant leur industrie, et de les approvisionner de tous les moyens de jouissance que cette industrie les met en état d’acquérir. Cet objet est si capital, cet intérêt est si majeur, qu’il absorbe tous les autres, et qu’il faut ne compter pour rien parmi les avantages de ce commerce, le bénéfice que peuvent y faire les négocians qui en sont les agens.
Il faut pourtant que ce bénéfice ait lieu pour que les négocians prennent la peine de faire le service; et s’il n’avait pas lieu, ce serait une preuve que leur service n’est ni utile ni agréable; et que leurs opérations sont sans objet. Elles cesseraient. Ce bénéfice a donc lieu. Mais premièrement, il est nécessairement pris en partie sur les nationaux, et il est impossible de déterminer la part qu’ils ont dans les sacrifices que les agens de l’échange exigent des échangistes. Secondement, il est nécessairement partagé par les négocians étrangers avec lesquels ceux du pays correspondent, et il est bien vraisemblable qu’en général les uns et les autres respectivement gagnent à peu près ce que les vendeurs et les acheteurs de leurs pays sacrifient. Ainsi ce n’est point une conquête sur l’étranger. Troisièmement enfin, et il faut encore le répéter, ce bénéfice est une misère, en comparaison des autres avantages de ces transactions et de l’immense masse de richesses qu’elles mettent en mouvement et qu’elles font naître; et j’ose affirmer, contre l’opinion vulgaire, qu’il ne mérite aucune attention de la part du politique philosophe. Ainsi on ne doit point compter ce commerce, de beaucoup le plus utile et le plus considérable de tous, au nombre de ceux qui augmentent directement la masse des richesses nationales, précisément parce qu’il est celui qui les augmente le plus indirectement. Voilà, je pense, les principales espèces de commerce qu’une nation peut faire à l’étranger. Cette classification n’est pas très rigoureuse, il ne faut pas y attacher trop d’importance. Elle a son inconvénient, comme toutes les classifications; c’est que les êtres réels se plient difficilement à ces manières générales et abstraites de les considérer. Il n’y a peut-être pas une seule opération commerciale effective et réellement existante, qui puisse être rangée exclusivement et uniquement dans une de ces cinq classes, et qui n’appartienne pas aux autres par quelques unes de ses parties. Néanmoins, cette analyse des effets les plus marquans du commerce extérieur commence à répandre sur cette matière quelques lumières, et nous met à même d’examiner ce que nous devons penser de ce que Ton appelle communément la balance du commerce.
Il faut convenir que ces deux mots n’offrent pas toujours une idée bien nette; et peut-être même que si ceux qui les ont le plus employés, avaient creusé davantage dans le fonds du sujet, ils auraient trouvé qu’ils n’ont aucun sens. Cependant sans trop se rendre compte ni de la cause du fait, ni de la manière dont il arrive, ni de la possibilité qu’il arrive, quand on croit qu’une nation envoie plus de valeurs à l’étranger qu’elle n’en reçoit, on dit généralement que la balance lui est défavorable; et dans le cas contraire, on dit qu’elle est en sa faveur. Voilà ce qu’on entend à peu près par cette balance du commerce que l’on a tant d’envie de faire pencher de son côté.
Mais premièrement, il est manifeste que, pour que cette idée de balance ne soit pas tout-à-fait chimérique, il ne faut pas borner le mot valeurs à ne représenter que les espèces monnaies ou même les métaux précieux; car l’or et l’argent sont bien loin d’être notre seule richesse ou même la principale partie de nos richesses, et il est très-clair que quand je donne pour cinq cents francs d’argent et que je reçois pour six cents francs de marchandises, je gagne cent francs, et que, par conséquent, une nation pourrait faire beaucoup de profits sur une autre à laquelle pourtant elle enverrait plus d’argent qu’elle n’en recevrait d’elle. Cette seule raison, quand il n’y en aurait pas beaucoup d’autres, suffirait pour prouver que le cours du change dont on tire tant de conséquences téméraires, est un indice très-insignifiant de l’état de la balance. Car il ne peut tout au plus qu’indiquer que l’on verse plus d’argent d’un côté que de l’autre; et encore il ne le fait que d’une manière très-peu sûre. Or, se décider sur ce seul symptôme, c’est juger du tout par une partie, et par une partie très-mal connue.
Secondement, il n’est pas moins évident que, même en admettant la double supposition qu’une nation civilisée peut recevoir d’une autre nation civilisée aussi, plus ou moins de valeurs qu’elle ne lui en livre, et qu’on peut le savoir, pour juger de la balance du commerce pour ou contre cette première nation, il faut au moins bien réunir toutes les branches de son commerce extérieur, et ne pas se décider d’après l’examen d’une partie séparée et isolée. Car il se pourrait que cette nation ne perdît avec une autre que pour gagner davantage avec une troisième, ou n’achetât très-cher une denrée dans un endroit que pour en vendre une autre encore plus cher en retour, ou pour s’en procurer d’autres à très-grand marché. C’est donc uniquement de l’ensemble que l’on peut juger, si toutefois on peut le faire.
Mais pour en juger, il faut le connaître. Or, est-il bien certain qu’on puisse le connaître, même à peu près ou plutôt à beaucoup près? Prenons d’abord la quantité des marchandises, qui est la circonstance la plus facile à constater. Quelque rigoureux que soit devenu le régime des douanes dans beaucoup de pays, il n’y a aucun gouvernement qui puisse se flatter de connaître exactement par ses employés la quantité de toutes les marchandises qui passent les frontières, soit pour entrer, soit pour sortir. Les produits de la contrebande sont toujours considérables et impossibles à savoir au juste. Les déclarations des marchandises qui passent sans fraude, sont toujours infidèles. Celles qui ne pajent rien, soit en entrant, soit en sortant, (et il y en a toujours beaucoup), sont déclarées très-négligemment ou même ne le sont point du tout. Ainsi on est déjà bien loin de son compte, même pour la quantité, qui est pourtant ce qu’il y a de moins difficile à vérifier. C’est bien pis pour la qualité. Cependant elle influe bien davantage sur les valeurs. Nos richesses sont si multipliées et si diversifiées, nous avons porté tant de recherche et de variété dans la préparation et la confection des produits de la nature et des arts, qu’il y a souvent la différence d’un à cent, d’un à mille, entre les valeurs de deux choses à peu près du même genre, ou qui passent aux barrières sous les mêmes dénominations générales; et ajoutez que ce sont toujours les plus précieuses qui sont dissimulées ou même totalement cachées, parce qu’en général elles sont peu volumineuses. Il est donc vraiment impossible d’avoir une connaissance, même approximative, de la valeur des marchandises exportées ou importées parle commerce; et c’est s’abuser absolument que d’accorder quelque confiance, à cet égard, à des déclarations grossières et à des relevés de registres nécessairement imparfaits et incomplets.
Ce n’est pas tout. Quand on connaîtrait exactement la quantité et la qualité, et par suite la valeur de toutes les marchandises importées et exportées dans le cours d’une année, il faudrait encore savoir combien il en a coûté pendant cette même année à tous les négocians du pays pour opérer ces transports, c’est-à-dire, tout ce qu’ils ont dépensé en commis, en agens, en vaisseaux, en agrès, en nourriture et en payement d’équipages et de rouliers, jusqu’à ce que chaque chose soit arrivée à sa dernière destination. En un mot, il faudrait connaître la masse de tous leurs frais. Car ces frais sont des sommes avec lesquelles ils payent du travail, et avec lesquelles ils pourraient le payer pour produire des choses utiles, qui augmenteraient le total de la richesse nationale. Ces sommes doivent
donc être déduites de la valeur des richesses importées. Or, ce dernier article est encore plus impossible à connaître que les autres. On n’a nul moyen, nul élément pour s’en faire une idée même approximative. Les intéressés même ne le savent pas, ou du moins ne sauraient pas dire quelles de ces dépenses doivent être attribuées au seul commerce extérieur, ou imputées au commerce intérieur, et quelles sont gagnées par l’étranger ou parle compatriote. Elles se perdent, elles se fondent dans la circulation générale. Voilà donc encore un inconnu important.
Enfin on pourrait bien aussi critiquer avec raison la fixation des valeurs des marchandises, faite à l’endroit où est la douane. Ce n’est pas là où elles ont été achetées, ce n’est pas là qu’elles seront employées. Or, c’est dans ces deux endroits que leur valeur réelle est constatée et réalisée. Plusieurs de ces denrées ont été ou seront avariées, avant ou après le moment où vous les mettez à prix à votre bureau de douane. D’autres gagneront beaucoup à être rendues à leur destination, ou seulement par le seul effet du temps qui les L oui fie. Quelle nouvelle source d’incertitudes!
Si avec tant de desiderata, quelqu’un peut se persuader de savoir quelque chose de la balance dont il s’agit, c’est un intrépide faiseur de chiffres. Mais il y a bien plus. Quand on le saurait, quand on supposerait, ce qui est impossible, que l’on sait réellement de science certaine que, dans le cours d’une ou de plusieurs années, il est entré effectivement dans un pays une somme de valeur plus grande que celle qui en est sortie, à quoi cela mènerait-il? Premièrement, cette différence ne saurait être considérable, car elle ne peut consister que dans le gain définitif de tous les négocians de ce pays employés au commerce étranger. Or, c’est bien peu de chose presque partout, en comparaison de la masse totale. Cela ne peut faire un objet important que dans quelques petits états, où une forte portion de la population subsiste du commerce de transport par mer. Secondement, on n’en peut rien inférer pour l’accroissement ou la diminution de la richesse nationale. Car si cette nation qu’on suppose avoir plus importé qu’exporté pendant un temps, a, pendant ce même temps, consommé tout ce qu’elle a importé, elle est réellement appauvrie de la valeur de tout ce qu’elle a exporté, et dont il ne lui reste rien, quoiqu’elle ait gagné dans les changes; si au contraire elle a beaucoup emmagasiné, ou ce qui revient au même, si elle a fait chez elle de grands ouvrages utiles et durables, elle peut avoir accru la somme de ses moyens, c’est-à-dire, avoir augmenté son fonds, s’être enrichie, quoique dans le même temps, elle ait fait quelques pertes à l’extérieur.
Concluons donc avec Smith, qu’il n’y a de véritable balance que celle entre la production et la consommation de tout genre. C’est celle-là qui est la vraie mesure de l’appauvrissement ou de l’amélioration. C’est elle qui par des progrès lents, trop souvent contrariés, a amené graduellement les peuplades humaines de leur misère primitive à un état plus heureux. C’est elle qui, grâces à l’activité, a l’intelligence des hommes et à l’énergie de leurs facultés, serait partout et toujours en faveur de l’humanité, si ceux qui gouvernent les sociétés, ne les égaraient et ne les désolaient pas incessamment. L’état de cette balance n’est pas aisé à constater immédiatement par un calcul direct. Il faudrait faire, pour ainsi dire, le bilan d’une nation à deux époques données, et pouvoir faire entrer dans son actif et dans son passif, non-seulement ses richesses matérielles et ses dettes positives, mais les vérités et les erreurs dont elle est imbue, les bons et les mauvais sentimens dont elle est animée, les habitudes utiles ou nuisibles auxquelles elle est livrée, et les institutions funestes ou bienfaisantes qu’elle s’est données. On sent qu’un tel état de compte est impossible à dresser. Mais les effets de cette balance, qui est la seule réelle, sont très-sensibles à l’œil de l’observateur philosophe. Pour celle du commerce proprement dite, c’est une pure illusion ou une misérable vétille, bonne uniquement à faire briller quelques subalternes trompeurs ou trompés, aux yeux de quelques supérieurs ignorans ou prévenus.
Il y a pourtant un résultat précieux et certain à recueillir des états, même très imparfaits, des importations et des exportations. D’abord il faut bien se mettre dans l’esprit que les unes sont toujours à peu près égales aux autres, et que la légère différence qui peut exister accidentellement entr’elles, en supposant même qu’on puisse l’apercevoir, est peu importante. Mais ensuite lorsque l’on voit que les unes et les autres sont très considérables, par rapport au nombre d’hommes dont la nation est composée, on peut être assuré que cette nation a beaucoup de capacité, beaucoup de richesses, et que par conséquent chacun de ses membres a beaucoup de jouissances, si toutefois ces richesses sont bien réparties entr’eux. Car tout ce qu’ils ont exporté, ils avaient trouvé le moyen de se le procurer, et tout ce qu’ils ont importé en retour, est autant de moyens de jouissances dont ils peuvent user sans s’appauvrir, pourvu qu’ils n’altèrent pas leurs fonds. Ainsi quand on voit la valeur de ces exportations et importations augmenter graduellement et constamment dans un pays, pendant un certain nombre d’années, on peut conclure avec assurance, ou que le nombre de ses habitans est augmenté, ou que chacun d’eux a plus d’aisance, si une inégalité trop choquante ne s’y est pas établie, ou même que ces deux marches progressives existent; car elles ont presque toujours lieu en même temps. Dans le cas opposé v on peut se tenir pour certain des résultats contraires. On sent bien qu’il ne faut pas comprendre dans la masse des richesses circulantes dont je parle, celles qui ne feraient que passer par la voie du commerce de simple transport: elles n’indiqueraient que la grandeur de ce commerce, et non pas celle de sa production. Mais avec cette précaution, notre conclusion est très-sûre, ainsi que toutes les conséquences qu’on en peut tirer. C’est à peu près là tout ce que peuvent nous apprendre les registres des douanes; mais ce fait est important, et ils nous l’apprennent avec certitude, sans qu’il soit besoin pour cela de les compulser bien minutieusement.
Telles sont les principales réflexions qui m’ont été suggérées par les deux livres de l’Esprit des Lois qui nous occupent actuellement. Il serait peut-être à propos de placer encore ici quelques remarques sur les effets moraux du commerce. Mais c’est un trop vaste sujet, si on veut entrer dans les détails; et si on n’en prend que les sommités, il est aisé de voir que le commerce, je veux dire l’échange, étant la société elle-même, il est l’unique lien entre les hommes, la source de tous leurs sentimens moraux, et la première et la plus puissante cause du développement de leur sensibilité mutuelle et de leur bienveillance réciproque. Nous lui devons tout ce que nous avons de bon et d’aimant. Il commence par réunir tous les hommes d’une même peuplade; il lie ensuite ces sociétés entr’elles, et il finit par unir toutes les parties de l’univers. Il n’étend, ne provoque et ne propage pas moins les lumières que les relations. Il est l’auteur de tous les biens. Sans doute il cause des guerres comme il occasionne des procès, et c’est surtout grâces aux fausses vues des prétendus adeptes qui lui sont si nuisibles. Mais il n’en est pas moins vrai que, plus l’esprit de commerce s’accroît, plus celui de ravage diminue, et que les hommes les moins querelleurs sont toujours ceux qui ont des moyens paisibles de faire des gains légitimes, et qui possèdent des richesses vulnérables. Quant à la prétendue avidité que le commerce proprement dit inspire à ceux qui en font leur état spécial, c’est un reproche vague qu’il faut rejeter parmi les déclamations les plus insipides et les plus insignifiantes. L’avidité consiste à ravir le bien d’autrui par violence ou par souplesse, comme dans les deux nobles métiers de conquérant et de courtisan. Mais le négociant, comme tous les autres hommes industrieux, ne cherche son bénéfice que dans son talent, en vertu de conventions libres, et en réclamant la foi et les lois. Application, probité, modération, leur sont nécessaires pour réussir, et par conséquent ils contractent les meilleures de toutes les habitudes morales. Si l’occupation continuelle de se procurer un gain, les rend quelquefois un peu âpres pour leurs intérêts, on peut dire que l’on désirerait dans son ami quelque chose de plus libéral et de plus tendre; mais on ne peut pas exiger la perfection des hommes pris en masse: et un peuple qui serait, en général, modelé sur ceux que nous venons de peindre, serait le plus vertueux de tous les peuples. C’est le désordre qui est le plus grand ennemi de l’homme : partout où il y a ordre, il y a bonheur. J’aime et j’admire ceux qui font du bien : mais que seulement personne ne fasse du mal, et vous verrez comme tout ira. Ajoutez que l’homme laborieux, fait plus de bien à l’humanité même en n’en faisant pas à dessein, que n’en peut jamais faire l’oisif le plus philanthrope avec tout son zèle. Je crois devoir me borner à ce peu de mots sur ce sujet. Qu’il me soit seulement permis d’ajouter encore que, si le commerce intérieur est toujours un bien, le commerce extérieur en lui-même et livré à lui-même, ne peut jamais être un mal. Sans doute, si dans l’intention de fournir plus abondamment un article de commerce à des négocians étrangers qui le demandent, un gouvernement gêne ou prohibe la production d’une autre denrée utile ou nécessaire au bien-être des habitans, comme cela est arrivé quelquefois en Russie et ailleurs, sans doute, dis-je, dans ce cas il vaudrait mieux n’avoir point de relations à l’extérieur. Mais ce n’est pas là la faute du commerce, c’est celle de l’autorité. De même en Pologne, où un petit nombre d’hommes est propriétaire non-seulement de tout le sol, mais encore de toutes les personnes qui le cultivent, quand ces propriétaires ramassent tout le blé que leurs serfs s’épuisent à cultiver, pour le vendre à l’étranger, et acheter en retour des objets de luxe qu’ils consomment, tout le monde n’en est que plus misérable. Il vaudrait mieux que ces magnats ne trouvassent pas à vendre leurs grains. Ils essayeraient peut-être d’en nourrir des hommes auxquels ils tâcheraient d’apprendre à fabriquer au moins une partie des choses qu’ils désirent. Mais encore une fois ce n’est pas là la faute du commerce. On peut même ajouter, qu’encore dans ce cas, par son effet lent et inévitable d’appauvrir les prodigues en leur offrant des jouissances, et d’éclairer les malheureux en faisant pénétrer parmi eux quelques hommes moins abrutis, il tend nécessairement à amener un ordre de choses moins détestable. On peut en dire autant des guerres absurdes et ruineuses, que l’on fait trop souvent pour conserver l’empire et le monopole exclusif de quelques colonies lointaines. Ce n’est point encore là le commerce, mais la manie de la domination et la démence de l’avidité, ou comme disait Mirabeau du papier monnaie forcé, et comme on pourrait dire de bien d’autres choses, c’est une orgie de l’autorité en délire. Voilà, ce me semble, une partie de ce que notre auteur aurait dû développer avec toute l’éloquence et la profondeur de vues dont il était doué, au lieu de tant de choses insignifiantes ou fausses qu’il a laissé échapper de sa plume, au milieu de beaucoup d’autres qui sont admissibles.
[1] Voyez l’admirable chapitre 2 du premier livre de son Traité des Richesses. Je regrette qu’en remarquant ce fait, il n’en ait pas recherché plus curieusement la cause; ce n’était pas à l’auteur de la Théorie des sentimens moraux à regarder comme inutile de scruter les opérations de l’intelligence. Ses succès et ses fautes devaient également contribuer à lui faire penser le contraire.
[2] Nous l’avons déjà dit, chap. 7. Un joaillier n’a point de luxe, quoiqu’il dépense beaucoup en pierreries. Ce sont ceux qui se parent de ces bijoux qui ont du luxe.
[3] N’oublions jamais que travail productif est celui dont il résulte des valeurs supérieures à celles que consomment ceux qui s’y livrent. Le travail des soldats, des gouvernans, des avocats, des médecins, peut être utile, mais il n’est pas productif, puisqu’il n’en reste rien. Celui d’un agriculteur on d’un manufacturier, qui dépenserait dix mille francs pour en produire cinq, n’est point productif non plus, et ne saurait être utile à moins qu’il ne le soit comme expérience.

