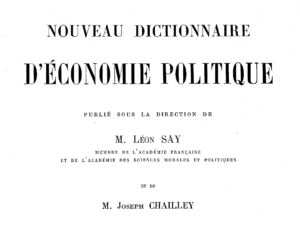
Dans l’introduction au Nouveau dictionnaire d’économie politique (1891), Joseph Chailley (dit Chailley-Bert, du nom de son beau père décédé — procédé curieux) expose les ambitions et l’économie générale de cette somme qui doit succéder au Dictionnaire de Coquelin et de Guillaumin, paru en 1852-1853. Pour raffermir l’école libérale sur ses bases, Chailley et son adjoint, Léon Say, font le choix d’écarter certains libéraux radicaux ou qui ne s’accordent pas avec eux sur des questions fondamentales comme la colonisation. Ils livrent, de ce fait, une image très précieuse du « nouveau » libéralisme, alors dominant, qui étouffera la tradition héritée de Turgot, J.-B. Say ou Bastiat, avant de périr lui-même, écrasé par le poids croissant de ses propres compromissions.
INTRODUCTION
Une introduction n’est pas une apologie ; ce n’est pas davantage une œuvre de polémique. C’est, au seuil d’un ouvrage étendu, quelques brèves indications qui permettent au lecteur de s’y reconnaître et de se guider.
Pourquoi nous avons été amenés à entreprendre ce dictionnaire ; comment nous l’avons conçu et exécuté et quelle en peut être l’utilité pratique ; enfin, quelle en est la doctrine : tels sont les points sur lesquels nous avons le devoir de nous expliquer.
I.
Notre siècle pourrait s’appeler le siècle des dictionnaires. Dans tous les ordres d’idées, littérature, science, histoire, beaux-arts, politique, administration, les quarante dernières années en ont vu paraître une masse énorme. Le Dictionnaire de l’économie politique, publié sous la direction de MM. Guillaumin et Coquelin, a été l’un des premiers. C’était aussi l’un des meilleurs. Il a rendu d’immenses services. Mais dans presque toutes les branches des connaissances humaines, à côté de la science déjà constituée ou en voie de se constituer — partie durable, sinon définitive— il y a l’art, application à des réalités contingentes des lois abstraites de la science, et cette partie-là est essentiellement changeante. Dans le Dictionnaire de l’économie politique, cette partie avait rapidement vieilli, au point d’enlever à l’ouvrage une portion notable de son utilité.
C’est que de véritables révolutions économiques s’étaient accomplies presque au lendemain de son apparition. Il avait prononcé l’oraison funèbre du socialisme, et bientôt le socialisme renaissait et se répandait sur le monde entier ; il avait dénoncé les prohibitions et les droits protecteurs, et, peu après, un régime de liberté commerciale s’épanouissait — pour peu de temps, d’ailleurs — par presque toute l’Europe ; il avait lutté contre l’État en faveur de l’individu, et voici que l’État triomphait, tandis qu’entre l’individu et l’État grandissait démesurément ce troisième pouvoir, annoncé par les Saints-Simoniens, l’association.
Ces changements se sont encore accentués jusqu’à nos jours ; des révolutions nouvelles ont succédé aux révolutions d’alors, si bien qu’aujourd’hui presque aucune question ne reste posée comme il l’avait posée : ni les rapports du capital et du travail, ni les rapports de l’individu et de l’État, ni même ceux des producteurs et des consommateurs.
Malgré de si profondes modifications dans les faits, l’œuvre de Guillaumin et de Coquelin n’avait pas été modifiée. On ne pouvait plus, au bout de trente années, se contenter de la remanier : il fallait la refaire de toutes pièces. C’est de cette nécessité qu’est sorti le Nouveau Dictionnaire d’économie politique.
II.
Un dictionnaire expose le lecteur à deux chances principales d’erreur.
Chaque article forme un tout. C’est, en soi, sur un sujet donné, un petit traité distinct et complet. Or, dans la vie et dans la science, il n’y a pas de sujet distinct et complet. Isoler un sujet, ce n’est qu’un artifice d’étude. Les phénomènes s’enchaînent à d’autres phénomènes qui en altèrent la physionomie et la signification. Les questions se soudent à d’autres questions qui en modifient la position et en corrigent la portée. La forme même de dictionnaire, qui impose des articles séparés, est donc une première cause d’erreur.
En voici une seconde. Un dictionnaire est rarement l’œuvre d’un seul. Ordinairement, il est, il semble même préférable qu’il soit le résultat de la collaboration de plusieurs. Mais si bien d’accord que soient les collaborateurs sur le fond même de la science, ils ne peuvent pas ne pas se diviser sur quelques points. De là, des divergences et des contradictions qui menacent d’égarer le lecteur.
Voici ce que nous avons imaginé pour parer à ce double inconvénient.
Les articles du Nouveau Dictionnaire d’économie politiqueont été reliés les uns aux autres au moyen de renvois placés aux endroits convenables. Et ces renvois peuvent avoir une double signification. Ou bien ils avertissent le lecteur que telle conclusion n’est pas absolue, que telle doctrine n’est pas définitive et qu’en telle place il trouvera des objections ou des arguments qui peuvent influencer son opinion ; ou bien ils lui signalent l’existence d’autres articles qui complètent un exposé ou apportent des faits nouveaux à l’appui d’une théorie. Par ce procédé, nous avons sans cesse rappelé le lecteur à l’idée de relativité.
Quant aux contradictions, voici comment nous nous sommés efforcés de les éviter. D’abord, nous n’avons fait appel qu’à un nombre restreint de collaborateurs unis dans une doctrine commune.Si l’on met à part les rédacteurs de certains articles spéciaux, on verra à quoi se réduit la liste de ceux qui ont exposé les phénomènes fondamentaux, base de la théorie, ou la doctrine même de l’économie politique. C’était là une première garantie, nous en avons ajouté une seconde,
Autant que nous l’avons pu, nous avons chargé une même personne de rédiger tous les articles qui dépendent d’un même sujet. Quand l’ampleur de la tâcheen a exigé deux ou trois, ces deux ou trois étaient rattachées par des liens scientifiques étroits.
Au surplus, aucun de nos collaborateurs n’a écrit un mot avant de s’être mis d’accord avec nous sur le fond de la doctrine.
Nous avons donné une place importante à certaines parties que l’on pourrait, dans un Traité d’économie politique pure, considérer comme accessoires, mais dont la connaissance permet seule de comprendre les théories de l’économie politique pure. Ce sont, par exemple, les questions de commerce, d’agriculture, de banque, de monnaie, de finances publiques et, dans un autre ordre d’idées, les questions de prévoyance, de coopération, de participation aux bénéfices, d’association, et enfin ce qu’on appelle la doctrine des socialistes. Nous y avons exposé les faits avec impartialité, tous les faits, même ceux qui étaient le plus contraires à nos doctrines propres, et déjà certains de nos adversaires nous ont remerciés de leur avoir préparé un si riche arsenal.
Les articles consacrés à l’étude des auteurs s’arrêtent, pour des raisons que l’on comprendra, à l’époque contemporaine.
La bibliographie, placée à la suite de chaque article, ne comprend qu’un nombre d’ouvrages modique. Nous aurions cru embarrasser le lecteur, en citant indistinctement cent titres et cent noms, parmi lesquels il n’aurait su que choisir.
Enfin, nous avons, pour lui offrir plus de facilités, dressé trois tables.
La première, table bibliographique, comprend les noms et les ouvrages de tous les auteurs, même contemporains, dont il est fait mention dans le dictionnaire ;
La seconde, table méthodique, indique l’ordre dans lequel on pourra lire les divers articles de ce dictionnaire pour s’en servir comme d’un Traité d’économie politique ;
La troisième, table analytique, rassemble, par ordre alphabétique, toutes les indications éparses sur un sujet donné.
Telles sont les dispositions que nous avons adoptées pour augmenter la valeur doctrinale et l’utilité pratique de ce dictionnaire.
Nous n’espérons pas avoir fait une œuvre sans défaut. Nulle œuvre de ce genre n’en est exempte. Et nous connaissons déjà, par des critiques d’ailleurs sollicitées, une partie de ce qui manque à notre travail.
Mais le public lui a été indulgent. Au moment où nous écrivons ces lignes, alors que le dernier article vient à peine de paraître, nous sommes obligés de songer à préparer une seconde édition.
Dans cette édition, qui ne saurait, d’ailleurs, être l’œuvre d’un jour, nous tâcherons assurément d’améliorer notre travail. Quant à nos doctrines, nous croyons pouvoir dire qu’elles ne changeront guère.
III.
Nos doctrines sont celles de l’école libérale. Nos maîtres s’appellent Turgot et Adam Smith, J.-B. Say et Stuart Mill, Cobden et Bastiat, Herbert Spencer, et, dans une certaine mesure, les positivistes français. Ces noms seuls attestent que nous sommes d’une école de progrès.
L’économie politique, telle que l’avaient conçue Turgot, Adam Smith, J.-B. Say tenait tout entière, dans un mot : liberté. Liberté du commerce, liberté de l’individu ; échange libre et libre initiative. D’Argenson avait déjà dit : « Pas trop gouverner. » Après lui, élargissant sa pensée, les économistes avaient répété : « Laissez faire, laissez passer. » Ils estimaient que tout va à souhait quand rien n’est réglementé. La richesse des nations est faite de la richesse des individus. Vous voulez la nation prospère ; laissez les individus agir à leur guise. Leur intérêt vous répond de leur activité ; dans la poursuite du bonheur et du bien-être, ils sauront trouver la voie la plus facile et la plus courte. Donnez-leur la sécurité ; garantissez contre la violence leurs instruments de travail, leurs champs, leurs ateliers, en un mot leur propriété. Pour le reste, souffrez qu’ils soient libres de travailler à leur heure et à leur façon, libres de vendre, où et comme il leur plaît, le fruit de leur labeur ; pas d’entraves ; pas de tutelle.
Et derrière cette doctrine économique, il y avait toute une philosophie capable de satisfaire les esprits les plus généreux. Ce culte, cette constante revendication de la liberté s’appuyaient, chez les fondateurs et les adeptes de cette grande école, sur une foi profonde dans les progrès de l’esprit humain. Prétendre que les réglementations sont inutiles, que l’individu sait mieux que personne ce qui peut lui convenir et que rien ne peut dépasser en clairvoyance et en hardiesse l’initiative privée, cela revient à dire que tout homme a reçu sa part de raison et de sagesse ; que cette raison et cette sagesse, développées, dans le lent travail des siècles, par l’étude et l’expérience, sont aujourd’hui des guides suffisants et qu’il serait téméraire d’en vouloir chercher d’autres.
Voilà quelles étaient les théories de l’école libérale.
Il est de mode, à cette heure, de parler des premiers économistes avec quelque dédain. La société moderne leur doit tout simplement la liberté du travail, qui est en économie politique ce qu’est en philosophie la liberté de penser. Cette liberté du travail, il semble de même qu’on en fasse aujourd’hui bon marché. Ce qui paraissait à nos pères le premier des biens serait, si l’on en croit certains esprits, pour beaucoup d’entre nous, une gêne et un fardeau, et la liberté réglementée, la liberté diminuée sinon supprimée serait, dans une partie du monde civilisé, jugée une garantie de bien-être matériel et de paix sociale. Et toute une école, qui jouit d’une autorité considérable, est née de ce sentiment.
Certes, dans les théories des premiers économistes, dans les théories, du reste, de tous ceux qui ont contribué à la Révolution, il est des parties : l’ordre naturel, le droit naturel, la créature parfaite au sortir des mains du créateur, l’égalité absolue de tous les hommes, qui sont dès longtemps condamnées. Mais d’autres demeurent intactes et, par exemple, la clairvoyance des intérêts particuliers, base solide de notre économie politique, n’a pas été entamée et c’est pourquoi toutes les nations ont inscrit et maintenu dans leurs codes la liberté des contrats.
Au surplus, depuis les physiocrates, l’école libérale a marché. Auguste Comte, Littré et tous leurs disciples, par leur conception de la sociologie, Stuart Mill et ceux qui, en Angleterre, en France, en Suisse, en Italie, se rattachent à son école, par leurs travaux d’économie politique pure, ont à la fois élargi et précisé la science. Et, grâce à leurs travaux, nous avons pu, d’une part, assigner à l’économie politique sa juste place parmi les sciences sociales ; d’autre part, joindre au principe fondamental de la liberté le principe de la coopération sociale, c’est-à-dire de la solidarité.
D’autres que nous se recommandent de la solidarité ; mais il ne l’entendent pas de la même façon. Leur solidarité n’a rien de scientifique ni rien de général ; elle est quelque chose d’accidentel, elle est une des formes de la pitié, elle implique pour la société l’obligation de faire échapper des individus ou même des classes d’individus aux conséquences fâcheuses de leurs actes ou des actes d’autrui. Elle suppose un mal survenu et elle prétend le réparer. Notre solidarité a nous, a quelque chose d’inéluctable ; elle implique l’enchaînement nécessaire des actes de tous les hommes et leur répercussion fatale sur toute la société. Elle montre à l’individu ce que peuvent entraîner pour lui les fautes de ses semblables et l’intérêt qu’il a à les prévenir.
Avec cette conception, nous sommes devenus l’école de l’activité individuelle et de la responsabilité collective. L’homme formé à nos leçons comprend qu’il aura, par quelque côté, à souffrir des erreurs que peut commettre le voisin et dès lors il s’efforce de le soutenir et même de l’élever. Il ne laisse pas la société se peupler de faibles et de mendiants catalogués ; il ne va pas s’asseoir dans le fauteuil capitonné du socialisme d’État, moyen commode de reposer à bon compte son indifférence sur des lois plus ou moins efficaces ; spontanément, il paye de sa personne, il prêche d’exemple, il instruit, il stimule ceux qui l’entourent, il pousse chacun à la place que ses talents lui assignent.
Or, il ne faut pas craindre de dire qu’ainsi comprises les doctrines de l’école libérale, ces doctrines qu’on a dénoncées ici, comme chimériques, et là, comme insensibles, sont, sur le terrain scientifique, autrement solides, et sur le terrain philosophique, autrement consolantes, que les doctrines des écoles qui se dressent en face d’elles.
Voici, par exemple, que depuis un siècle a surgi et que, depuis quarante ans, règne à peu près incontestée, dans les sciences naturelles, la grande école de l’évolution, avec la théorie de la sélection naturelle, ou, comme dit Herbert Spencer,de lapersistance du plus apte. Cette école n’ose pas encore donner ses conclusions dernières. Mais nous les pressentons tous. La lutte pour l’existence, la constante élimination des êtres les plus faibles, l’avènement inéluctable des mieux doués, qu’on nous a présentés comme nécessaires dans le monde végétal et dans le monde animal, les savants et les philosophes n’hésitent pas, dans leur for intérieur, à croire que l’espèce humaine y est, comme les autres espèces, sujette. Et devant cette affirmation, que deviennent les écoles de la sentimentalité ? Comment concilier leur vague espoir que les forts dirigeront et protégeront les faibles avec cette implacable élimination naturelle des faibles par les forts ?
Or, nous, en face de la loi de l’évolution et de la sélection naturelle, nous montrons que dans la vie sociale rien ne va si tous ne s’en mêlent ; nous expliquons le progrès par la coopération de tous ; nous faisons apparaître les liens multiples et résistants qui rattachent ensemble toutes les classes ; nous ennoblissons toutes les tâches, nous relevons toutes les conditions, nous encourageons toutes les énergies. Vous avez succombé sous les efforts de concurrents plus habiles arrivé trop tôt à une situation trop lourde vous n’avez pas pu en porter le poids. Vous étiez chef d’industrie vous voici ouvrier. Consolez-vous et espérez votre rôle peut être encore considérable. Soyez bon ouvrier ; les bons ouvriers font les bons patrons ; les bons patrons, les industries prospères ; les industries prospères, les nations puissantes. Le pays peut vous devoir beaucoup. Et plus tard vos fils, formés par vous, et gravissant un par un les échelons que vous aviez trop vite escaladés, pourront reprendre et garder la place où vous étiez monté prématurément.
Voilà les nobles enseignements de l’école de la liberté et ces enseignements-là, nous ne les désapprendrons jamais.
Un jour, un étranger, qui a occupé dans sa patrie les plus hautes situations, vint demander à l’un de nos maîtres de lui enseigner l’économie politique. « Et, lui dit-il, l’économie politique libérale ; que je sois à même de répondre à mes adversaires ; tous s’en vont en Allemagne apprendre la religion de l’État ; moi, je suis venu en France apprendre la liberté. »
C’est pour les esprits comme le sien que ce dictionnaire a été conçu et exécuté. Toutefois, étroitement attachés aux idées de liberté et persuadés de la justesse des doctrines de l’école libérale dans leur ensemble, nous n’avons jamais poussé le respect jusqu’à la superstition. Des faits nouveaux ont surgi qui ont influencé nos théories. Malthus ne retrouverait plus intacte chez nous sa loi de la population J.-B. Say nous estimerait bien tièdes dans la lutte contre l’État et la défense des droits de l’individu ; les économistes qui ont préparé la Révolution s’indigneraient de notre indulgence pour l’association et les anciens adversaires des Compagnies coloniales de notre tendresse pour les colonies; enfin Adam Smith s’inquiéterait de voir notre économie politique si compréhensive, tandis que nos glorieux physiocrates se demanderaient jusqu’où nous l’avons ravalée pour n’en plus faire qu’une des parties dont se compose la science sociale, laquelle n’est elle-même qu’une des parties de leur philosophie.
Les doctrines de l’école libérale, nous les avons donc maintenues, mais non pas dans leur intégrité. Nous en avons corrigé ce qui nous a paru des erreurs et modéré ce qui nous a paru des exagérations.
Si nous avions tenu compte non plus seulement des faits, mais encore du pur mouvement scientifique, nous eussions pu faire davantage.
Un certain nombre de nos théories ont été, depuis quelque temps, discutées et combattues en France et surtout à l’étranger. Nous citerons la théorie du capital, la théorie de la valeur, les notions fondamentales de la richesse, la théorie de la répartition ou, comme nous disons dans un langage que nous croyons plus scientifique, de l’appropriation des richesses, etc. Sur ces diverses questions, il a été écrit des ouvrages ingénieux. Nous aurions pu, quelques-uns diront que nous aurions dû, en tenir compte. Nous ne l’avons pas fait, et voici pourquoi.
Les ouvrages dont nous venons de parler et les théories qu’ils renferment s’adressent à des savants, et non pas aux lecteurs d’un dictionnaire, lequel n’est, après tout, qu’une œuvre de vulgarisation. Il y a, dans la position des questions et dans l’enchaînement des raisonnements, des subtilités qui dérouteraient notre public. La théorie de la valeur, pour ne prendre que celle-là, cette théorie, centre de l’économie politique, a été l’objet de travaux considérables, mais qui aboutissent jusqu’ici à des conclusions si peu éloignées des nôtres que des savants seuls peuvent saisir et apprécier l’intérêt de si minutieuses études.
Il y a plus. Aucune de ces théories n’a un caractère, ne disons pas définitif — dans n’importe quel ordre de science, qu’est-ce qui est définitif ? — mais un caractère arrêté. Récemment un de nos maîtres défendait Bastiat. Et, pour le défendre : « ses théories, disait-il, ont pu se maintenir quinze ans ». Les auteurs des théories nouvelles ne sont pas si ambitieux. Ils ne se sentent pas en sécurité ; ils multiplient les réserves ; ils se corrigent sans cesse ; dans les revues qui les accueillent, l’article d’aujourd’hui revient sur ce qu’énonçait l’article d’hier. Tout cela fait l’éloge de leur conscience scientifique ; mais tout cela constitue autant d’obstacles à l’exposition des questions qu’ils traitent devant le grand public, ami des solutions nettes et peu curieux d’étudier la science, non pas en voie de transformation, mais en mouvement.
À ces deux raisons, qui ont bien leur importance, il en faut ajouter une troisième qui est autrement décisive: il y a, dans tous ces travaux — sauf une exception indiquée plus loin — un vice capital, qui est un vice de méthode.
IV
À Dieu ne plaise que nous nions le mérite des hommes dont s’enorgueillissent justement les écoles étrangères. Dans ces écoles, il s’est fait, surtout depuis une vingtaine d’années, une dépense énorme de travail et de talent : on peut se demander si ce talent et ce travail ont toujours été bien dépensés.
Toutes ces écoles, si l’on considère non pas les nationalités, mais les doctrines, peuvent se ramener à deux l’école anglo-française et l’école allemande. L’école anglo-française a construit de toutes pièces l’économie politique qui, pendant un siècle, sans cesse remaniée et perfectionnée, a prévalu dans le monde. L’école allemande, au contraire, venue plus tard, s’efforce de la démolir. Or, quand on cherche pour quelles raisons et par quels procédés, on peut douter, en admettant qu’elle réussisse à détruire, qu’elle soit apte à réédifier.
Aucune théorie n’est éternelle. Les théories ne sont que les chemins par lesquels nous nous efforçons d’atteindre à la vérité ; la vérité, du moins la vérité des hommes, n’est pas immuable, et les voies qui y conduisent se déplacent avec elle. Les théorieséconomiques de l’école anglo-française ne pouvaient donc pas prétendre demeurer intactes. Elles devaient subir une révision. Cette révision fut faite sur nombre de points. Stuart Mill — j’entends Stuart Mill l’économiste, le Stuart Mill d’avant l’exagération d’une influence délicieuse et pernicieuse tout ensemble — StuartMill, qui sut si bien mettre à profit les travaux de ses contemporains et, avec lui et après lui, quelques-uns de nos maîtres français, ont accompli là une œuvre de critique qui, devant l’histoire impartiale, leur fera honneur. Jamais peut-être, dans notre science, tant d’idées n’ont été remuées, jamais plus d’idées justes et de critiques pénétrantes n’ont été lancées dans le monde. Mais l’école allemande, qui avait pendant quarante ans ignoré le positivisme français, n’a, cette fois encore, de l’œuvre de nos maîtres, presque rien retenu. Elle s’est lancée à l’aventure dans la reconstitution de la science et, dès les premiers pas, s’est fourvoyée.
Au lieu de prendre comme point de départ les théories reçues jusqu’alors — lesquelles, on n’ose pas le nier, renferment une très grande part de vérité — au lieu de rechercher par où ces théories pouvaient pécher, elle a rejeté en masse tout un corps de doctrines, non pas parce qu’il était démontré faux ou seulement erroné, mais parce qu’il ne répondait pas, parce qu’il faisait obstacle à certaines aspirations.
L’école allemande, si l’on examine ses doctrines de haut, est une et homogène. Et néanmoins cette école a traversé deux phases distinctes, et l’on peut, sans trop d’inexactitude, dire qu’il y a une ancienne école et une nouvelle école économique allemande. Ce qu’elles ont de commun, c’est le respect, c’est le culte de l’État, ou plutôt du pouvoir, quel qu’il soit. L’Allemagne n’a jamais été romanisée ; elle a, presque sans interruption et presque jusqu’à nos jours, gardé intactes ses institutions propres, et notamment ses organisations communales, ses associations, ses corporations, etc. Elle n’a donc pas été, comme les Latins, portée invinciblement vers l’individualisme ; loin de là, elle y répugnait. La notion de l’État était profondément en elle, et par là elle se trouvait en quelque sorte destinée à la répandre dans le monde, comme elle fait aujourd’hui. Mais avant de commencer cette prédication, il lui fallait renverser un obstacle puissant. L’économie politique a pris naissance en France et en Angleterre. Au siècle dernier et pendant une partie de celui-ci, le prestige de ces deux nations était immense et la fascination que les écrivains et les savants allemands exercent aujourd’hui, ce sont les nôtres et les Anglais qui l’exerçaient alors, même au-delà du Rhin. Aussi dans l’ancienne école économique allemande rencontre-t-on, à côté de purs représentants de la doctrine germanique de l’étatisme, des représentants nombreux et remarquables de l’individualisme sous toutes ses formes. Mais du jour où l’Allemagne, après la Prusse, prit en Europe une place grandissante, et qui plus tard devint prépondérante, elle échappa à notre influence scientifique comme à notre influence politique et revint à ses théories et à ses aspirations traditionnelles. Dans l’ordre économique, les représentants de l’individualisme ne laissèrent guère d’héritiers, et, grâce à leur disparition presque complète, on peut dire qu’il se forma alors comme une nouvelle école allemande.
La nouvelle école allemande est donc née il y a environ une quarantaine d’années ; mais elle ne fait guère parler d’elle que depuis vingt ans. Or, il y a vingt ans, deux faits considérables se produisirent. L’unité allemande une fois constituée, deux puissances entrèrent en scène : d’une part, le parti socialiste, que Marx venait (1867) d’armer pour la lutte, devenu d’ailleurs formidable par l’explosion soudaine de l’industrie allemande et ne redoutant plus, au lendemain des triomphes militaires, d’être accusé de lèse-patrie, voulut jouer un rôle dans les affaires du pays ; et, d’autre part, le prince de Bismarck, créateur de l’Allemagne nouvelle, résolut de lui assurer une vie politique et économique digne d’un grand empire. En conséquence, le parti socialiste formula avec netteté et hardiesse ses revendications, et le prince de Bismarck, à la fois pour devancer près du peuple les socialistes de diverses nuances et pour s’attacher les classes dirigeantes, préluda à cette politique et à cette économique qui ont abouti directement au socialisme d’État, et, après quelques tergiversations, au protectionnisme.
C’est à ce moment, précisément, que la nouvelle école allemande prit son essor.
Nous ne lui ferons pas, comme quelques-uns, l’injure de dire qu’elle reçut le mot d’ordre des puissants du jour, encore moins qu’elle plia ses doctrines à ses intérêts. On ne peut pas croire à la bassesse de toute une école. Mais les revendications des socialistes, d’un côté, les prétentions du chancelier de fer, de l’autre, surgissant en même temps, l’émurent et l’influencèrent d’une façon profonde, en sorte que, sans y songer, au lieu de faire seulement de la science, elle fit aussi du sentiment et de la politique.
Ses dénominations mêmes indiquent bien ses origines et ses tendances. Je ne mentionne que pour mémoire celle de Katheder Socialisten, due à une circonstance toute fortuite ; mais elle s’appelle école éthique, elle s’appelle école interventionniste, et chacune de ces dénominations est un programme. École éthique, elle rechercha la part qu’il faut que la morale prenne dans la vie économique des hommes et des sociétés ; école interventionniste, elle prétendit déterminer l’influence et la direction qu’il faut que l’État exerce sur la conduite des individus. C’étaient moins des économistes que des directeurs de conscience et des conseillers de gouvernement.
La nouvelle école, faisant de l’économie politique la servante de la politique, s’efforça donc de plier les théories aux désirs et aux prétentions des hommes et à ce qu’elle croyait être des nécessités nouvelles. Tandis que l’ancienne estimait que la nature humaine ne peut être modifiée que par la lente transformation des milieux, ou, dans un même milieu, par le travail plus lent encore de l’éducation, la nouvelle école semblait croire à l’action des lois des hommes sur la conduite des hommes. Tandis que l’ancienne, s’appuyant sur ce qu’elle considérait comme le fonds même de la nature humaine, répondait, à contre-cœur, par des négations à des revendications dont notre temps n’a pas, comme on paraît le croire, le monopole, accordant seulement par bienveillance ce qu’elle refusait au nom du droit, la nouvelle, au contraire, cherchait à faire sortir de ses théories la notion de l’obligation.
Il y avait là une tentative, non pas seulement chimérique, mais anti-scientifique. Quelques-uns des plus distingués d’entre les Allemands s’en sont bien aperçus, et ils ont refusé de s’engager dans cette voie. Ils ont affirmé que la science devait être impartiale et indépendante ; ils ont déclaré qu’ils avaient, quant à eux, l’esprit libre et qu’ils ne seraient ni les amis de l’État ni les défenseurs de l’individu ; qu’ils n’étaient ni des libéraux ni des socialistes d’aucune école ; qu’ils croyaient à l’action, d’ailleurs inégale, et de l’égoïsme et de l’altruisme. Mais, en même temps, ils ont prétendu que l’économie politique n’existait pas en tant que science, qu’elle reste encore à fonder, qu’il importait d’y travailler sans esprit de système, sans préconception, et que tout d’abord il fallait dégager une méthode scientifique. Cette méthode, reprenant une voie déjà suivie et déjà abandonnée, ils crurent que ce pourraient être l’étude attentive des faits dans le passé, par l’histoire, et l’observation minutieuse et l’enregistrement des faits dans le présent, par la statistique, laquelle n’est qu’une branche de l’histoire :de là, cette dernière dénomination d’une même école école historique.
Rassembler des faits, en montrer la valeur absolue et la valeur relative ;opérer patiemment sur une infinie variété de milieux, d’époques et de circonstances ; amasser, par un travail consciencieux, des matériaux solides, base inébranlable de la théorie que quelque homme de génie viendra dégager plus tard, tel est le labeur prodigieux auquel a déclaré se vouer cette école de néo-bénédictins.
En attendant, ceux de cette école qui ne sont pas ouvertement socialistes forment une petite phalange qui vit sans doctrines ; elle est, au sens littéral du mot, impartiale : elle n’a pas pris de parti ; et son travail capital a consisté à se donner une méthode.
Or, cette méthode — il faut le redouter beaucoup plus que le souhaiter, car le seul intérêt de la science nous conduit et qui nous apporterait un bon instrument de travail aurait droit à notre gratitude —, cette méthode est probablement impraticable et assurément entachée d’erreurs. Elle repose dans le passé sur l’histoire, dans le présent sur la statistique : deux bases peu sûres.
Considérez combien de problèmes redoutables suppose résolus la prétention d’édifier une théorie économique sur l’étude des faits passés. Il faut d’abord réunir sur des questions qui ont ordinairement si peu préoccupé les contemporains, des documents authentiques et assez nombreux pour qu’on puisse les rapprocher et les éclairer les uns par les autres ; il faut déterminer exactement le caractère de la société et du milieu auxquels ces documents se rapportent ; il faut enfin les interpréter, c’est-à-dire en calculer, pour cette société et pour ce milieu, la signification précise. Que de chances d’erreurs ! Et quand ce prodigieux tour de force aura été accompli, on n’aura pas encore fait la centième, la millième partie du chemin. Car tant de travail ne nous a fourni de renseignements — précis, nous voulons le croire — que pour une seule époque et pour un seul milieu et comme nous sommes ici dans le domaine de l’induction, comme nulle société ne suit fidèlement les traces de celles qui l’ont devancée, comme nulle génération n’est exactement semblable à celle qui précède, il faut, sous peine d’erreurs irréparables, sillonner la route d’innombrables jalons. Qu’une seule époque nous demeure obscure, qu’un seul milieu nous reste fermé, la chaîne se rompt, et notre théorie économique, rappelant le cas fâcheux de la théorie cosmogonique de la création naturelle qui, pour relier, d’une façon plausible, les espèces et les familles, s’est vue obligé d’inventer des types de toutes pièces, va tomber dans la pure fantaisie.
Ce n’est pas tout : supposez, dans cette recherche des documents du passé, un bonheur insolent et, dans cette interprétation, une habileté prestigieuse, notre œuvre est encore bien fragile. Comme toutes les sciences, l’histoire se rajeunit par périodes et se renouvelle sans cesse. Chaque jour lui apporte un lot de documents imprévus qui modifient l’aspect des choses, bouleversent la position des questions et, avec elles, les théories qu’on avait laborieusement échafaudées.
Après cela, sommes-nous au bout de nos déceptions ? Nullement.
Les documents du passé, sur lesquels nous raisonnons, on les a supposés sincères. Mais le seront-ils ? Ils le seront peu ou point. Ils le seront dans la mesure où les hommes le sont eux-mêmes. Or les documents émanés des hommes sont suspects. À l’heure même où ceci est écrit, dans le pays même où la méthode dite historique a été sinon inventée, du moins le plus prônée, l’histoire n’est trop souvent que l’instrument d’une politique de combat et, soit pour légitimer le passé soit pour préparer l’avenir, dénature les faits à plaisir.
Du moins, la statistique, cette forme particulière de l’histoire, nous sera-t-elle un auxiliaire plus précieux ? Oui, quand elle sera largement enseignée et vulgarisée et que les agents chargés de noter les multiples aspects de la vie économique et sociale seront nombreux et compétents ; et encore à la condition que leur compétence même, qui leur permet de prévoir les conséquences des faits et des chiffres relevés, ne les détourne pas de rester, comme ils le doivent, d’honnêtes machines à enregistrer. Mais tant que les statisticiens de profession, c’est-à-dire des hommes qui ont la science et la conscience, seront l’infime minorité ; tant qu’il leur faudra se résoudre par impuissance ou bien à n’étudier qu’un seul phénomène entre cent ou qu’une seule face de ce phénomène, ou bien à s’adjoindre, comme on fait pour le Censusdes États-Unis, une légion d’auxiliaires ignorants ; enfin, tant que la statistique sera au service de gouvernements qui l’influenceront pour servir leurs intérêts, comme a fait, par exemple, cette nation qui, en vue de rassurer ses créanciers, a doublé les chiffres de ses exportations, tant que toutes ces causes d’erreurs subsisteront, la statistique ne devra inspirer à l’économie politique qu’une très mince confiance. Elle pourra être employée, avec beaucoup de discrétion et de prudence, à vérifier, à contrôler une théorie, mais à l’édifier jamais.
La méthode de travail des économistes allemands, basée comme elle l’est sur l’interprétation de l’histoire et des statistiques, est donc entachée de très graves erreurs.
Mais ceci n’est pas tout encore. Quand on travaille ainsi sur des documents, documents du passé et documents du présent, on est, pour une foule de causes connues et trop longues à énumérer, invinciblement ramené à l’étude de son propre pays. Et alors, on commet presque nécessairement une nouvelle erreur : à chaque pas, on risque de confondre la science, qui est chose universelle, et l’art, qui est chose nationale. C’est ce qui était arrivé à certains écrivains de l’école anglo-française. C’est ce qui est arrivé aux écrivains de l’école allemande : ils ont fait, presque malgré eux, une économie politique nationale[1]. Cela d’ailleurs n’est pas nouveau chez eux. List avait, il y a cinquante ans, donné l’exemple. Pour ces raisons, particularisme économique et surtout erreur fondamentale de méthode, l’école allemande n’a jusqu’ici fourni que peu de chose à la science universelle.
Toutefois, il est une école étrangère à laquelle la science économique doit beaucoup et de qui surtout elle doit beaucoup attendre : cette école, c’est la nouvelle école autrichienne, à la tête de laquelle est le célèbre professeur Carl Menger.Cette école, à un moment donné, s’est séparée de l’école allemande ; elle a répudié et la méthode historique et la pure méthode documentaire ; elle a proclamé qu’il convient d’étudier l’homme non pas dans les manifestations extérieures mais dans les causes impulsives de son activité ; elle a réhabilité, avec un grand éclat, la méthode psychologique, et, par un retour imprévu, s’est, comme Henry George, quoique par d’autres voies, rapprochée de l’école des physiocrates, de Ricardo et de nos maîtres les plus illustres. Ce rapprochement, la science doit en tirer parti comme la France peut en tirer vanité.
Toutefois ne triomphons pas trop bruyamment. L’école française contemporaine a des raisons d’être modeste.
V
Après une période glorieuse pendant laquelle elle a jeté sur la science le plus vif éclat, l’école française, qui débute avec Quesnay, grandit prodigieusement avec Turgot, se discipline avec J.-B. Say et s’épanouit avec Dunoyer, Bastiat et Michel Chevalier, pour ne parler que des morts, cette école semble avoir aujourd’hui perdu quelque peu de sa vitalité. Elle fait encore figure dans le monde ; mais son autorité, d’ailleurs décroissante, elle la doit surtout au passé, et à quelques talents vigoureux, héritiers directs du passé. Supprimez une douzaine de noms illustres ou célèbres, dont quelques-uns sonnent aussi haut que celui de n’importe quel étranger et certainement appartiendront à l’histoire des sciences, on ne voit pas parmi les jeunes qui les remplacerait. Vous rencontrerez — élément qui n’est certes pas à dédaigner et qu’on peut avec raison nous envier — des hommes de bon sens ; vous rencontrerez encore des hommes instruits et des spécialistes très distingués ; vous ne rencontrerez pas, du moins en nombre suffisant, de véritables esprits scientifiques.
Comment expliquer cet état de choses ?
Les raisons en sont nombreuses. Voici les principales.
Elles sont de trois ordres : les unes tiennent à la condition de l’économie politique en France et au degré de considération qu’elle obtient parmi nous ; les autres, à notre caractère propre et à la tournure de notre esprit ; d’autres, enfin, à l’organisation de l’enseignement de l’économie politique.
A. Parmi ces causes, la mauvaise organisation de l’enseignement de l’économie politique en France, est, pour nous, la cause capitale. Il n’y a de religion vivace que celle qui a ses prêtres et ses fidèles ; il n’y a de science féconde que celle qui a ses maîtres et ses disciples. Or, l’économie politique en France manque un peu de tout cela.
Ceci n’est pas admis par tout le monde. On dresse dans les facultés et dans les écoles de toutes catégories, la liste des chaires d’économie politique, et, avec le total, on démontre que peu de pays peuvent se vanter d’un pareil enseignement. Mais ces chiffres et l’argument qu’on en tire n’ont que peu de valeur. Dans l’enseignement, il faut distinguer deux choses : la vulgarisation des doctrines courantes et la vérification de ces doctrines, jointe à la recherche de doctrines meilleures. La vulgarisation a effectivement reçu, en France, un bon commencement d’organisation ; la vérification, le contrôle, la recherche, pèchent, au contraire, à beaucoup d’égards.
Ce n’est pas ici le lieu de traiter à fond de l’enseignement de l’économie politique en France. Il en faut pourtant bien toucher un mot.
Quand une science est déjà constituée, quand elle a déjà beaucoup produit, ce n’est plus le zèle intermittent de quelques amateurs, c’est — mettant à part le cas anormal des hommes de génie — le travail patient et méthodique des savants qui en peut assurer le progrès. C’est là qu’en est arrivée l’économie politique. Elle vit d’observations et de raisonnements. Les observations sont infiniment délicates, les raisonnements peuvent être infiniment dangereux. Les uns et les autres ne peuvent avoir quelque valeur que s’ils émanent d’hommes à l’esprit sagace et préparés à leur tâche par des études spéciales. Or, de ces hommes, nous en avons ; nous n’en avons pas assez. Et il n’y a que l’enseignement pour nous les procurer.
L’enseignement — celui qui nous préoccupe ici, parce que nous en attendons le renouveau, ce qui n’est pas dire le renouvellement de la science économique —doit être un enseignement supérieur. Il doit être placé dans les facultés. En France, l’économie politique est enseignée dans les facultés de droit. Tant qu’on n’aura pas créé ces « facultés des sciences économiques et politiques » qu’esquissait en 1869 M. Duruy et que réclamait dès 1873 M. Paul Bert, les facultés de droit seront la vraie place où enseigner l’économie politique. Des hommes élevés dans la science du droit peuvent lui apporter une précieuse coopération. Premier et capital service, ils peuvent lui donner une langue plus précise et plus rigoureuse. Ils peuvent faire davantage : rompus à l’emploi de l’exégèse et de l’analyse, ils peuvent, mieux que personne, découvrir les points faibles des doctrines reçues. Plus tard enfin, avec leur passion et leur puissance de travail, ils peuvent aider à la restauration et au développement de la science.
Mais, pour cela, il faut que le recrutement des professeurs d’économie politique dans les facultés de droit soit assez profondément modifié.
Pendant longtemps, on les a choisis parmi les agrégés ordinaires de ces facultés, à la suite d’un concours où l’économie politique n’avait aucune place. L’étudiant en droit de la veille devait, dans un délai fort court, au maximum de quelques mois, monter en chaire et enseigner ce qu’il avait jusqu’alors ignoré. C’était un système intolérable. En 1881, le ministre de l’instruction publique consultait les facultés de droit sur l’opportunité d’assurer aux chaires de ces facultés de droit, « soit en modifiant l’agrégation, soit en prenant toute autre mesure, des professeurs qui auraient une préparation toute particulière à l’enseignement dont ils seraient chargés ». Cela visait directement les chaires d’économie politique. Les facultés, déterminées surtout par des raisons d’ordre intérieur, n’estimèrent pas que cette réforme fût désirable. Ce n’est qu’en 1891 que fut fait un premier pas bien timide, mais dont toutefois nous devons nous féliciter. Les épreuves du concours à la suite duquel sont nommés les professeurs d’économie politique, quoique portant encore pour la plus grande partie sur le droit, font déjà une place à notre science : elles comportent des leçons et des compositions d’économie politique.
Ce n’est pas encore assez. Il faut que ces leçons et ces compositions soient non plus facultatives, mais obligatoires. Il faudrait même davantage: une agrégation spéciale, ouverte non seulement à des docteurs en droit, mais encore à des philosophes, à des historiens, etc.,
Au reste, ce ne sont là que de simples indications. Ce qui importe, c’est de traiter l’économie politique comme les autres sciences ; c’est de ne pas l’abandonner aux seuls amateurs, collaborateurs très précieux qui peuvent bien vulgariser la science, mais non la perfectionner ; c’est de lui procurer un recrutement normal de professeurs, dont l’économie politique soit l’occupation principale, sinon exclusive, et dont toute l’ambition sera le progrès de lascience.
B. Elle en a besoin. Il n’y a pas de science qui, en France, ait été, depuis cinquante ans, plus attaquée que l’économie politique. On a dit qu’elle n’était qu’une littérature plus ennuyeuse que les autres ; on lui a dénié le caractère d’une science, même la possibilité d’en devenir jamais une ; on a affecté de considérer les économistes ici comme une secte intransigeante, là comme une bande de philosophes humanitaires ; enfin, on lui a refusé le droit d’intervenir effectivement dans les affaires publiques.
Contre tant d’accusations, comment l’économie politique pouvait-elle se défendre ? Par des apologies et des théories ? On en eût dit Sunt verba et voces præterea que nihil. Par des actes ? Oui, par des actes. Mais alors, il fallait être au pouvoir, et, en France, l’économie politique y a été trop peu.
En Angleterre, où les plus éminents des ministres étaient pénétrés de ses enseignements et les ont fait passer en pratique, elle a accompli une œuvre immense : les impôts, la dette publique et l’amortissement, la colonisation, le régime commercial, la monnaie, tout porte son empreinte. En France, au contraire, c’est seulement à de longs intervalles et pendant de trop courts moments, c’est surtout pendant des périodes peu favorables à leurs idées et peu propices à leur application que des économistes ont pu diriger la politique. Leur influence s’est trouvée ainsi fort limitée. La plupart des affaires qui eussent été de leur domaine, ce ne sont pas eux, ce sont des juristes, des ingénieurs, des militaires, qui les ont conduites et de la façon la plus empirique ; et la seule grande réforme que notre pays leur ait due, et qui a si puissamment agi sur le développement de la richesse, a été réalisée au moyen de procédés qui n’étaient pas absolument les leurs. Nous parlons ici de la réforme qui a introduit en France le libre-échange.
Cette réforme, d’ailleurs, avec tout ce qu’elle a exigé d’eux pour la préparer et plus tard pour la défendre, a eu les conséquences les plus imprévues pour l’économie politique.
Le libre-échange théorique et le libre-échange mitigé qui a été acclimaté chez nous par le régime des traités de commerce, ont été l’occasion des luttes les plus vives. Le pays s’est divisé et, depuis cinquante ans, reste divisé en deux partis, qui, à intervalles fréquents, se réveillent pour combattre les protectionnistes et les libre-échangistes. Or, les libre-échangistes ont été, par l’opinionpublique, identifiés avec les économistes. L’économie politique porte — ce qui est juste — la responsabilité des victoires intermittentes du libre-échange et ce qui lui est scientifiquement un titre d’honneur lui a été trop souvent un sujet de discrédit parmi les hommes d’affaires et les hommes de gouvernement.
Tandis qu’en Angleterre elle poussait ses adeptes à la considération et au pouvoir, en France elle les exposait à l’impuissance et presque au ridicule. Il en est résulté que le nombre de ceux qui auraient pu être tentés d’en faire une carrière a toujours été en diminuant. Les autres sciences, sciences d’ailleurs officiellement reconnues, et qui conduisaient, soit par la faveur de l’opinion à des situations enviées, soit par une hiérarchie établie à de hautes fonctions, attiraient à elles des éléments d’année en année plus abondants et plus choisis ; l’économie politique, elle, autrefois si honorée parmi nous, est, depuis ces luttes soulevées par le libre-échange, un peu délaissée.
Ce n’est pas là d’ailleurs la seule conséquence fâcheuse que le libre-échange ait entraînée pour l’économie politique.
Nous disions que l’opinion publique a identifié les libre-échangistes avec les économistes ; les économistes, eux, ont identifié le libre-échange avec l’économie politique. Ce n’est pas une exagération que de dire que le libre-échange a absorbé plus de la moitié, les deux tiers des forces vives de nos économistes. Toutes les autres questions ont passé après celle-là.Prenez les ouvrages de nos auteurs les plus célèbres depuis cinquante années, et vous verrez quelle place imposante la défense du libre-échange tient dans leur production. Nulle part cette passionnante question n’a été plus étudiée et par des hommes de plus de talent. Le libre-échange est aujourd’hui, de toutes les assertions de l’économie politique, la mieux fondée ; la forteresse où il se défend est scientifiquement imprenable. Si ceux qui l’ont édifiée avaient, comme autrefois les ouvriers de nos cathédrales, mis leur marque sur les pierres qu’ils ont fournies, on verrait la part glorieuse qu’y ont prise les maîtres français. Seulement — et c’est là la contrepartie d’une œuvre si belle — le libre-échange les a fait se désintéresser du reste de l’économie politique. Plus d’un problème qui passionne les étrangers et aurait dû solliciter leur attention, a été volontairement négligé et, comme la science pure perdait chez nous de son activité et de son ampleur, notre école, sauf quelques éclatantes exceptions, a perdu au dehors de son autorité.
C. Il faut bien le dire, d’ailleurs — et ceci nous amène au dernier ordre de considérations que nous avons annoncées — notre tempérament et notre nature d’esprit ne nous disposaient pas au genre d’études qui semble être celui de l’heure présente. Nous sommes, les uns, les hommes de l’action, les autres, les hommes des conceptions abstraites et de la généralisation ; on ne voit pas que nous soyons les hommes du détail et de la minutie poussés, comme on fait parfois à l’étranger, jusqu’à la naïveté.
Il n’y a pas lieu d’insister sur ce goût de généralisation que tout le monde nous reconnaît et qui se trahit, dans notre science, par le nombre des traités, manuels, systèmes, où la plupart d’entre nous viennent de bonne heure, et parfois prématurément, condenser tout un corps de doctrines. Quant à l’action, elle est partout, et partout elle précède la science.
Voyez le libre-échange : partout on y rencontre l’action. Nos savants se transforment en polémistes et en conférenciers ; ils luttent pour l’industrie nationale, qui s’ignore elle-même ; ils luttent pour le consommateur, qui se laisse dépouiller ; et des livres scientifiques au premier chef, comme l’Examen du système protecteur, de Michel Chevalier, sont le fruit de vingt années de combats.
Remontons plus haut : prenons nos physiocrates et prenons Turgot : presque toutes leurs doctrines sont sorties de l’action. Elles sont nées de leurs révoltes contre la sottise et l’injustice. C’est à voir la famine sévir chaque année, l’industrie étouffer et dépérir, le peuple enfin s’étioler et s’appauvrir grâce à des réglementations prétendues tutélaires que soutenaient des hommes avides, que Quesnay et surtout Turgot se sont élevés enfin à la notion de la liberté du travail. En cela, d’ailleurs, véritablement scientifiques, puisque la plupart de leurs doctrines, ils les avaient dégagées de l’observation.
Voilà, si l’on peut ainsi s’exprimer, comment ont travaillé nos grands économistes, et cette méthode de travail est conforme à notre tempérament.
Or, aujourd’hui, l’on vit dans un état d’anarchie et de confusion. Des négations passionnées et imprudentes ont ruiné dans l’opinion des jeunes hommes qui arrivent à la science tout un corps de doctrines qui tenait encore, et n’aurait eu besoin que d’être repris et consolidé en sous-œuvre. L’école économique, ainsi qu’une fourmilière éventrée d’un coup de pied, va, vient, s’agite, se démène.Les économistes n’ont plus ni chefs ni direction. Ce qui avait été jusqu’ici tenu pour vérité est dénoncé comme entaché d’erreur ce qui passait pour axiome a besoin d’être démontré, et l’on voit — ceci n’est pas un propos en l’air — des in-folio consacrés à établir de simples truismes. L’esprit des Français, esprit clair, mais simpliste, et d’ailleurs, je l’avoue, quelque peu déprimé par la forme séculaire de notre enseignement public, se perd au milieu de ces confusions et de ces subtilités. De là, l’inaction excusable d’une partie de notre jeune école.
Cette inaction, j’imagine toutefois qu’elle est à la veille d’en sortir. L’impuissance de ses adversaires est bien faite pour l’y décider. L’édifice élevé par l’économie politique libérale a pu souffrir de tant d’attaques ; il n’a certes point été compromis. Et la tâche de demain sera précisément celle qu’il eût fallu entreprendre il y a vingt ans une œuvre non plus de négation, mais de révision ; non plus de destruction, mais de restauration. Cette œuvre qui, vraisemblablement, tournera à la gloire de nos maîtres, l’école française, avec l’aide des collaborateurs qu’elle a gardés dans le monde, se doit à elle-même de la mener à bien.
JOSEPH CHAILLEY-BERT.
_____________
[1] « Économie nationale » au sens propre du mot et non pas « Économie des nations ».


Laisser un commentaire