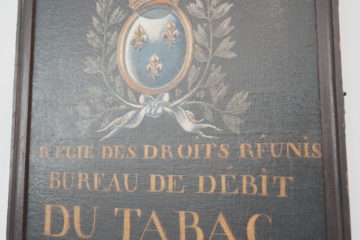La liberté des banques et l’agriculture
En décembre 1866, après une communication sur les bons effets de la liberté des banques sur l’agriculture dans l’île de Jersey, une discussion s’engage à la Société d’économie politique sur ce thème. Face à Louis Wolowski, leur éternel ennemi sur ce sujet, les « libre-banquistes », comme ils s’appellent — Horn, Léonce de Lavergne, notamment — font valoir que la liberté des banques revitaliserait l’agriculture et servirait au progrès économique de la France.