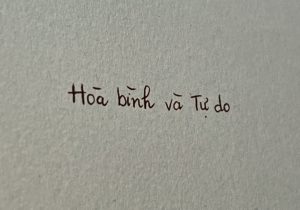
‘Paix et Liberté’, écrit en vietnamien.
« Un des caractères les plus manifestes des peuples modernes est le penchant qui les porte les uns vers les autres. Leurs intérêts commerciaux se confondent de plus en plus. On se visite et on s’apprécie chaque jour davantage. On voyage cent fois plus qu’il y a un siècle. Les chemins de fer, les paquebots à vapeur et le télégraphe électrique rendent les rapports de plus en plus faciles et commodes. On fait le tour du monde en quatre-vingts jours, ainsi que vous le dit tous les matins l’affiche des théâtres. La séparation résultant de ce qu’un grand nombre de personnes, même parmi les classes instruites, ne parlent que leur langue nationale, fait obstacle à un courant qu’on ne saurait trop encourager et entretenir. C’est une barrière qu’il est indispensable d’écarter. »
LA SOCIABILITÉ
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES.
par Michel Chevalier
(Journal des économistes, janvier 1876)
Messieurs, je me propose de vous entretenir de la sociabilité de l’homme, c’est-à-dire de cette force intime qui le porte à rechercher ses semblables et à vivre avec eux à l’état de société pour en retirer des services et pour leur en rendre son tour.
J’ai à vous en parler aujourd’hui sous un rapport particulier qui, je l’espère, ne vous paraîtra pas indigne d’intérêt.
Les forces de l’homme dans le domaine de la production de la richesse, de même que dans les autres branches de son activité, sont multiples et diverses par leur nature. Il y en a qui sont de l’ordre physique, elles résident dans ses organes matériels. Celles-là furent les premières que l’homme employa, et tant qu’elles furent sa seule ou sa principale ressource, la civilisation fut débile, incertaine dans sa marche et mal assurée, sujette même à tomber pour ne pas se relever.
Nos facultés de l’ordre intellectuel et moral composent une autre catégorie des forces humaines. Celles-là sont les mobiles essentiels de nos actions. Les deux principales, celles auxquelles peuvent se ramener toutes les autres sont la raison et la sociabilité. Aristote, un des plus grands génies qui aient existé, un des plus brillants flambeaux de la civilisation, a eu le mérite d’avoir le premier défini l’homme par ces deux attributs d’une généralité si vaste et si compréhensive. L’homme, a-t-il dit, est un être raisonnable et sociable.
La raison a diverses manières d’être, parmi lesquelles il faut citer avant tout l’intelligence, la personnalité et la liberté. Intelligence, personnalité et liberté sont les trois facettes d’un diamant indivisible qui est la raison humaine.
L’homme est à la fois le plus personnel des êtres, le plus amoureux de liberté, et le plus intelligent, de même qu’il en est le plus sociable. Son intelligence peut faire acquisition sur acquisition ; son goût pour la liberté est indéfini et légitime tant qu’il sait se gouverner lui-même, et sa personnalité est constamment envahissante. Pareillement, sa sociabilité peut acquérir le plus grand développement, se révéler avec des aspects divers et répandre des bienfaits illimités.
J’ai eu plusieurs fois lieu de fixer votre attention sur ce grand attribut de notre espèce qui s’appelle tantôt la liberté, tantôt la personnalité, tantôt l’esprit humain.
La force de la raison entendue et diversifiée comme je viens de le dire, produit de grands effets dans les actes, individuels ou collectifs, qui relèvent de l’économie politique. Cette science considère spécialement la liberté comme un génie tutélaire. Elle y voit une condition indispensable de la fécondité des efforts humains. La liberté du travail, qui se traduit par le libre exercice des diverses industries et professions, est représentée par les économistes comme une des nécessités absolues de toute civilisation avancée. Quand on déroge à cette liberté, c’est comme si on faisait une brèche au droit naturel des peuples. Quelque échafaudage de mots qu’on s’étudie à dresser, de quelques métaphores et de quelques sophismes qu’on s’entoure, l’acte par lequel la liberté du travail d’un peuple est mutilée est de nature rétrograde. C’est un enseignement sur lequel j’ai toujours insisté et qui est opportun aujourd’hui comme il l’était hier.
La sociabilité humaine est une force égale et parallèle à la raison ou à la personnalité ou à la liberté ; elle n’en est pas l’antagoniste. Elle donne naissance pareillement à de grands biens. Le nombre de figures sous lesquelles elle se présente est considérable. Un des caractères distinctifs d’une civilisation avancée, c’est que les lois et les mœurs soient favorables à ces transfigurations diverses de la sociabilité humaine.
Hors de l’état de société, l’homme n’est pas lui-même, il n’est rien qu’un animal grossier, maladroit et d’une saleté immonde. L’homme solitaire, absolument séparé de ses semblables, est impuissant à subvenir à ses besoins, et dans sa détresse il tombe au dernier degré d’avilissement. Sa raison s’est envolée. Il est dépouillé de sa personnalité, il perd tout sentiment de la liberté. Ce n’est plus un être pensant, il diffère à peine d’une chose.
On a objecté l’exemple de Robinson qui s’était passablement tiré d’affaire tout seul dans son île déserte. Mais d’abord Robinson n’a jamais existé effectivement. C’est un être imaginaire créé par l’esprit ingénieux d’un habile romancier. Acceptons-le cependant comme un personnage qui aurait vécu. Robinson, dans son isolement, n’est pas privé du concours de la société. Il n’a pas été jeté dans son île inhabitée, tout nu et les mains vides. L’assistance de la société l’y a suivi sous bien de formes différentes. Elle était représentée à l’origine par le navire échoué qui a été un magasin où il a eu le temps de s’approvisionner en vingt genres divers. Dès l’abord, son mérite a consisté dans la persévérante activité qu’il a déployée pour aller en fouiller les flancs par une suite de visites qui n’étaient pas exemptes de péril et qu’il continua jusqu’au moment où une tempête eut englouti le vaisseau. Il y puisa des vivres des vêtements, la caisse d’outils du charpentier qui pour lui valait infiniment plus que la caisse remplie d’écus des premiers banquiers de la Cité. Il en rapporta du fer, des bois équarris ou aplanis ; de la toile en quantité qu’il tira de la voilure ; des clous, objets précieux pour lui dans sa situation, un de ces instruments d’un usage quotidien dont on connaît la valeur surtout quand on en manque. C’étaient encore des aiguilles et du fil, autre trésor inestimable. C’étaient des couteaux et des armes à feu avec du plomb et de la poudre, ce qui lui permit de se nourrir des animaux dont l’île était peuplée, et plus tard de se défendre contre les cannibales qui y faisaient des descentes. Il rencontra aussi dans ce bâtiment, qui était pour lui une sorte d’arche de Noé, des grains de blé et de riz qu’il put semer, et qui bientôt lui fournirent des moissons.
Certes Robinson était fort à plaindre de n’avoir à sa portée aucune bourgade, aucun hameau, aucun être semblable à lui-même ; mais ce n’en était pas moins un grand bienfait de la Providence d’avoir pu se munir, dans le navire échoué, non seulement de divers objets de consommation dont il pût provisoirement se nourrir et se vêtir, mais aussi d’un certain nombre d’instruments de travail et de production avec lesquels il put exploiter suffisamment son île, s’y établir une et plusieurs demeures, s’y former un troupeau, en féconder le sol par la culture et obtenir des récoltes. La société dont il est séparé par l’abîme des mers lui fournit même des ressources de l’ordre intellectuel et de l’ordre moral. C’était l’instruction et l’éducation qu’il avait reçues et dont l’empreinte était ineffaçable ; tels étaient, par exemple, des souvenirs techniques se rapportant à des industries élémentaires comme l’art de faire le pain, celui de fabriquer des chandelles avec la graisse d’un troupeau et de pétrir et cuire des poteries grossières. C’était l’esprit d’observation par lequel il connut bientôt ce qui le touchait le plus parmi les richesses naturelles de son île. D’un autre côté, c’était la force de caractère qu’il avait acquise dans sa patrie au contact d’hommes éclairés, laborieux et persévérants. C’était un petit nombre de livres sauvés du naufrage, et surtout une Bible dont la lecture le soutient à certains moments où son âme s’affaisse sous le poids de la solitude.
Bastiat a donc parfaitement raison quand il dit que Robinson n’est pas l’exemple de l’homme réellement isolé, et que c’est un individu continuellement entouré, dans sa solitude même, des secours de la société qui semble absente.
Les solitaires qui vivaient dans les déserts de la Thébaïde, malgré qu’ils se privassent volontairement de toutes les délicatesses de la vie et même de bien des objets considérés comme de première nécessité, n’étaient pas non plus des hommes complètement isolés ; ils se fréquentaient les uns les autres, pour se réconforter dans leur foi. Ils recouraient à autrui pour l’accomplissement de leurs devoirs religieux. Ils faisaient consister leur existence dans la pratique de ce que la religion a de plus rigoureux et de plus austère, et dans la méditation religieuse. Mais quelque soucieux qu’ils fussent du salut de leur âme, la nature les forçait de s’apercevoir qu’ils avaient un corps, et ce corps réclamait des soins par la voix impérieuse des besoins et de la souffrance. Quelque mépris qu’ils eussent pour la vie molle et voluptueuse des sybarites, quelque éloignement que leur inspirassent les voluptés gastronomiques des Lucullus, des Apicius et des Vitellius, il fallait pourtant manger et boire, il fallait aussi se vêtir ; à cet effet, ils s’adressaient à la société et en avaient l’assistance. La religion même, qui autant que possible leur tenait lieu de tout, n’était point le produit de leur imagination solitaire. Elle ne leur avait pas été révélée à eux-mêmes, ils la tenaient de la société.
L’homme absolument étranger aux bienfaits de la société se chercherait en vain dans les tribus sauvages qu’on rencontre encore dans quelques îles écartées ou dans les déserts de l’Amérique et de la Nouvelle-Hollande. Ces tribus sont des rudiments de société. Dans toutes, les liens de famille sont plus ou moins respectés comme indispensables au maintien même des existences individuelles. Dans toutes il y a une hiérarchie ; dans toutes la solidarité existe à un certain degré, et le concours mutuel y unit les individualités les unes aux autres. Dans toutes, on rencontre quelques germes des arts utiles que les générations se transmettent ou qu’elles reçoivent de leurs voisines.
En fait d’hommes vraiment isolés de toute société et complètement dépouillés des bienfaits que la pratique de la sociabilité amène avec elle, nous ne connaissons que ces êtres infortunés qu’on rencontre de loin en loin au milieu des bois, nus, vivant de racines péniblement arrachées ou de fruits que la nature a fait pousser sur des arbres sans culture. Ces malheureux ont perdu le souvenir d’une existence moins misérable, s’ils en ont jamais joui ; ils ont oublié l’usage de la parole. Recueillis par la commisération publique lorsque par hasard on les a découverts, ils ont toujours excité un intérêt général et sont devenus l’objet d’études attentives. On a ainsi constaté en eux un degré d’abaissement bien fait pour dissiper les rêves que se forme notre orgueil au sujet de notre supériorité native. Buffon en cite des exemples, qui de son temps, avaient été remarqués, et qu’on avait observés avec une curiosité superstitieuse. Au commencement de notre siècle, il y eut en ce genre un idiot, un moment célèbre sous le nom du « sauvage de l’Aveyron », à l’occasion duquel on s’imagina qu’on venait de trouver l’homme primitif, cette merveille qui, dans l’opinion des philosophes d’alors, devait exposer des vérités précieuses, obscurcies aux yeux des civilisés par l’influence corruptrice qu’une école influente attribuait à la civilisation. On entoura de sollicitude la pauvre créature, les physiologistes l’examinèrent, les philosophes l’assaillirent de questions. On en attendait des révélations : on n’en put rien tirer que des sons inarticulés dépourvus de sens et de gestes imbéciles. C’était purement et simplement une brute inférieure à l’orang-outang par la dextérité et fort au-dessous du chien par l’intelligence, la sensibilité et les qualités affectives.
Tous ces êtres qualifiés d’hommes sauvages ne peuvent avoir été que des enfants qui, dans un âge tendre, s’étaient perdus au milieu de vastes forêts ou y avaient été conduits par des parents dénaturés désireux de s’en débarrasser. Ils avaient cueilli sur les arbres des baies ou d’autres fruits grossiers, ils avaient arraché des racines coriaces, et c’est ainsi qu’ils étaient parvenus à se nourrir. Ils avaient eu la chance de trouver un creux d’arbre ou une cavité entre des rochers, et ils s’en étaient fait un gîte. Faute d’occasion de pratiquer la parole, ils ne se souvenaient plus du sens des mots même les plus usuels et étaient incapables de les répéter. Concentrant toutes leurs facultés dans la recherche de leurs aliments, et souvent torturés par la faim, leur esprit s’était émoussé et n’était plus qu’un instinct tout à fait obtus. Écrasés par le fardeau de leur destinée, ils étaient tombés au rang des bêtes, au point de marcher comme elles à quatre pattes.
Voilà ce que c’est en réalité que l’homme isolé, l’individu absolument livré à lui-même : il est le type de l’impuissance et de la dégradation.
En vertu de la loi d’harmonie qui se reconnaît dans toute la nature, l’homme en même que ses facultés, ses goûts et ses sympathies lui donnent plus de penchant pour la société que n’en ont les autres êtres, est celui de tous auquel la société est le plus indispensable.
Buffon dit justement que la société est « après Dieu » l’origine de « toute la puissance » de l’homme. Ce grand observateur fait à ce sujet une remarque fort concluante, c’est que par la longueur de son allaitement, par la lenteur encore plus exceptionnelle de son développement, ou ce qui revient au même, par sa faiblesse pendant une longue suite d’années, l’homme est dans la nécessité d’être entouré par ses parents de soins matériels très prolongés, tandis qu’il n’y a rien de semblable pour les autres êtres. L’en priver serait le vouer à une mort certaine. L’éducation qu’il faut aux animaux pour les porter au point où ils peuvent se suffire à eux-mêmes est l’affaire de quelques mois, souvent de quelques semaines. Pour l’homme, il y faut beaucoup d’années. Si l’on tient compte du temps que réclament les facultés intellectuelles et les qualités morales pour acquérir même une incomplète maturité, l’apprentissage de la vie s’allonge encore. Ainsi, pour que l’individu parvienne au degré de force au-dessous duquel il ploierait sous la responsabilité de lui-même, la permanence de la famille est indispensable. Elle nous est commandée à la fois par les conditions physiques de notre espèce et par la loi qui préside à l’éclosion de notre intelligence et à l’épanouissement de nos sentiments. C’est donc une vérité absolue que l’homme ne peut se former physiquement et, à plus forte raison, être un digne membre d’une société civilisée, qu’autant que la famille soit constituée solidement, fixement, pour veiller sur lui comme une providence et une vigilante institutrice. Les liens de famille fortifiés par le temps contractent une consistance telle qu’ils durent autant que la vie. Le sentiment de l’intérêt, sanctionné par l’hérédité des biens, s’unit à celui de l’affection réciproque pour empêcher que ces liens ne s’interrompent, à moins de circonstances qui, dans l’opinion commune, sont des fautes ou même des crimes, tandis qu’avec les bêtes la famille n’est qu’un assemblage passager qui se brise au point que le souvenir même en disparaît totalement après un court délai. Souvent parmi les bêtes, la famille n’existe aucunement pour le mâle. Il n’en a pas la notion ou, s’il l’a, elle est extrêmement éphémère. Chez la femelle c’est un sentiment qui est vif et passionné, car elle se ferait tuer pour ses petits, tant qu’ils ont besoin d’elle pour se procurer leur pâture. Mais dès qu’ils ont franchi ce point, ce qui ne se fait jamais beaucoup attendre, elle ne les connaît plus, ils lui sont complètement étrangers.
La famille est pour l’homme une première société indestructible, qui devient l’élément essentiel d’une autre société plus large, à savoir, selon les degrés de civilisation, la tribu, la peuplade, la nation.
Quand ces agglomérations ont acquis des proportions considérables, elles constituent les grands États. De proche en proche, on arrive tantôt aux confédérations puissantes dont la population se développe avec activité sur des espaces indéfinis, et dont les États-Unis offrent le plus parfait modèle, tantôt à une organisation unitaire établie sur une superficie presque illimitée, où se déploie une population rapidement croissante. L’empire de Russie est le type et presque l’idéal de cette autre forme de grande société. Mais la base de l’édifice, quelque colossal qu’il puisse être, c’est le premier groupe, la famille.
LE LANGAGE EST LE PRINCIPAL INSTRUMENT DE LA SOCIABILITÉ. — GRANDE UTILITÉ D’UNE LANGUE COMMUNE. — LE LATIN AU MOYEN ÂGE.
Dans l’ordre spécial de l’économie politique, l’échange est la manifestation la plus éclatante de la sociabilité. L’importance de l’échange ne devrait jamais être perdue de vue par les hommes appelés à administrer les peuples. Elle doit être sans cesse signalée à l’attention du public par quiconque fait cas de l’économie politique et désire que la bienfaisante influence de ses saines doctrines se révèle de plus en plus dans la marche des États.
Cependant, si l’on se place à un point de vue plus général, il y a un signe plus apparent encore, et plus fréquent que ne l’est l’échange de la sociabilité de l’homme ou de son aptitude à la vie sociale. C’est le langage. La parole est un des privilèges de l’espèce humaine. C’est un instrument admirable pour la communication et l’échange des sensations, des opinions, des désirs et des propositions de toute sorte, aussi bien de celles qui concernent la richesse que de celles qui y sont étrangères. Le reste de la création n’en a qu’une imitation très imparfaite et très incomplète. Le complément de la parole est l’écriture qui est venue à la suite. Celle-ci a été d’abord figurative et ensuite phonétique, c’est-à-dire celle où les signes représentent des sons. La civilisation n’est parvenue à ce dernier genre d’écriture que par beaucoup d’efforts, et jusque-là le lien des générations, les unes avec les autres, laissait beaucoup à désirer. Mais une fois cette écriture inventée, vulgarisée et tombée dans le domaine général, la transmission des idées s’effectue de la manière la plus exacte, non seulement entre personnes en contact immédiat, mais aussi bien à quelque distance qu’on soit les uns des autres ; non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps. Moyennant l’écriture phonétique, chacun des membres de la famille humaine peut entrer en relations intimes avec l’habitant actuel de quelque lieu que ce soit du globe terrestre ; il a même des rapports avec les générations qui l’ont précédé comme aussi il peut s’en ménager avec celles qui suivront. De nos jours, le télégraphe électrique aidant, la facilité de communiquer par l’écriture avec les diverses parties du globe terrestre, avec toutes les branches de l’espèce humaine, a reçu une extension inespérée. Les choses se passent comme si tous les hommes étaient réunis sur une même place publique.
La différence des langues ne laisse pas que d’être un grand obstacle aux communications entre les hommes. En présence l’un de l’autre, un Français et un Anglais, ou un Français et un Allemand, si chacun d’eux est réduit à sa langue maternelle, sont comme s’ils étaient privés de l’usage de la parole. Ainsi, le fait qu’un homme ne connaisse qu’une seule langue, et que, dans chaque nation, la grande majorité soit de même confinée dans cette pénurie de moyens de s’exprimer, est une infériorité pour l’individu et un dommage pour les peuples eux-mêmes qu’il isole et par conséquent affaiblit. Il n’est pas possible que les relations d’affaires et les intérêts économiques ne s’en ressentent pas, puisque tout absolument en est fâcheusement affecté.
Vous vous rappelez tous l’histoire de la Tour de Babel. Les peuples réunis en une seule famille dans les plaines de Babylone furent saisis d’un prodigieux accès d’orgueil : ils résolurent d’ériger une tour qui atteignît jusqu’au ciel, et ils procédèrent à l’exécution de cette incroyable folie. Tant qu’ils parlèrent la même langue, l’ouvrage marcha bien, les assises se rangeaient les unes sur les autres et la tour montait toujours. Du moment que Dieu, mécontent de cette tentative téméraire, eut, par un acte de sa volonté, mis la confusion dans leur langage, ils ne s’entendirent plus, le travail se désorganisa immédiatement, et l’œuvre fut abandonnée.
Au contraire dans l’Évangile, nous lisons que lorsque le Christ fut remonté au Ciel, ses disciples livrés à eux-mêmes, eurent à remplir la mission d’apôtres en prêchant le christianisme à tous les peuples de la terre, ils rencontrèrent une immense difficulté, celle de se faire comprendre de tant d’auditoires divers. Pour donner à leur activité une grande puissance, la Providence opéra le miracle inverse de celui de la tour de Babel. Les apôtres reçurent subitement le don des langues. Chacun de ces hommes simples, presque tous humbles pêcheurs, qui ne savaient que la langue vulgaire de la Judée, acquit, à la Pentecôte, la faculté de parler à son gré toutes les langues du monde, et ils eurent, dès lors, pour l’accomplissement de leur tâche, une faculté inespérée.
Il y a lieu d’exprimer le vœu que les personnes, dont la fonction est d’organiser l’instruction publique en vue du plus grand bien des États, veuillent bien se souvenir de ces deux événements consignés dans les livres saints. Dans le premier cas, Dieu, jugeant à propos de réduire les hommes à l’impuissance, se borne à leur faire parler des langues différentes. Dans le second, voulant, au contraire, porter au maximum l’efficacité de leurs efforts, il les met subitement en possession de parler la langue de leur prochain quel qu’il soit. Il semble qu’il y ait une conclusion irrécusable à tirer de là en faveur de l’enseignement, dans chaque pays, des langues étrangères.
À toutes les époques où l’on a voulu exercer une action commune sur les hommes de différentes nationalités, les associer dans une commune pensée et les diriger vers un but commun, on s’est efforcé d’établir parmi eux une langue commune. Il y en a eu au Moyen-âge un grand exemple et qui a beaucoup duré.
Par le renversement de l’empire romain, l’Europe avait été partagée entre des conquérants barbares, et chacun de ces nouveaux royaumes, lorsqu’il eut acquis une certaine consistance et un certain degré de fixité, se fit par degrés son langage par une combinaison grossière de plus ou moins de latin avec l’idiome que chaque peuplade conquérante avait parlé dans les forêts de la Germanie ou dans les steppes de l’Asie. Les pontifes romains, chefs suprêmes de la religion, voulant user de l’autorité immense et incontestée que leur reconnaissaient tous ces barbares, pour les guider dans les voies de la morale, jugèrent indispensable d’avoir dans la main un instrument commode par lequel ils pussent leur rappeler sans cesse leurs devoirs d’homme et de chrétien, établir et maintenir parmi eux une bonne discipline, de manière à contrebalancer leurs passions, à contenir leur humeur altière et leurs appétits brutaux. À cet effet, ils eurent la sage pensée de maintenir imperturbablement, à côté de toutes ces langues en formation, une langue uniforme qui fût partout celle des prières, des offices religieux et celle dont le clergé fît, d’une extrémité à l’autre de l’Europe, un usage habituel. Par cette langue ainsi placée au-dessus de toutes les autres, la cour de Rome devait être et fut en communication incessante et directe avec tous les évêques et les prêtres qui étaient rangés sous sa loi et peut par eux intimer ses ordres à tous les fidèles parmi lesquels étaient rangés les rois et tous les chefs temporels des populations. Ils choisirent naturellement à cet effet le latin qui avait été la langue officielle de l’empire romain, au moins dans toutes les provinces occidentales. C’est dans cette langue qu’étaient écrits, non seulement de nombreux chefs-d’œuvre littéraires, mais aussi les belles lois auxquelles le monde civilisé avait l’habitude d’obéir. Par le moyen de ce noble idiome, resté debout au milieu de tant de ruines, une communication continuelle put exister du souverain Pontife aux dernières ramifications de l’Église. Il put y avoir et il y eut de l’uniformité dans le culte et les prédications. Il put y avoir et il y eut dans l’Église une discipline qui résista aux tempêtes soulevées par les passions tumultueuses des rois et des grands, si bien qu’après s’être mis en révolte contre elle, ils étaient contraints de courber la tête.
Remarquons en passant, par respect pour la vérité historique, qu’un fait analogue à celui qui se passait dans la partie occidentale de l’empire romain s’accomplissait dans la partie orientale. Ce fut seulement dans l’Occident que la langue latine exerça sa domination. Dans l’Orient, c’eût été une violence d’un succès impossible que de tenter y faire jouir le latin de la même prérogative. La langue littéraire, la langue savante, la langue usuelle des classes cultivées était, depuis longtemps, dans les régions orientales, celle d’Homère, de Démosthène, d’Aristote et de Platon, langue si sonore et si riche, renommée pour tant de monuments poétiques, scientifiques, philosophiques. Mais cette moitié du monde civilisé et chrétien, bientôt séparée politiquement de l’Occident par le partage en deux de l’empire romain, n’était pas réservée à d’aussi grandes destinées que l’autre. Il s’y forma par le grand schisme de Photius une Église distincte où la langue grecque resta exclusivement maîtresse, comme le latin l’était dans l’Occident. Puis l’épée des successeurs et héritiers de Mahomet dérangea la similitude, et bouleversa la symétrie apparente. Les disciples de Mahomet conquirent successivement l’empire d’Orient tout entier et dès lors la civilisation y alla d’abaissement en abaissement, tandis que dans l’Occident, après une longue période de troubles, elle prit un magnifique essor et acquit la plus grande élévation.
Nous devions bien cette courte mention à la langue grecque, à l’Église et à l’empire d’Orient. Nous ne nous occuperons plus maintenant que de l’Occident, du ci-devant empire romain et de la langue latine.
L’unité de la langue sacrée dans tout l’Occident contribua pour beaucoup d’un côté à l’affermissement de l’Église, de l’autre à la conservation et au développement des éléments de la civilisation qui avaient survécu à l’invasion des barbares.
Si l’on n’avait eu ce lien solide entre tous les degrés de la hiérarchie religieuse, si dans ces temps d’ignorance et de mœurs déréglées le clergé n’eût possédé en chaque lieu ou dans chaque État d’autre langue que celle de la population locale, il est vraisemblable que l’Église se serait dissoute et serait tombée en lambeaux épars, à peu près comme les peuples rassemblés dans les plaines de Babylone, pour ériger la tour de Babel, s’étaient dispersés par l’effet de la confusion des langues.
Dans le Moyen-âge le clergé était la seule classe qui gardât le dépôt des connaissances humaines. Il était par conséquent le seul corps enseignant possible. Le mot de clerc était synonyme de celui d’homme instruit. Du privilège conféré à la langue latine, il s’en suivit donc qu’il y eut en Europe une seule langue pour les écrits consacrés aux sciences, une seule, qui était partout la même, pour l’enseignement, une seule toujours la même qui s’apprît dans les universités, et c’était en même temps celle qui servait pour les offices religieux et dans les cérémonies du culte, grandes et ordinaires. Ce fut d’un grand secours pour la reconstruction du savoir humain, qui avait presque disparu sous les décombres entassés par les barbares. Les savants de tous les pays se comprenaient les uns les autres, chose remarquable, mieux qu’ils ne le peuvent aujourd’hui, et par cela même ils s’éclairaient facilement les uns et les autres.
L’établissement du latin, comme langue supérieure à toutes les autres, comme langue unique pour tous les usages les plus relevés, a donc puissamment aidé à l’organisation des sociétés modernes. L’adoption exclusive du latin pour tous ces emplois divers en avait fait une sorte d’institution religieuse, politique, littéraire et scientifique, dont l’influence a été énorme. Sans elle, la chrétienté, qui, malgré de fréquentes divisions intestines, a été une majestueuse création, homogène dans ses diverses parties, et qui offre le spectacle de la plus belle civilisation qu’on ait jamais connue, aurait eu la plus grande peine à se constituer, et même vraisemblablement elle n’y aurait pas réussi.
ÉCLIPSE SUCCESSIVE DU LATIN APRÈS LA RÉFORMATION RELIGIEUSE.
Au commencement du XVIe siècle, le faisceau de l’église chrétienne et latine se rompit en Europe. Le grand fait de la réformation éclata, beaucoup de peuples se séparèrent de Rome, et l’une des innovations qui suivirent fut la substitution de la langue vulgaire à la langue latine dans les prières, les offices et les cérémonies du culte. La langue latine ne fut cependant pas complètement dépouillée de son prestige et de son ascendant, même chez les peuples qui avaient rompu avec l’Église romaine. Elle garda encore pendant bien des années son empire dans le domaine des connaissances humaines. Les écrits auxquels on voulait assurer le plus de considération et de poids furent encore pendant longtemps partout composés en latin. Les œuvres du célèbre chancelier anglais Bacon, le Novum organum, entre autres, sont écrits en langue latine. De même les œuvres de Grotius. L’un et l’autre appartiennent au XVIIe siècle. Le Novum organum est de 1620 ; le livre de Grotius, De jure belli et pacis, est de 1624. Beaucoup d’autres écrits importants en latin, ont paru pendant le cours du XVIIe siècle, et il y en a eu de remarquables dans le XVIIIe. Le Prædium rusticum du P. Vanière jouit encore d’une grande célébrité. La première édition est de 1710 ; la plus complète et la meilleure de 1730.
Mais déjà au XVIIe siècle, les idiomes de la plupart des nations de l’Europe étaient portés à une grande perfection. Pour les autres ce progrès fut acquis dans le courant du XVIIIe. La littérature, qui se servait de ces langues diverses, a répandu un si vif éclat, que les écrivains s’y sont ralliés successivement. La plupart étaient laïcs, car le clergé avait cessé d’être la seule classe de la société qui eût de l’instruction et les laïcs étaient beaucoup moins disposés que les clercs à maintenir au latin sa prééminence. Les sciences naturelles et les sciences mathématiques, dont l’importance était croissante, étaient cultivées par les laïcs avec plus de succès que par le clergé, et la langue latine se prêtait mal à les exposer et à les interpréter. Les actes les plus importants, tels que les traités internationaux, cessèrent d’être formulés en latin.
Il est à remarquer qu’à la fin de sa carrière, le célèbre Bacon avait employé concurremment le latin et sa langue maternelle. C’est en anglais d’abord que parurent plusieurs de ses publications. Lui-même ensuite les traduisait en latin.
En vertu d’une fidélité exagérée à une tradition respectable par ses effets dans les siècles antérieurs, la base de l’enseignement qu’on recevait clans les établissements d’instruction moyenne ou supérieure resta le latin, aussi bien dans les pays protestants que chez les peuples qui avaient persisté à se tenir dans le giron de l’Église catholique ; ces derniers établissements étaient entre les mains du clergé. Le latin conserva ainsi partout une bonne clientèle. Et par exemple, les magistrats des parlements français furent jusqu’au bout versés dans la latinité. Ils possédaient à fond Cicéron, Tacite, Virgile et Horace.
À ces mêmes époques, c’est-à-dire jusqu’aux approches de la fin du XVIIIe siècle, chacune des langues vivantes ne jouissait que d’une estime médiocre en dehors de la nation à laquelle elle appartenait, et était négligée à l’étranger par la grande majorité des personnes bien élevées. Il n’y avait guère qu’une exception : c’était en faveur du français, que nos grands auteurs du siècle de Louis XIV avaient investi d’un prestige extraordinaire. La langue française était pratiquée par l’élite de l’Europe. Elle était la langue des cours. Les français eurent la fâcheuse idée d’en tirer prétexte pour se dispenser d’apprendre les langues de leurs voisins, et ils ont persisté dans cette mauvaise habitude jusqu’au moment présent.
À l’heure actuelle, sur toute l’étendue de la civilisation occidentale, le courant est changé. Certes, les lettres latines resteront honorées jusqu’à la fin des siècles. Il ne peut donc être question d’en supprimer la culture, mais leur domination est finie. On aura beau multiplier les règlements universitaires et obliger par exemple de malheureux écoliers à forger régulièrement des vers latins, qu’ils aient ou non la veine poétique ; on ne leur inspirera pas la dévotion pour le latin.
On aura moins de succès encore dans la tentative où l’on s’obstine en faveur du grec. On soulève parmi la jeunesse elle-même une résistance passive, devant laquelle on échouera. Sans être de profonds observateurs, les enfants ou jeunes gens de 12 à 15 ans se rendent un compte passable de ce qui se passe autour d’eux, et ils ont lieu de penser que la connaissance des langues anciennes ne sert pas à grand’chose, d’où ils concluent assez logiquement, il en faut convenir, que ce n’est pas la peine de se fatiguer l’intelligence pour les apprendre. Il y a un siècle, dans les classes où l’on prisait l’éducation, un jeune homme voyait sur la table de travail de son père des volumes de Cicéron, ou de Virgile ou de Tacite, ou l’art poétique d’Horace ou ses odes. Pour se délasser l’esprit ou même pour se délecter, le père de famille ouvrait de temps en temps quelqu’une de ces nobles productions et en lisait quelques passages. Dans la conversation de son père avec ses amis, le jeune homme entendait des citations de ces grands auteurs. On avait même quelques livres grecs, et Chrysale des Femmes Savantes, possédait un gros Plutarque, sauf, il est vrai, à y mettre ses rabats. Aujourd’hui, rien de semblable. Dans aucune famille aujourd’hui, le culte de la littérature latine et à plus forte raison de la grecque n’est en honneur. Les dix-neuf vingtièmes des hommes qui ont appris le latin, de ceux-là même qui ont été repus bacheliers, ont complètement oublié leur latinité peu d’années après être sortis du collège. Cherchez parmi les hommes de 30 ans ceux qui seraient en état de soutenir une conversation en latin.
Je professe un grand respect pour nos magistrats ; nous avons dans nos cours des hommes aussi instruits professionnellement qu’ont pu l’être leurs devanciers des parlements. Mais croit-on que si l’aventure racontée de lui-même par le cardinal de Retz se renouvelait, si dans une séance d’apparat d’une de nos cours un orateur se permettait, ainsi que l’osa un jour, en plein parlement, ce modèle des intrigants politiques, de fabriquer une phrase de Cicéron, il y aurait quelqu’un dans le docte auditoire qui pût se dire à lui-même ce que pensèrent plusieurs des auditeurs de l’effronté conspirateur : la phrase est si bien tournée qu’elle est cicéronienne, mais je ne l’ai jamais lue dans Cicéron.
Quelle conclusion tirer de là ? Il semble bien que ce soit celle-ci : la jeunesse n’apprend le latin que contrainte et forcée. Elle n’apporte que tiédeur et indifférence à cette étude. Les jeunes gens devenus hommes laissent sans regret se perdre cette acquisition à laquelle ils ont consacré sept ou huit ans, ce qui démontre que les sept ou huit années auraient pu être mieux employées.
NÉCESSITÉ D’ENSEIGNER LARGEMENT DÉSORMAIS LES LANGUES VIVANTES.
Le latin peut justement prétendre à demeurer indéfiniment à l’usage des érudits de profession ; et même pour les personnes d’une éducation exceptionnelle, il sera toujours une source de jouissance. Pour le clergé, dans les pays catholiques, il est et restera d’obligation, et devra toujours être enseigné dans les séminaires grands et petits ; mais pour la grande majorité des laïcs des classes riches ou aisées, pour ceux qui dirigent l’activité sociale dans les voies des diverses industries agricoles, manufacturières et commerciales, ou dans celles des sciences pures ou appliquées, et même pour la plupart de ceux qui remplissent les fonctions publiques, le temps du latin est passé. Il ne sera jamais plus ce qu’il a été, la langue universelle, un instrument usuel de communication entre les peuples divers. Déjà, dans le langage ordinaire on l’appelle une langue morte ; dénomination inquiétante pour son avenir.
À plus forte raison, il en est de même du grec.
Les nations appartenant à la civilisation occidentale, dont l’Europe est le principal foyer, ne peuvent cependant rester sans un moyen de communiquer facilement entre elles par la parole et par l’écriture. Le latin ne pouvant plus en servir, comment le remplacer ? Il est clair que ce ne peut être qu’au moyen d’une langue vivante. Mais aucune des langues actuellement parlées ne peut prétendre à avoir seule cet honneur. Ni l’anglais, ni l’allemand, ni le français, qui sont les trois langues principales, ne sauraient concevoir une telle ambition ; à plus forte raison, c’est au-delà des espérances légitimes de l’italien, de l’espagnol, du russe, des langues scandinaves, etc.
Dans l’état présent des choses, la seule issue pour des Français serait d’apprendre deux langues étrangères au moins, l’anglais et l’allemand, et on peut remarquer à ce sujet que l’éducation dite classique comprend aussi deux langues, le latin et le grec. L’éducation des établissements publics, lycées, collèges, écoles primaires supérieures, peut être assistée par l’éducation domestique, celle qui commence au berceau. Dans un certain nombre de familles chez nous, et dans un plus grand nombre chez les peuples étrangers, l’enfant, dès qu’il quitte la mamelle, est façonné à parler, en même temps que la langue maternelle, une autre langue vivante, celle que ses parents considèrent comme devant être pour lui la plus utile. La difficulté de la tâche est ainsi diminuée dans une forte proportion.
L’homme qui posséderait à la fois les trois langues principales de la civilisation occidentale, le français, l’anglais et l’allemand, serait amplement pourvu pour la plupart des cas, d’autant plus qu’il serait plus familier avec chacune des trois. Ce sont les trois langues dans lesquelles il s’imprime le plus de publications originales en tout genre. Les pays où on les parle sont les plus intéressants à connaître et à visiter pour les hommes qui s’adonnent aux sciences pures, ou appliquées ou aux arts utiles, et, à plus forte raison, pour les fonctionnaires publics d’un rang élevé et pour les membres des assemblées délibérantes et les publicistes.
La France, confinant par le Midi avec l’Italie et avec l’Espagne, la connaissance de l’italien dans le sud-est et de l’espagnol dans le sud-ouest, serait fort opportune. Ce serait même assez pour un grand nombre des notables de nos départements frontières au sud-est et au sud-ouest. Pour nos méridionaux, accoutumés à leur patois, c’est un jeu d’acquérir passablement l’une ou l’autre de ces langues.
Ce serait déjà un trésor que d’être en état de lire couramment les trois langues que je viens d’appeler les principales de notre civilisation. Les lire est plus aisé que de les parler et s’acquiert en beaucoup moins de temps. Cette observation s’applique à l’anglais spécialement.
Mais pour un Français, le fait d’être complètement étranger aux deux autres langues que nous signalons comme essentielles, le constitue dans un état déplorable d’infériorité, pour peu qu’il soit à un certain niveau social, comme serait un grand agriculteur, un grand manufacturier ou un grand commerçant, un savant ou un administrateur d’un ordre supérieur, ou un médecin, ou un avocat ayant de nombreux clients ou un ingénieur, ou un homme politique. Dans toutes ces situations, en effet, on a un besoin incessant de consulter des recueils techniques ou spéciaux, des documents publics, des livres de diverse nature. Celui qui, par son ignorance totale des langues étrangères, spécialement de celles que nous venons d’indiquer comme les plus essentielles, est dépourvu de ce secours, n’a que des ressources incomplètes ; quelques facilités naturelles qu’il ait, il est arriéré, il y a chez lui du subalterne.
Un des caractères les plus manifestes des peuples modernes est le penchant qui les porte les uns vers les autres. Leurs intérêts commerciaux se confondent de plus en plus. On se visite et on s’apprécie chaque jour davantage. On voyage cent fois plus qu’il y a un siècle. Les chemins de fer, les paquebots à vapeur et le télégraphe électrique rendent les rapports de plus en plus faciles et commodes. On fait le tour du monde en quatre-vingts jours, ainsi que vous le dit tous les matins l’affiche des théâtres. La séparation résultant de ce qu’un grand nombre de personnes, même parmi les classes instruites, ne parlent que leur langue nationale, fait obstacle à un courant qu’on ne saurait trop encourager et entretenir. C’est une barrière qu’il est indispensable d’écarter.
De toutes les grandes nations, la France, il faut l’avouer, est celle qui a le plus à faire en ce genre, parce que c’est celle qui jusqu’ici a fait le moins. L’ignorance presque universelle chez nous des langues étrangères est préjudiciable à nos intérêts politiques et commerciaux. Nous voyageons moins que les autres parce que, à l’étranger, nous sommes désorientés faute de pouvoir nous faire comprendre et d’être en état de comprendre les autres. Nous prenons moins de part au mouvement d’émigration, à la faveur duquel des hommes intelligents et entreprenants pourraient aller au dehors se faire une fortune, se créer une position supérieure à celle à laquelle ils fussent parvenus dans leur patrie, et propager au loin l’influence française.
TRANSITION QUI A ÉTÉ PROPOSÉE.
Comme dans les choses humaines il faut aller par degrés, et qu’un des dangers, quand on innove, est d’embrasser trop au point de départ, je crois devoir ajouter que, pour bien réussir dans l’entreprise d’acclimater chez nous les langues étrangères, il conviendrait vraisemblablement, au début, de porter son effort sur une seule langue, non pas d’une manière absolue et exclusive, mais en s’en faisant une règle qui, selon les provinces, comporterait des exceptions. La langue qui, de notre part, mériterait la préférence, serait l’anglais. C’est celle qui est parlée sur la plus grande superficie et dans les contrées ou la civilisation a le plus rapide essor. L’anglais est la langue qui compte le plus d’adeptes dans les deux hémisphères, et, par le moyen des nombreuses et vastes possessions de l’Angleterre dans toutes les parties du globe, cette langue ne peut manquer d’accroître son domaine propre.
À ce sujet, je puis signaler, comme un symptôme satisfaisant, que le projet réciproque de celui-ci compte des partisans influents de l’autre côté de la Manche. Un Anglais des plus distingués, sir John Hawkshaw, qui est à la tête de la profession d’ingénieur dans sa patrie, où l’on compte tant d’hommes éminents en ce genre, a publié récemment une note où il recommande que dans les écoles publiques de l’Angleterre, le français fasse partie du programme obligatoire de l’enseignement, avec l’espoir qu’en France la même mesure serait adoptée en faveur de l’anglais. L’idée de sir John Hawkshaw mériterait bien de prévaloir en Angleterre et d’être chez nous payée de retour.
Les aperçus que je viens d’esquisser au sujet des langues vivantes et de la nécessité de les apprendre appartiennent strictement à l’économie politique. On a cependant l’habitude de considérer l’enseignement des langues comme relevant uniquement de la pédagogie. Cette manière de voir est erronée ou du moins fort exagérée. La connaissance des langues étrangères, facilitant les communications entre les hommes et rendant aussi plus aisée à chacun l’acquisition des progrès scientifiques et industriels qui se manifestent dans le monde, est, par cela même, un moyen direct d’accroître la puissance productive de l’individu et de la société, ou, ce qui revient au même, de multiplier la richesse provenant du travail de chacun et de tous. Il appartient donc à l’économie politique de la recommander.
Un bon enseignement des langues étrangères a nécessairement un effet d’un autre genre, auquel on ne saurait trop applaudir. Rien n’a plus d’efficacité pour dissiper les préjugés que nourrissent les nations les unes contre les autres, et pour amoindrir et éteindre les haines nationales. La connaissance des langues étrangères est ainsi éminemment favorable à la paix du monde, qui serait le souverain bien par excellence si on pouvait la consolider, et pour laquelle nous devons faire tous nos vœux, non seulement comme membres de la famille humaine, mais aussi comme partisans de la saine économie politique.
MICHEL CHEVALIER.


Laisser un commentaire