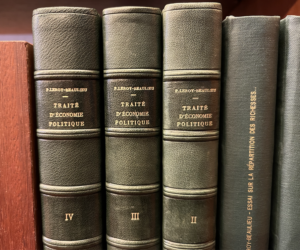 Dans son livre remarquable, De la répartition des richesses et de la tendance à une moindre inégalité des conditions, Paul Leroy-Beaulieu s’attache à récuser les prophètes de malheur qui promettent à l’ouvrier une condition de plus en plus déplorable, face à la richesse croissante des propriétaires terriens et des industriels. Dans la conclusion de son volumineux ouvrage, il revient sur quelques-unes des raisons qui prouvent, selon lui, que l’avenir amènera une inégalité toujours moindre des conditions, du moins si l’État ne vient pas paralyser ce mouvement. La concurrence du monde entier, ouvert par les nouveaux moyens de transport, fait pression à la baisse sur les revenus des propriétaires du sol ; cette même concurrence, alliée à celle que provoque, à l’intérieur du pays, la diffusion de l’instruction, provoque également l’abaissement des profits de l’industrie. Grâce au concours sans cesse accru des machines, grâce aussi à la généralisation des produits de grande consommation, le sort du travailleur modeste devient, au contraire, meilleur. La liberté et le temps, voilà au fond ce qui suffit pour amener une moindre inégalité des conditions. Le rôle de l’État, dans tout ceci, doit être plutôt négatif que positif : il doit réformer sa législation dans le sens de l’initiative individuelle et de la propriété privée, mais il doit se retenir d’égaliser les conditions par la loi. Maladroits et inefficaces, en plus d’injustes, ces systèmes retardent plus qu’ils n’avancent la marche de la civilisation vers l’état où les conditions seront, non pas égales, mais moins inégales.
Dans son livre remarquable, De la répartition des richesses et de la tendance à une moindre inégalité des conditions, Paul Leroy-Beaulieu s’attache à récuser les prophètes de malheur qui promettent à l’ouvrier une condition de plus en plus déplorable, face à la richesse croissante des propriétaires terriens et des industriels. Dans la conclusion de son volumineux ouvrage, il revient sur quelques-unes des raisons qui prouvent, selon lui, que l’avenir amènera une inégalité toujours moindre des conditions, du moins si l’État ne vient pas paralyser ce mouvement. La concurrence du monde entier, ouvert par les nouveaux moyens de transport, fait pression à la baisse sur les revenus des propriétaires du sol ; cette même concurrence, alliée à celle que provoque, à l’intérieur du pays, la diffusion de l’instruction, provoque également l’abaissement des profits de l’industrie. Grâce au concours sans cesse accru des machines, grâce aussi à la généralisation des produits de grande consommation, le sort du travailleur modeste devient, au contraire, meilleur. La liberté et le temps, voilà au fond ce qui suffit pour amener une moindre inégalité des conditions. Le rôle de l’État, dans tout ceci, doit être plutôt négatif que positif : il doit réformer sa législation dans le sens de l’initiative individuelle et de la propriété privée, mais il doit se retenir d’égaliser les conditions par la loi. Maladroits et inefficaces, en plus d’injustes, ces systèmes retardent plus qu’ils n’avancent la marche de la civilisation vers l’état où les conditions seront, non pas égales, mais moins inégales.
Paul Leroy-Beaulieu, De la répartition des richesses et de la tendance à une moindre inégalité des conditions, 3e édition, Paris, Guillaumin, 1888, p.544-569
CHAPITRE XX.
Conclusion.
Résumé des causes qui doivent amener une moindre inégalité des conditions. — La question sociale, en tant qu’elle est résoluble, se résout d’elle-même graduellement et pacifiquement.
L’intervention de l’État est-elle utile ? — Le rôle de l’État est plutôt de supprimer les obstacles légaux qui s’opposent à une moindre inégalité des richesses que de créer des institutions positives pour rendre les revenus moins inégaux. — La liberté de tester. — Du rôle de l’État dans l’enseignement. — De l’instruction intégrale et des écoles professionnelles. — Des dangers que peut offrir un développement excessif et trop soudain de ces écoles.
De l’assurance obligatoire. — Des invalides civils. — Du capital ou pécule à fournir par la commune aux jeunes gens arrivant à l’âge adulte. — Défaut de tous ces projets.
Du compagnonnage et des corporations obligatoires. — L’impôt progressif. — Les dangers du socialisme d’État. — Affaiblissement de l’initiative individuelle. — Les compagnies privilégiées.
Des réformes fiscales nécessaires. — Diminution des droits de mutation et de succession, des taxes sur les transports. — Des conversions de dettes publiques. — Abaissement des droits protecteurs. — Des sociétés anonymes et de la répression des abus financiers.
Une plus grande égalité des conditions sortira toute seule du libre jeu des lois économiques. — Cette plus grande égalité des conditions est un bien, mais non pas un bien sans mélange. — Les grandes fortunes sont souvent un instrument de progrès et rendent plus prompte la propagation du progrès. — Opinion de l’économiste allemand Soëtbeer. — Opinion de l’industriel anglais M. Brassey. — Les sociétés anonymes sont toujours plus mal gérées que les entreprises individuelles. — Opinion d’Herbert Spencer sur ce qu’il est utile que les hommes supérieurs retirent tous les avantages possibles de leur supériorité.
Avantage d’une moindre inégalité des conditions. — La société sera plus assise. — Il y aura moins d’américanisme, moins de recherche exagérée de la fortune. — Consolation offerte aux riches relativement à la déchéance probable de leurs descendants.
Ou nous nous trompons fort, ou les faits exposés dans le cours de cet ouvrage sont démonstratifs et péremptoires. Les sociétés civilisées, surtout les vieilles sociétés européennes, s’avancent vers un état où les richesses seront beaucoup moins inégalement réparties que dans le présent, quoique l’imagination grossisse outre mesure les inégalités de la répartition actuelle.
L’ensemble de causes que nous avons constatées travaille d’une manière continue et avec une croissante énergie. La rente de la terre, menacée par la concurrence des contrées neuves, de l’Amérique, de la Russie, de l’Australie, bientôt du Soudan, de l’Asie centrale et de la Sibérie, a plus de tendance à reculer qu’à se développer de nouveau. N’en déplaise à Ricardo, les propriétaires fonciers, du moins les propriétaires ruraux, ne sont plus les favoris de la civilisation ; on ne peut aujourd’hui les assimiler aux frelons qui pillent la ruche où ils n’ont pas travaillé.
Le privilège de situation territoriale s’amoindrit chaque jour par la facilité et le bon marché des transports ; bien loin que l’on soit au terme de la révolution produite par les voies de communication nouvelles, on se trouve en pleine opération de cette cause si puissante. Transports par terre et surtout transports par eau, fret maritime, iront encore en diminuant ; et le cultivateur européen, ne profitant plus que dans une mesure infinitésimale de la protection des distances, ne tirera de sa terre que le juste équivalent de son travail et aura de la peine à y joindre l’intérêt des capitaux incorporés au sol par ses prédécesseurs. Seuls, quelques propriétaires particulièrement heureux, en nombre d’ailleurs insignifiant, ceux qui détiennent un sol exceptionnellement apte à la production de certaines denrées raffinées, comme des vins de grands crus, pourront voir leur opulence triompher de cette cause si active de nivellement. Mais qu’est-ce qu’une exception aussi rare ? Ce n’est pas, d’ailleurs, l’égalité des richesses que nous annonçons, c’est seulement une moindre inégalité des conditions. Du sein de la presque universelle médiocrité des revenus il émergera toujours quelques énormes fortunes, colosses aux pieds d’argile.
Pour n’être pas aussi menacées que les propriétés rurales, nous ne croyons pas que les propriétés urbaines soient réservées, cependant, à un développement aussi brillant et aussi rapide dans l’avenir qu’il l’a été dans le passé. Un certain nombre d’entre elles jouiront d’une plus-value, c’est incontestable. Presque toutes d’abord gagneront en capital, c’est-à-dire en valeur vénale ; mais l’augmentation des revenus de ce genre d’immeubles sera beaucoup plus lente que depuis trente ou quarante ans, si même cette augmentation se manifeste. Il y a, en effet, deux causes diverses qui commencent à peine à faire sentir leur action : l’une, c’est la baisse du taux de l’intérêt qui permet, avec un même capital, de construire des maisons nouvelles pour lesquelles on se contentera d’un moindre revenu que celui qu’on eût exigé autrefois pour la même somme ; l’autre, c’est le progrès des moyens de communication dans l’intérieur et dans la banlieue des villes, qui permet aux habitations de se disperser sur une plus grande étendue. Que d’améliorations sur ce point attendent encore la plupart des villes du continent et notamment notre grande capitale parisienne ! Si l’État et les municipalités, plus éclairés que dans le passé, supprimaient ou réduisaient à peu de chose l’impôt sur les transmissions d’immeubles et les droits sur les transports, sur les fourrages, sur les matériaux, le résultat serait promptement sensible. L’action des sociétés philanthropiques s’y joignant, on aurait résolu, ce qui serait un si grand bien, le problème du loyer décent, hygiénique et peu coûteux pour les ouvriers et pour la petite bourgeoisie.
À la réduction chaque jour plus sensible du privilège de situation territoriale, il faut ajouter cette autre cause si puissante, ce facteur si énergique du nivellement des conditions, la baisse du taux de l’intérêt. Nous nous sommes assez étendu sur cet important sujet pour qu’il soit superflu d’y revenir. Depuis dix ans nous annonçons chaque jour un pas nouveau dans la réduction de l’intérêt : sans cesse contredit par les hommes qui se croient bien informés, nous voyons néanmoins nos prévisions vérifiées par les faits. L’intérêt, qui, il y a vingt-cinq ans, était encore à 4 1/2 ou 5 pour 100 sur le continent européen pour les placements de premier ordre, est tombé à 3 1/2 en France, à 3 pour 100 en Angleterre (les consolidés ont dépassé le pair) ; on le verra à 2 1/2 et même à 2 pour 100, peut-être un jour à moins ; mais pendant un demi-siècle ou un siècle encore, la mise en exploitation des contrées neuves, l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie, une partie de l’Asie, le soutiendra et l’empêchera de descendre au taux de 1 pour 100 où il arrivera vraisemblablement quand le monde entier sera civilisé, et que les premières œuvres, les plus productives, de la mise en valeur des pays en dehors de l’Europe auront été achevées.
Avec la baisse du taux de l’intérêt, que deviennent les fortunes mobilières ? Que devient la possibilité de former des fortunes nouvelles ? Au fur et à mesure des remboursements des capitaux engagés, au fur et à mesure des conversions, les fortunes mobilières, tout en conservant la même importance nominale et parfois même en l’augmentant, voient diminuer peu à peu leur revenu. Chaque jour insensiblement les rentiers perdent quelque chose de leur rente et de la puissance d’achat qu’elles avaient. Nous n’en voulons d’autre preuve que les deux exemples cités par nous, celui du capitaliste anglais, détenteur de 60 000 livres de rentes sur l’Échiquier britannique, du temps de Robert Walpole au commencement du dix-huitième siècle, qui a vu par des conversions successives son revenu tomber à 30 000 livres à partir du milieu de ce siècle, en attendant qu’il le voit s’abaisser prochainement à 25 000, puis à 20 000 par la conversion projetée du 3 p. 100 consolidé en 2 1/2 p. 100 et un jour en 2 p. 100 ; l’exemple aussi du rentier possédant il y a quinze ans 60 000 fr. de rentes sur le trésor des États-Unis, qui a déjà vu, par toute une série de conversions, son revenu se réduire à 35 000 francs en attendant qu’il s’abaisse à 30 000, puis à 25 000, puis à 20 000. Alors même que l’État, soit par ineptie, soit par faiblesse de caractère, soit par de machiavéliques considérations politiques, manquant à tous ses devoirs, ajourne indéfiniment les conversions comme c’est la coutume en France, la classe des capitalistes, prise dans sa masse, subit néanmoins avec le temps la diminution graduelle de revenu que comporte la baisse du taux de l’intérêt. Les sociétés anonymes en effet, les compagnies commerciales, les départements, les villes, les particuliers, tous les emprunteurs, moins benêts ou moins engourdis que l’État, se hâtent de rembourser leurs emprunts contractés à l’ancien taux et de leur substituer des emprunts nouveaux contractés à un taux plus réduit. C’est ce qu’ont fait dans les récentes années en France le Crédit foncier, plusieurs sociétés de transports, trente ou quarante départements, une centaine de villes et tous les particuliers solvables.
Quant à la facilité de former d’importantes et de rapides fortunes nouvelles, combien n’est-elle pas amoindrie par la baisse du taux de l’intérêt ? Combien n’est-il pas plus malaisé d’arriver avec des économies annuelles considérables à se faire un chiffre respectable de rentes et à pouvoir se retirer des affaires avec une opulence assurée ?
On a montré, dans le cours de cet ouvrage, toute la série de causes trop inaperçues qui tendent à réduire de plus en plus les profits des industriels et des commerçants. Les profits, tout en étant distincts de l’intérêt du capital, en suivent, d’ordinaire, les fluctuations, si bien que, lorsque l’intérêt baisse, les profits des industriels et des commerçants tendent à baisser dans une proportion équivalente. Cette assertion choque les préjugés vulgaires et paraîtra même, à quelques observateurs superficiels, contraire aux faits. Elle n’en est pas moins d’une vérité certaine. À la longue, non pas immédiatement, les bénéfices industriels et commerciaux fléchissent comme le taux de l’intérêt lui-même.
Que de causes d’ailleurs, toutes nouvelles et très actives, déprécient la situation des industriels et des commerçants ? La concentration des affaires leur porte un coup sensible ; la propagation de l’instruction et la vulgarisation de l’aisance mettent chaque jour un nombre de plus en plus grand de citoyens en possession des moyens intellectuels et moraux d’exercer convenablement le négoce ; il en résulte que la concurrence est de plus en plus pressante dans les professions commerciales. L’aléa se restreint, les opérations deviennent plus connues, les découvertes se répandent plus vite, les secrets industriels sont plus difficiles à garder. Toutes les industries déjà anciennes ne peuvent plus procurer que des gains réduits. Il n’y a guère que l’inventeur d’un produit nouveau ou d’un procédé perfectionné qui puisse faire rapidement fortune, s’il est assez heureux pour que ce procédé épargne beaucoup de dépenses ou pour que ce nouveau produit soit très goûté.
Ce que nous avons appelé « la période chaotique de la grande industrie », celle des grands hasards, de la concurrence restreinte, des surprises fréquentes, des énormes écarts de prix, est close ou sur le point de se clore. Or, c’est dans les commencements, dans les tâtonnements des entreprises peu connues que les esprits éveillés et agiles, d’ailleurs pourvus des moyens matériels nécessaires, peuvent ramasser de grandes fortunes. Cet âge des récoltes faciles est bien vite épuisé.
Dans les professions libérales — sauf pour quelques artistes et quelques sujets tout à fait exceptionnels que nous avons appelés les princes, les élus de la civilisation moderne — s’effectue ou plutôt s’annonce le même phénomène de nivellement. L’instruction universellement répandue multiplie outre mesure la concurrence dans ces occupations ; il en est de même pour la classe des fonctionnaires, pour celle surtout des employés. Tous ces milliers de jeunes gens que les sacrifices de leurs familles ou la générosité de l’État ont dotés d’une instruction complète se précipitent dans ce champ étroit qu’ils encombrent ; pressés les uns contre les autres, se disputant à outrance les clients et les places, ils n’arrivent qu’à déprimer la rémunération moyenne de leur classe.
Le privilège de l’instruction — cette autre cause d’inégalité des fortunes — a presque disparu, de même que le privilège de situation pour les terres. La capacité moyenne, utile, estimable, qui était bien appointée jadis, parce qu’elle constituait encore une rareté, se paye aujourd’hui à un prix dérisoire. Les employés, les bacheliers, les gens qui ont des diplômes ou des degrés quelconques, ce sont là les prolétaires de l’avenir, mille fois plus à plaindre, pour la disproportion entre leurs besoins et leurs ressources, que les simples artisans qui d’ailleurs partout seront bientôt plus rémunérés, le sont même souvent déjà, que tous ces demi-savants sortis de nos superficielles écoles. Ce qui va entretenir et développer le paupérisme, c’est le lycée ou le collège gratuit.
Combien est différent, combien le sera, surtout dans l’avenir, le sort du travailleur manuel ! Toutes les forces de notre civilisation tendent à l’améliorer, à l’élever. C’est ici que l’on saisit toute la fausseté, du moins dans ses applications au temps présent, de l’ancienne école économique. Toutes les dissertations de Turgot et d’Adam Smith sur la dépendance où se trouve l’ouvrier vis-à-vis du patron, toutes les distinctions subtiles de Ricardo et de Stuart Mill sur le prétendu « salaire naturel » et sur le non moins chimérique « fonds des salaires », sont de véritables enfantillages sans aucune portée pratique. La célèbre « loi d’airain », inventée par Lassalle, la « constitution de l’humanité en pauvreté », imaginée par Proudhon, sont des rêveries qui n’ont aucune analogie avec la réalité.
Fort de l’abondance des capitaux, de la multiplication des machines, de la demande de bras sans cesse accrue, étant depuis vingt ans seulement en pleine possession de la liberté industrielle, ayant désormais toutes les faveurs du législateur et de l’opinion publique, pouvant s’entendre, se concerter, possédant soit individuellement, soit collectivement des épargnes, ayant en main cette arme si redoutable et, quoi qu’on en ait dit, si puissamment efficace de la grève, le travailleur manuel va devenir le favori de la civilisation. Sa rémunération réelle s’accroît et s’accroîtra, même en tenant compte du renchérissement de certains objets ; ses loisirs s’élargissent, la sécurité de sa vieillesse augmente. Toutes les situations acquises se dépriment au-dessus et autour de lui ; la sienne seule grandit. Les causes diverses qui contribuent à ce relèvement du travailleur manuel, nous les avons analysées ; nous avons dissipé notamment les préjugés si nombreux sur les grèves, et nous avons démontré qu’en définitive les grèves avaient été, dans le passé du moins, beaucoup plus utiles que funestes à l’ouvrier. Cela est si vrai, qu’il lui est difficile aujourd’hui de conserver la modération et de ne pas abuser de ses avantages au point de finir par souffrir de conquêtes exagérées ou prématurées. Si la condition moyenne des ouvriers s’élève, les situations exceptionnelles de détresse et de misère ont aussi, nous l’avons prouvé, une tendance à devenir plus rares. Il nous a été facile de dissiper sur ce point les préjugés, non seulement de la foule, mais des hommes instruits et de quelques savants. Il est faux que l’industrie engendre le paupérisme : la diminution depuis trente ans du nombre de personnes assistées en Angleterre est la preuve irrécusable de notre assertion. Sans doute il est absurde d’espérer que l’on supprimera la misère ; autant vaudrait prétendre supprimer le vice ou la phtisie. Mais d’année en année la vraie misère fera dans l’ensemble de la population une moindre proportion de victimes. Quand les combinaisons ingénieuses que l’humanité n’a commencé à appliquer que depuis cinquante ans seront avec le temps universellement connues ; quand les secours mutuels, les assurances contre les accidents, sur la vie, seront devenus d’une pratique vulgaire, le nombre des pauvres sera singulièrement réduit. L’assurance est un procédé qui est encore dans l’enfance. On peut dire qu’en théorie l’assurance n’a pas conquis la moitié peut-être du domaine qui lui appartient et que dans la pratique les neuf dixièmes de ce domaine sont en friche. L’indigence deviendra alors un fait beaucoup plus rare : au lieu d’un pauvre sur vingt ou trente habitants comme aujourd’hui en France et en Angleterre, il ne se rencontrera peut-être dans les contrées civilisées qu’un pauvre sur cinquante, sur soixante, sur quatre-vingts, même sur cent individus. L’indigence est le produit soit des accidents, soit des vices. On peut parer, par d’heureuses combinaisons sociales, à presque tous les accidents. Il n’en est pas de même des vices ; mais, sans être un partisan déterminé de la doctrine de l’évolution, on ne peut nier qu’à travers les âges les vices, sans perdre peut-être en intensité, se modifient ; il n’y aurait rien d’étonnant à ce que le vice le plus productif d’indigence — l’ivrognerie — devint dans un quart ou un demi-siècle plus exceptionnel dans la population ouvrière. Quand celle-ci aura à sa disposition des logements plus convenables, plus spacieux, plus propres, quand son éducation se sera davantage développée, qu’on aura résolu le problème des récréations et des distractions pour le peuple, quand d’ailleurs le régime général alimentaire des ouvriers se sera amélioré[1], il n’est pas impossible que l’ivrognerie, qui fait aujourd’hui tant de victimes directes et indirectes, ait beaucoup moins d’empire et qu’elle cesse de dégrader une notable partie de la population qui vit du travail manuel ; ce vice n’est-il pas devenu singulièrement rare dans l’aristocratie, qui autrefois était, en grande partie soumise à son joug ? Les mêmes causes, s’appliquant au peuple, produiront chez lui les mêmes effets.
De tout ce qui précède il résulte que ce que l’on appelle la question sociale se résout d’elle-même, autant du moins qu’elle est résoluble, peu à peu, par parcelles, avec la simple collaboration du temps, du capital, de l’instruction, de la liberté, de la philanthropie, de la charité aussi, que beaucoup d’économistes traitent trop sévèrement et que nous ne dédaignons pas.
Cette solution qui s’accomplit naturellement, peut-on la hâter par des arrangements artificiels et imposés par l’État ? C’est assurément une séduisante tentative que celle de faire intervenir l’État, l’agent souverainement régulateur, le premier banquier de chaque nation, si nous pouvons ainsi parler, dans les relations entre les diverses classes et de lui confier le soin de pourvoir à une moindre inégalité des conditions. Que ne peut faire l’État ? Il légifère, et l’on doit lui obéir ; il emprunte à bon marché, et il peut prêter de même. Tout ce qu’il fournit aux citoyens à grands frais a l’apparence de la gratuité. Il semble à beaucoup de gens qu’il y ait de la part de l’État soit une excessive timidité, soit une impardonnable dureté à se tenir à l’écart.
Telle n’est pas notre opinion. L’État a sans doute un rôle à jouer, des devoirs à remplir ; mais ce rôle n’est pas aussi prédominant qu’on veut bien le croire, ni ces devoirs aussi vastes. Les lois, en ce qui concerne une approximation vers une moindre inégalité des conditions, ont plutôt une puissance négative, qu’une positive action. Il y a dans les lois et dans les règlements beaucoup d’obstacles artificiels à la libre répartition des richesses et des revenus ; ces obstacles ont, en général, pour effet de créer des privilèges, et de maintenir certaines catégories de personnes en possession d’avantages qui naturellement ne leur appartiennent pas ou qui leur seraient depuis longtemps échappés si elles n’avaient pas eu, pour les retenir, le secours de la force publique. Ces lois-là, il faut les supprimer, c’est équité et c’est en même temps utilité.
L’Angleterre par exemple a tout intérêt à rapporter les lois terriennes qui consacrent les substitutions et les majorats, et à adopter si ce n’est le système français de l’égalité des partages entre enfants, légèrement tempérée par une faible quotité disponible, du moins le système rationnel de la liberté de tester. Beaucoup de nos lecteurs s’étonneront de ce que dans un ouvrage sur la répartition des richesses nous n’ayons pas parlé abondamment de l’influence de nos lois de succession. C’est qu’il nous suffisait de traiter des grandes causes économiques générales, infiniment plus puissantes que toutes les lois humaines. Comparées aux lois économiques qui régissent le taux de l’intérêt, ou la rente de la terre, ou les salaires, nos lois de succession n’ont qu’une action secondaire. Ces lois, d’ailleurs, nous les désapprouvons comme trop rigoureuses, nous avons émis bien des fois cette opinion dans l’Économiste français et ailleurs. Nous souhaitons que l’on donne à la liberté de tester plus d’ampleur et que jamais la quotité disponible ne soit inférieure à la moitié du patrimoine, tandis qu’elle est seulement du quart quand il y a trois enfants ou plus. Il ne faut pas se dissimuler, cependant qu’octroyée dans ces limites, la liberté de tester, utile dans des cas particuliers, n’aurait pas une influence considérable sur la répartition des richesses. Les mœurs et les idées démocratiques se sont emparées de toutes les classes de la population, à peu d’exceptions près, et il sera toujours exceptionnel qu’un père avantage de plus du quart l’un de ses enfants. Aujourd’hui, d’ailleurs, avec les titres de valeurs mobilières qui sont si répandus, les personnes de la bourgeoisie ont bien des facilités pour tourner la loi si elle leur déplaît ou si elle les froisse. Une extension de la liberté de tester doit être réclamée comme conforme à l’équité dans beaucoup de cas particuliers, mais cette réforme ne changera pas notre état social[2].
Les publicistes qui veulent que l’État travaille activement à amener une moindre inégalité des conditions ont vis-à-vis de lui des exigences beaucoup plus grandes que celles que nous venons de relater. Ils prétendent qu’au moyen des écoles, des règlements industriels, de l’impôt et du crédit dont il jouit, il rabaisse les riches et exalte les pauvres.
L’instruction semble un instrument tout puissant de nivellement. On a vu plus haut qu’en effet la vulgarisation de l’instruction a enlevé à la classe bourgeoise un véritable monopole de fait qui avait été pour elle très productif. L’instruction générale réduit les gains et les bénéfices dans les professions libérales, dans les fonctions du gouvernement, dans les emplois des sociétés, dans l’industrie et le commerce même, en multipliant les individus qui sont aptes à être de bons employés, de bons fonctionnaires, de bons commerçants. L’instruction peut encore se répandre davantage en amenant à sa suite d’une manière plus accentuée et plus intense les effets que nous venons d’indiquer. L’école primaire est déjà gratuite dans toutes les villes et elle va l’être obligatoirement même dans les campagnes. Les bourses sont très nombreuses et elles le deviennent de plus en plus. On crée des écoles primaires supérieures, on augmente le nombre des écoles d’arts et métiers, on va instituer des lycées féminins. Rien de mieux : en rendant l’instruction moins rare, on multiplie dans la société le nombre d’hommes capables de travaux intellectuels ; mais en même temps, par une conséquence forcée, on diminue le prix vénal de cette catégorie de travaux et de services. L’instruction dans cette mesure n’en reste pas moins un bien social, même un bien individuel, en ce sens qu’elle ouvre l’esprit à plus d’idées, à plus de jouissances, à une vie plus ample et plus variée ; mais les services intellectuels, en devenant de plus en plus offerts, si, comme il est probable leur accroissement dépasse l’accroissement de la demande, perdront considérablement, ont déjà perdu de leur valeur d’échange.
Cette dépréciation des services intellectuels n’a que de médiocres inconvénients quand elle est contenue dans certaines limites ; c’est une des formes de ce phénomène si remarquable de l’approximation à une moins grande inégalité des conditions. Il se pourrait cependant que, par un excès de zèle et de bonnes intentions, l’État, les municipalités, les institutions philanthropiques et charitables dépassassent de beaucoup la mesure. Si l’on rendait subitement gratuite l’instruction intégrale ; si, au moyen de concours où la faveur a toujours beaucoup de place et où l’indulgence est exagérée, on faisait donner l’instruction secondaire et l’instruction supérieure à une foule d’individus sans fortune et d’une capacité médiocre ; si l’on créait, comme on l’a demandé, des écoles professionnelles dans tous les quartiers des grandes villes, dans tous les chefs-lieux de canton, ou même dans toutes les communes ; si l’on agissait ainsi à la légère, préparant chaque année des dizaines de mille hommes et de femmes aux professions libérales, aux emplois de bureau, aux carrières artistiques, aux métiers manuels les plus relevés, on n’arriverait sans doute qu’à fausser tous les rapports économiques, à rendre l’offre de certains services surabondante relativement à la demande, à déprimer outre mesure les salaires des états les plus intellectuels, à jeter au sein de la société des légions d’individus qui n’auraient aucun moyen de vivre. C’est là la voie dans laquelle on veut, par un zèle malentendu, pousser le gouvernement et où il entrera peut-être.
Rien n’est plus délicat, rien ne demande plus de mesure que l’enseignement professionnel. Si l’État veut se mettre à fabriquer, outre des bacheliers, des comptables, des teneurs de livres, des peintres, des sculpteurs, des praticiens, des dessinateurs, des horlogers, des bijoutiers, des mécaniciens, des ébénistes, des serruriers, des menuisiers, des charpentiers, des tailleurs, etc. ; si, au lieu de donner aux enfants certaines connaissances générales, des indications qui peuvent être utiles dans beaucoup de situations différentes, il veut leur enseigner un métier spécial, alors il encourt la responsabilité la plus lourde ; il se fait distributeur du travail et des tâches ; il imite le législateur antique ou celui du Moyen âge qui fixait le nombre d’ouvriers devant travailler dans chaque profession ; il prétend dominer le marché du travail, déterminer l’offre et la demande. En voulant être régulateur, il est perturbateur. L’État, dans ces conditions, serait un agent de paupérisme, un créateur d’indigents. Qu’on y prenne garde ; de même que la charité légale entretient la misère, ainsi l’enseignement professionnel, distribué par l’État sans mesure et sans réflexion, produirait des logions nouvelles de pauvres.
Proudhon déjà s’était ému, dans ses Contradictions économiques, du nombre croissant d’artistes, d’ingénieurs, de constructeurs, qui sortaient de nos écoles. Mais qu’était du temps de Proudhon la concurrence dans ces professions auprès de ce qu’elle est aujourd’hui ? Un exemple récent montre les dangers d’une intervention excessive de l’État ou des institutions philanthropiques dans l’enseignement professionnel. Une femme dévouée et intelligente ouvrit, il y a quelques années, une école professionnelle pour les jeunes filles à Paris ; parmi les métiers élégants qu’on leur enseignait se trouvait la peinture sur porcelaine, tâche lucrative alors. Ce joli travail tenta beaucoup d’élèves. Au bout de peu d’années il était sorti de cette école tant de jeunes filles sachant la peinture sur porcelaine, que la rémunération dans cet état baissait considérablement, et que beaucoup de ces jeunes filles ne pouvaient plus trouver de travail. Que serait-il arrivé si, la philanthropie étant plus développée, on eût ouvert au même moment en France cent écoles professionnelles pour les jeunes filles, où l’on eût enseigné la peinture sur porcelaine ? On se fût donné beaucoup de mal pour apprendre laborieusement à de pauvres femmes un métier qui ne les eût pas nourries[3].
Le paupérisme qui est à craindre aujourd’hui, ce n’est pas celui des misérables qui ne savent ni lire ni écrire, c’est le paupérisme des hommes instruits, plus ou moins capables de toute tâche de bureau ; voilà les vrais pauvres dont la civilisation, si elle n’y prend garde, produira des légions à l’avenir.
Sans doute un temps viendra peut-être où l’instruction moyenne sera tellement vulgaire qu’elle ne donnera aucune haute opinion de lui-même à celui qui l’aura reçue, qu’on entendra un laboureur poussant sa charrue réciter les vers harmonieux des Géorgiques, ou qu’on verra les ouvriers des métiers les plus rebutants disserter avec compétence sur la physique et la chimie. Ce temps peut venir ; mais il est encore loin. On est trop près de l’âge où l’instruction était un monopole pour qu’elle ne gonfle pas d’espérances illimitées le cœur de ceux qui la possèdent. De là cette désertion des métiers manuels dont la rémunération hausse toujours, et cet encombrement des professions intellectuelles dont les profits s’abaissent. Jusqu’à ce qu’un lent travail d’adaptation se soit produit, jusqu’à ce que l’homme instruit se soit résigné à des tâches qui jusque-là étaient confiées aux simples illettrés, l’État, s’il ne veut pas, dans cette période de transition, être un agent de déclassement et de découragement, devra apporter beaucoup de mesure et de réserve à répandre ce que l’on appelle l’instruction intégrale et l’enseignement vraiment professionnel. Il devra s’en tenir à un enseignement préparatoire général.
Dans le mois de septembre 1880, on écrivait de Sydney au Times que les maçons gagnaient de 11 à 13 shellings (13 fr. 75 à 16 fr. 25) par journée de huit heures, et que la plupart des autres métiers manuels (mechanics) étaient payés à l’avenant ; qu’au contraire les jeunes gens ayant de l’instruction ne pouvaient que très difficilement trouver à vivre. Ainsi un jeune homme de bon caractère et instruit, après avoir frappé pendant plusieurs années à beaucoup de portes, avait dû finir par se faire sergent de ville (I know one steady, well educated young man here, who after several years of knocking about, is now a police-man) ; un autre était parvenu à entrer dans une banque où il gagnait 75 livres sterling (1 875 francs) par an, tandis que la plupart des artisans, s’ils ont une bonne conduite, possèdent en peu d’années une maison à eux. Ces observations d’un Anglais d’Australie s’appliquent fort bien à la société de l’avenir. Déjà dans les grandes villes de France il se produit quelque chose d’analogue. Un bon artisan ordinaire gagne à Paris 7 ou 8 francs par jour, auxquels viennent souvent s’ajouter des heures supplémentaires grassement payées, ce qui lui fait en tout 2 000 à 2 500 francs par an. Un employé capable, rangé, a beaucoup de peine à trouver une place de 125 à 150 francs par mois, c’est-à-dire de 1 500 à 1 800 francs par an. L’écart entre ces deux natures de rémunération devra encore s’accentuer dans le même sens.
Si l’État ne doit céder qu’avec circonspection à ceux qui lui demandent de distribuer à tout venant l’instruction intégrale et l’instruction professionnelle, il doit résister encore davantage à ceux qui voudraient qu’il constituât des retraites civiles, qu’il rendit obligatoire l’assurance sur la vie et toutes sortes d’autres combinaisons aussi séduisantes.
Certes, s’il était efficace, ce serait un procédé facile et commode d’établir le bonheur universel que d’édicter que chaque ouvrier supportera sur son salaire une retenue de 5 p. 100, que chaque patron devra fournir, pour le compte de chacun des ouvriers qu’il emploie, une cotisation de 5 p. 100 aussi, et que l’État, le père commun des citoyens, survenant en dernier lieu et comblant la mesure, aurait à allouer une subvention égale aux cotisations réunies de l’ouvrier et du patron. Ce ne serait pas sans doute un mince sacrifice que l’on imposerait à l’État, puisque, en calculant à dix milliards de francs — ce qui n’est pas exagéré — le montant total des salaires en France, on réclamerait ainsi de lui un milliard annuellement. On ne manquera pas de dire que les retenues et les subventions dont nous venons de fixer le chiffre seraient trop élevées, qu’on pourrait les réduire de moitié, ce qui ramènerait à 500 millions environ la subvention de l’État, ou même des trois quarts, ce qui la limiterait à 250 ou 300 millions. Dans ces proportions, la retenue obligatoire sur le salaire de l’ouvrier serait de 1,25 p. 100, soit de 12 fr. 50 par 1 000 francs ; le patron devrait fournir une somme égale, et l’État doubler le tout. De ces trois éléments il résulterait que l’ouvrier bénéficierait, à la Caisse nationale des retraites, d’un versement annuel égal à 5 p. 100 de son salaire, et en outre des intérêts composés de chacun des versements qu’il aurait faits ou qu’on aurait faits pour lui jusqu’au jour où sa pension serait liquidée. Chaque travailleur manuel deviendrait ainsi un fonctionnaire. Dans l’hypothèse de la retenue la plus faible que nous venons d’indiquer, la pension de retraite échéant à chaque ouvrier serait singulièrement minime. Au taux de 3 1/2 p. 100, qui est le taux de capitalisation qu’on peut admettre comme le plus élevé possible d’ici à la fin du siècle, l’ouvrier arrivant à cinquante-cinq ans, après trente-cinq ans de retenues consécutives, ne pourrait guère avoir droit qu’à un capital de 4 000 fr. au plus, ou à une rente viagère de 250 ou 300 francs. Nous faisons ces calculs approximativement, ne nous piquant pas d’être actuaire. [4]
Pour arriver à un résultat sérieux, il faudrait doubler les retenues imposées à l’ouvrier et au patron et les sacrifices demandés à l’État, de façon que l’ensemble de la somme capitalisée annuellement au profit de l’ouvrier équivalût à 10 p. 100 de son salaire. La subvention de l’État monterait alors à 500 ou 600 millions par an environ, c’est-à-dire que les impôts devraient être accrus d’autant, par conséquent le prix des vivres ou du moins le prix de la vie notablement augmenté. Or, nous allons voir que l’un des plus puissants moyens qu’ait l’État de contribuer à l’avènement d’une moindre inégalité des conditions, c’est précisément de supprimer beaucoup d’impôts mal établis qu’il serait, d’ailleurs, très difficile de remplacer par de meilleurs. D’autre part, il est incontestable que la retenue imposée au patron serait en fait supportée par l’ouvrier, le premier s’efforçant de réduire les salaires d’autant. L’ouvrier verrait donc sa rémunération baisser en même temps que le surcroît d’impôts élèverait le prix de la vie. Tous les ouvriers supporteraient-ils facilement un semblable régime, et regarderaient-ils comme un bienfait cette contrainte imposée ? On dira qu’on ne leur demandera pas leur opinion et que, malgré eux, on leur fera du bien. Cette réponse n’est pas persuasive, sous un régime démocratique. On arriverait, sans doute, par degrés à dispenser l’ouvrier, ou du moins certaines catégories d’ouvriers, de la retenue et à faire supporter par les patrons et par l’État seuls la totalité des cotisations. Les impôts enfleraient d’autant.
Obtiendrait-on, même au moyen de tous ces sacrifices, le résultat qu’on se propose ? Supprimerait-on le paupérisme ? Non, car il y aurait toujours des êtres faibles qui ne pourraient guère travailler, et des êtres paresseux qui ne voudraient pas travailler. Il y en aurait d’autres imprudents, dépensiers, insouciants, qui engageraient d’avance leur assurance sur la vie ou leur pension ; on aurait beau déclarer celle-ci insaisissable, on trouverait toujours des moyens de tourner la loi.
Ce système si bruyamment recommandé et en apparence d’une si facile application aurait le sort de tous les arrangements imposés, de toutes les combinaisons qui veulent améliorer la destinée de l’homme, sans améliorer l’homme même, son esprit, ses mœurs. Il contribuerait simplement à décourager les industries privées concurrentes, les compagnies d’assurances sur la vie soit anonymes et intéressées, soit mutuelles ; à l’organisation toujours simple, féconde, inventrice des sociétés particulières, des institutions philanthropiques, des individus, il substituerait la lourde, uniforme et paresseuse bureaucratie de l’État.
Il existe en France une Caisse des retraites que l’État a fondée il y a près de trente ans. Cette caisse fait aux petits épargnants des avantages considérables. Non seulement l’État ne retire aucun bénéfice de cette catégorie d’opérations ; mais encore il s’impose des pertes sensibles ; il fonde ses calculs sur un taux d’intérêt bien supérieur au taux du marché des capitaux à l’heure actuelle ; c’est le budget qui doit fournir une partie des ressources de cette institution, qui autrement tomberait en faillite. Néanmoins cette caisse n’attire pas le public, qui préfère, en général, s’adresser aux compagnies d’assurances privées, tellement l’État trouve toujours le moyen, même avec les meilleures intentions, d’être désagréable et rebutant. Il ne suffit pas de faire le bien ; il faut savoir le faire : l’État ne sait pas le faire ; il en est empêché par une sorte d’incapacité naturelle qui est sa rigidité et son invincible attachement à la routine.
Beaucoup d’autres projets ont été proposés soit par des publicistes, soit même dernièrement par des membres de notre Chambre des députés. Un de nos honorables représentants s’est avisé de vouloir que la commune soit contrainte de fournir à chacun de ses enfants un pécule, un capital destiné à lui ouvrir une carrière, au moment où il arriverait à la majorité. Rien ne serait plus simple : on établirait un impôt spécial, probablement progressif, sur les capitaux ou les revenus des habitants de la commune, et au moyen de cette sorte de tontine forcée on constituerait à chaque jeune homme et à chaque jeune fille de 21 ans une dot qui pourrait être de 1 000, 2 000, 3 000 ou 4 000 francs. Avec de pareils enfantillages on croit résoudre ce que l’on est convenu d’appeler la question sociale. Si l’on voulait organiser dans tout le pays une gigantesque bombance, on ne s’y prendrait pas autrement. Le seul argent qui, d’ordinaire, est bien employé est celui que l’on a gagné. Dans les trois quarts des cas, les 1,000, 2 000, 3 000 ou 4 000 francs de dot ou de pécule ainsi fournis obligatoirement par chaque commune à chaque jeune homme ou à chaque jeune fille seraient sottement ou inutilement dépensés. D’ailleurs tous ces projets tendent toujours à l’augmentation des impôts. Il y a sept cent mille jeunes gens des deux sexes environ qui arrivent chaque année à l’âge de 20 ans ; pour leur donner à chacun 4 000 francs, il faudrait donc 700 ou 800 millions d’impôts en plus de ceux que nous supportons déjà. Puis, ces 1 000 francs communiqueraient-ils à ceux qui les recevraient l’esprit d’ordre, d’économie, l’ardeur au travail ? Supprimeraient-ils toutes les défaillances de caractère ou d’intelligence ? Qui oserait le soutenir ?
Par cette intervention dans la répartition des richesses, l’État atteindrait un résultat opposé à celui qu’il poursuit. Au lieu d’encourager l’épargne, il en détournerait, puisqu’il ferait à ceux qui n’épargnent pas des dons gratuits ; au lieu de pousser au travail, il mettrait les hommes indolents, ayant quelque penchant à la fainéantise, en situation de bien vivre plusieurs semaines, plusieurs mois sans travailler.
Il est inutile de discuter plus longtemps toutes ces hypothèses et beaucoup d’autres. Quelques personnes, par exemple, ne voient le salut que dans le rétablissement de la corporation. Si par ce mot elles entendent uniquement une plus ample liberté d’association et de réunion, la suppression de diverses entraves soit administratives, soit fiscales, qui empêchent les intérêts similaires de se grouper, de se fortifier et de se soutenir par leur union ; elles ont raison. Mais si, comme c’est le désir manifeste ou secret de la plupart d’entre elles, on entend par ce mot de corporation une institution, ayant les caractères principaux des corporations d’autrefois, c’est-à-dire ayant le pouvoir d’édicter des règlements obligatoires, de repousser certaines personnes, sous des prétextes quelconques, de l’exercice d’un métier, d’imposer à tous ceux qui exercent une profession certains procédés, certaine manière de conduite, nous ne craignons pas de dire qu’au bout de peu de temps on se trouverait en présence d’intolérables tyrannies, qui arrêteraient ou du moins ralentiraient le progrès, qui entraveraient le principal agent de la civilisation moderne, l’initiative individuelle dans toute sa liberté et toute sa spontanéité.
La liberté et le temps suffisent pour résoudre toutes les difficultés sociales, qui sont humainement résolubles. Le grand danger d’aujourd’hui, c’est le socialisme d’État, c’est-à-dire non pas le socialisme imposé par les ardeurs d’une foule en émeute, mais le socialisme sournoisement introduit et graduellement développé par les législateurs présomptueux et ignorants. L’extension de toute administration d’État nous est suspecte ; on trouve toujours dans les administrations de l’État plus de sinécures, plus de privilèges, plus de paresse, plus d’arrogance et de servilité à la fois que dans les administrations particulières.
Le rôle de l’État relativement à la répartition des richesses est très simple ; il ne consiste pas à prendre aux uns pour donner aux autres, à faire de l’impôt un instrument de redressement des inégalités sociales. Quand il poursuit cet idéal de quelques-uns, l’État devient dans la vie économique un élément perturbateur ; il n’obtient, d’ailleurs, que des résultats illusoires. C’est ainsi que l’impôt progressif, préconisé par tant d’esprits étourdis et par quelques économistes mal inspirés, ne conduit qu’à des déceptions, à des dissimulations ou à des émigrations de capitaux ; quand le fisc se montre ainsi violent, inégal, ou bien on le fraude, ou on le fuit, en mettant la frontière entre sa fortune et lui, et en prenant quelque banque étrangère pour dépositaire des capitaux ou des revenus qu’on a. Nous avons fourni ailleurs la démonstration de l’iniquité et de l’inefficacité de cet impôt[5], dans lequel les badauds seuls peuvent aujourd’hui avoir confiance.
Le rôle de l’État consiste uniquement à enlever les obstacles d’origine administrative ou législative qui s’opposent à une moindre inégalité des richesses. L’État n’a pas à se proposer pour but le plus grand bonheur du plus grand nombre, comme l’imaginent d’un côté certains utilitaires tels que Bentham, et de l’autre côté les socialistes. Un grand philosophe, d’une étonnante puissance d’analyse, Herbert Spencer, a admirablement réfuté cette doctrine aussi fausse que séduisante[6]. La justice, c’est le seul idéal que l’État doive poursuivre, et la justice dans les sociétés modernes consiste à supprimer toutes les causes artificielles qui favorisent certains individus aux dépens des autres, qui empêchent toutes les activités de se développer librement en tant qu’elles n’empiètent pas sur la liberté des autres activités. La stricte justice, et rien de plus, voilà l’idéal social, et la justice doit s’entendre en ce sens que les individus font eux-mêmes leurs destinées, que l’État leur doit seulement une aide négative, celle qui consiste à ne pas les entraver dans leurs efforts, dans leur initiative, et à ne pas permettre qu’ils soient entravés par autrui. Nous citions tout à l’heure le plus grand philosophe de ce temps, Herbert Spencer ; on ne saurait trop admirer la lumineuse précision avec laquelle il traite en passant, dans un mot, dans une phrase, les sujets économiques les plus ardus. Quand il parle de la « coopération harmonieuse », quand il dit que « la base de la coopération est la proportion établie entre les bénéfices reçus et les services rendus », il rejette toutes les combinaisons artificielles des socialistes soit de l’ancienne, soit de la nouvelle école. Sans doute la justice, comme il le dit, n’exclut pas la bienfaisance, nous ajouterons qu’elle n’exclut pas la charité, ce mot qu’on a voulu ridiculement expulser de la langue française. Mais la bienfaisance et la charité, sauf quelques cas d’assistance tout à fait rudimentaire dont l’État peut se mêler, appartiennent essentiellement au domaine des particuliers et des sociétés libres.
En se bornant à procurer la justice dans la plus large acception du mot, l’État a, d’ailleurs, bien assez de réformes à opérer. Jusqu’ici l’État a été un des facteurs de l’inégalité des richesses. Ce n’est que dans ces derniers temps qu’il s’est décidé à rendre égales la situation de l’ouvrier et celle du patron. La liberté complète du contrat de salaire, on l’a prouvé dans un des chapitres de ce livre ne date pas de vingt ans. L’État est encore un obstacle à l’exercice régulier du droit d’association.
Au point de vue de la justice vulgaire, l’État mérite bien des critiques. On le voit créer sans motif des sociétés financières privilégiées dont il nomme les directeurs ou les gouverneurs attribuant ainsi à des incapables de riches sinécures qui n’ont été gagnées, d’ordinaire, que par la courtisanerie et l’intrigue. On le voit encore tolérer un brigandage, une piraterie effrontée, sous le couvert des sociétés anonymes et d’émissions d’actions ou d’obligations. L’État laisse de prétendus financiers avec le secours d’une presse vénale dérober audacieusement, publiquement, les épargnes des petites gens ; il ne fait aucun effort pour arrêter les spoliations dont il est le témoin, et dont beaucoup de membres des assemblées législatives, en leur qualité d’hommes privés il est vrai, sont les complices et les bénéficiers. L’État qui punit sévèrement l’escroc de bas étage et le voleur vulgaire respecte, honore, charge de décorations et de cordons les grands détrousseurs du public. La corruption des sociétés anonymes est aujourd’hui la cause principale, presque la seule, des énormes fortunes. Mais comment l’État s’occuperait-il de couper court à ces scandales, comment ne les couvrirait-il pas de l’impunité quand sur 800 membres d’un parlement, plus du tiers, peut-être plus de la moitié participe aux syndicats, aux fondations, aux émissions, aux razzias de primes ?
Si nous examinons la fiscalité nous sommes frappé non pas de l’énormité des droits de consommation, qui comme compensation font hausser les salaires, mais de certaines taxes absurdes d’enregistrement, celles qui confisquent la totalité des petits héritages, celles qui, frappant démesurément les transmissions d’immeubles entre vifs, empêchent l’ouvrier d’acquérir facilement sa demeure, celles qui en grevant les transports contraignent les ouvriers de s’agglomérer au sein des villes populeuses au lieu de leur permettre de se répandre dans la campagne, celles encore qui en prélevant une dime sur les dons et les legs entravent la formation de cette richesse commune et collective dont l’extension doit être la contrepartie et comme la rançon de la propriété privée.
Quand il représente la généralité des contribuables, l’État, dans certains pays du moins, en France surtout, est d’une déplorable faiblesse, d’une imprévoyance inexcusable. Il sacrifie presque toujours l’intérêt général à l’intérêt particulier, quand cet intérêt particulier groupe toute une catégorie de personnes, pour ainsi dire toute une classe. Si la concurrence des pays neufs vient à diminuer le prix du pain et de la viande, par conséquent, à faire baisser la rente de la terre, on voit le gouvernement s’inquiéter et être prêt à intervenir pour empêcher, par le renchérissement artificiel de la viande et du pain, que les fermages ne viennent à baisser. L’État ne s’aperçoit pas qu’il s’oppose ainsi au mouvement naturel qui nous porte vers une moindre inégalité des conditions ; qu’il intervient en faveur des riches ou des gens aisés, les propriétaires fonciers, contre le gros du public qui est toujours plus ou moins gêné. Si des causes de même nature viennent à faire baisser le taux de l’intérêt, ce qui est encore un des moyens d’arriver à une moindre inégalité des conditions, on voit aussi, dans certains pays l’État s’alarmer et se mettre en travers ; il prend fait et cause pour les rentiers, il hésite à les rembourser, à convertir ses dettes, il leur fait des largesses au détriment de l’ensemble des contribuables.
Ainsi l’État, dans des contrées aussi avancées en civilisation et aussi démocratiques en apparence que la France, n’hésite pas à recourir à des combinaisons artificielles, à des arrangements d’autorité pour prévenir une baisse graduelle de la rente de la terre et de la rente du capital. Cependant, en produisant l’une et l’autre baisse, la nature travaille à l’avènement d’une moindre inégalité des conditions.
Devant de tels faits et beaucoup d’autres encore, n’est-on pas fondé à dire qu’un grand progrès s’effectuerait le jour où l’État pratiquerait la justice ?
Une moindre inégalité des conditions doit à brève échéance, dans un quart de siècle, un demi-siècle, sortir des causes multiples que nous avons indiquées dans cet ouvrage, pourvu que l’État n’y fasse pas obstacle. Cette moindre inégalité des conditions sera-t-elle un bien ? C’est incontestable à nos yeux ; elle ne s’effectuera pas, en effet, seulement par l’abaissement graduel des situations les plus élevées, mais aussi et surtout par le relèvement continu des situations les plus basses. Elle produira dans l’humanité tout entière plus de bien-être, plus de loisirs, plus de repos d’esprit, plus de simplicité, nous voudrions dire aussi plus de moralité et plus de bonheur. Que ces conséquences dans l’ordre intellectuel et moral accompagnent exactement tous les progrès vers une moins grande inégalité des conditions, qu’elles se manifestent simultanément avec ce phénomène économique, il ne faut peut-être pas l’espérer. Plusieurs fois dans ce livre nous avons prouvé que, si le progrès économique engendre le progrès intellectuel et moral, ce n’est qu’à la longue, après beaucoup de temps. Il y a un lent travail d’adaptation entre l’âme, l’esprit de l’homme et les conditions nouvelles de l’existence humaine ; très souvent il arrive que l’homme est en quelque sorte surpris, désorienté ou enivré par une amélioration trop soudaine de son sort, et que l’accroissement des salaires ou des loisirs semble plutôt nuisible qu’utile ; ce sont là, toutefois, des conséquences passagères.
L’avènement à un état social qui aura pour caractère une moindre inégalité des conditions sera donc un bien, mais non pas un bien sans mélange. Sans parler des effets perturbateurs qui accompagnent la période de transition, il y a quelques inconvénients économiques qui, pour n’être pas permanents peut-être, sont plus durables. Un économiste allemand, M. Soëtbeer, dans son étude sur la distribution des revenus en Allemagne, fait ressortir que les énormes fortunes britanniques donnent au commerce de la Grande-Bretagne beaucoup plus d’ampleur, de hardiesse, de solidité même que ne peut en avoir le commerce allemand. Cette proposition n’est peut-être pas vraie dans tous ses termes, mais elle contient beaucoup de vérité. Une maison de commerce ou d’industrie, quand elle appartient à un seul individu, qu’elle est conduite par lui-même, est d’ordinaire beaucoup mieux administrée, avec plus d’économie, plus d’esprit de suite, qu’une société anonyme quelle qu’elle soit. Or là où les énormes fortunes sont rares, les sociétés anonymes pullulent. Un écrivain anglais, qui est un des plus opulents industriels d’outre-manche, M. Brassey, attribuait déjà la crise économique si intense qui a frappé la Grande-Bretagne dans la dernière période quinquennale à la mauvaise gestion des sociétés anonymes dirigeant des usines, et à cette autre circonstance que les industriels britanniques se retiraient plus tôt qu’autrefois des affaires, laissant la conduite de la maison à des associés (partners) plus jeunes et moins expérimentés. Dans l’agriculture aussi, les grands propriétaires, quand ils ne détiennent qu’une partie du pays, servent très utilement à la diffusion du progrès économique, en répandant les notions les meilleures, les perfectionnements les plus récents, les méthodes les plus nouvelles.
À un point de vue plus général et plus élevé, on peut dire que les causes qui doivent amener une moindre inégalité des conditions peuvent, dans une certaine mesure, diminuer le ressort de l’activité individuelle. « Tous les arrangements, a écrit a Herbert Spencer, qui empêchent à un haut degré la supériorité de profiter des avantages de la supériorité, ou qui protègent l’infériorité contre les maux qu’elle produit ; tous les arrangements qui tendent à supprimer toute différence entre le supérieur et l’inférieur sont des arrangements diamétralement opposés au progrès de l’organisation et à l’avènement d’une vie plus haute[7]. » La moindre inégalité des conditions ne fera pas disparaître toute différence entre l’inférieur et le supérieur ; mais en rapprochant entre eux les distances, en rendant plus difficile, soit une complète déchéance, soit un prompt et définitif succès, elle pourra avoir pour résultat de diminuer un peu l’activité industrielle exubérante qui a été à la fois l’honneur et le tourment du dix-neuvième siècle.
Il faut prendre son parti de la tendance à une moindre inégalité des conditions ; on doit non seulement s’y résigner, comme à un phénomène nécessaire, mais s’en réjouir comme d’une transformation heureuse ; car, si elle offre des inconvénients qui sont incontestables, qui peut-être seront passagers, elle présentera des avantages permanents beaucoup plus grands.
Nous tous qui sommes, à un degré plus ou moins élevé, des privilégiés de la fortune, nous ne devons pas envisager le passé avec regret, ni l’avenir avec défiance. Si nous pensons à l’existence de nos descendants, si nous considérons qu’elle sera peut-être moins opulente, moins brillante que la nôtre, nous devons songer en même temps qu’ils auront un esprit plus calme, des désirs plus limités, qu’ils seront aussi plus à l’abri des revers et des chutes profondes. Les descendants des riches d’autrefois sont souvent les ouvriers d’aujourd’hui. Ainsi beaucoup des enfants ou des arrière-petits-enfants des bourgeois de ce siècle retomberont ou par leur faute ou par les accidents dans ce vaste réceptacle que l’on appelle la classe des prolétaires : ils y auront une destinée plus douce, plus assurée que les prolétaires d’à présent. Riches ou pauvres, bourgeois ou ouvriers, peuvent rêver avec tranquillité d’esprit au sort de leurs descendants ; cette pensée doit réconcilier toutes les classes de la société avec ce phénomène économique si considérable : la tendance à une moindre inégalité des conditions.
FIN
_____________
[1] On sait que dans les pays où le vin est la boisson usuelle, l’ivrognerie est très rare. Si le phylloxéra n’avait pas ravagé nos vignobles, la France aurait produit cent ou cent cinquante millions d’hectolitres de vin, dont la plus grande partie n’eût pas valu plus de 5 centimes le litre ; tous les Français eussent pu en boire à discrétion, et l’ivrognerie eût été très atténuée. Le phylloxéra disparaîtra ou sera vaincu, et le même résultat se manifestera un peu plus tard.
[2] Ce qui est surtout absolument indispensable, c’est la suppression ou la modification des articles du Code qui exigent le partage des immeubles en nature et ne permettent pas la compensation par des sommes d’argent équivalentes.
[3] Quand l’instruction professionnelle est distribuée par les soins de corporations libres, d’associations syndicales, les inconvénients sont beaucoup moindres que lorsque l’État avec sa lourde et lente bureaucratie se charge de ce service.
[4] D’après les Formules et tablée d’intérêts de MM. Vintéjoux et de Reinach (page 126) une somme de 50 francs (5 p. 100 d’un salaire moyen de 1 000 francs annuellement) placée chaque année à intérêts composés pendant trente-cinq ans, à une capitalisation de 3 1/2 p. 100, produirait au bout de la trente-cinquième année 3 450 francs ; si le taux de l’intérêt n’était que de 3 p. 100, ce qui est plus conforme aux circonstances économiques de l’avenir, le produit serait seulement de 3 113 francs.
[5] Voir notre Traité de la Science des finances, 4e édition, t. I, chapitre de l’Impôt progressif.
[6] Herbert Spencer, les Bases de la morale évolutionniste, voir le chapitre intitulé : le Point de vue sociologique.
[7] Les Bases de la morale évolutionniste, édition de Germer Baillière, p.163.


Laisser un commentaire