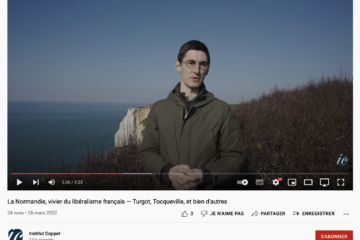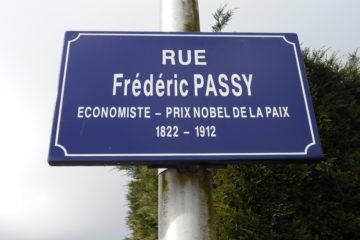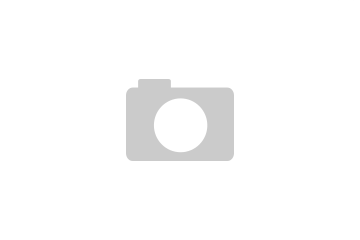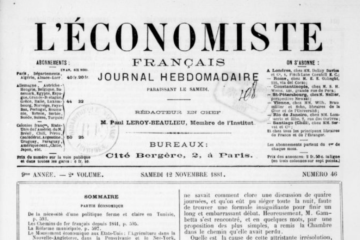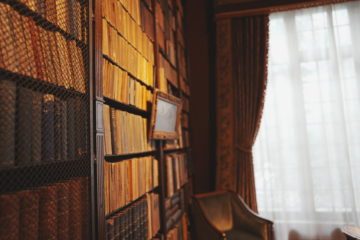Préface à L’arbitrage international par Ferdinand Dreyfus
Dans cette préface donnée en 1892 à un livre sur l’arbitrage, Frédéric Passy note le progrès des esprits, y compris dans les sphères de pouvoir, sur cette notion du recours à l’arbitrage international pour solutionner les conflits armés. Infatigable pacifiste, il croit voir un progrès dans le ralliement de certains, ou dans la fin des moqueries qui touchaient encore, quelques années auparavant, les disciples proclamés de l’abbé de Saint-Pierre.